
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Le cochon était un mets d’exception dans l’Antiquité. Lors de banquets, on mangeait déjà à Rome et en Grèce du jambon fumé et de la mortadelle. Le porc était également très apprécié de nos ancêtres gaulois qui faisaient rôtir des sangliers. Le terme charcuterie est apparu au Ve siècle et est un dérivé de « chair cuite ».
Elle se développe surtout dans les régions qui utilisent beaucoup de viande de porc comme l’Auvergne ou l’Aveyron. Et bien sûr, en Italie, où la charcuterie est fameuse. Bresaola, jambon de Parme, coppa, speck, jambon aux herbes, il y a du choix. On peut ajouter la charcuterie espagnole et la charcuterie corse aux multiples variétés et saveurs.
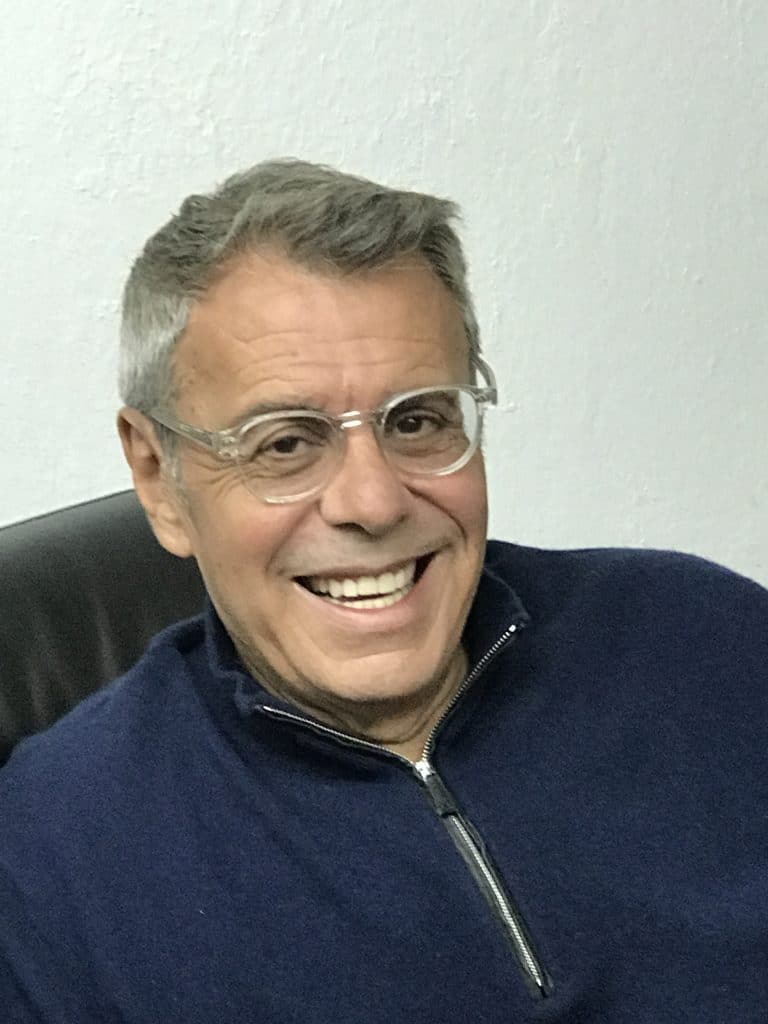
La charcuterie sous vide peut présenter quelques inconvénients. La présence de nitrites produit notamment des nitrosamines potentiellement cancérigènes. Ainsi que l’ajout de sel, l’excès de graisses. Mais aussi des taux élevés de tyramine (à l’origine parfois de migraines). On veillera bien à ne pas faire noircir la charcuterie à la cuisson (surtout au barbecue).
Le jambon blanc (qui est rose) devrait être gris. C’est l’ajout des fameux nitrites qui lui donne sa couleur rosée si appétissante. La charcuterie, consommée avec modération peut être une bonne source de protéines. Il faudra être raisonnable sur les quantités et veiller aux modes de cuisson et préparation. Se tourner également plutôt vers de la charcuterie artisanale si on peut se le permettre.
Le Docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste est notre invité.
Il y a plusieurs hypothèses à l’origine de la mayonnaise. Une version raconte qu’elle daterait de 1815 et qu’on la doit à Antoine Carême. Chef à la cour de France, il l’aurait appelé « magnonaise » en référence à un jaune d’œuf manié.
Une autre source parle de la ville de Mahon, capitale de Minorque, où une préparation à base d’œufs et d’huile aurait été baptisée « mahonnaise ». Mais il y a plusieurs versions.
La mayonnaise a inspiré plusieurs autres sauces comme la tartare (mayo et cornichons), la ravigote (oignons, vinaigre, câpres, cerfeuil, estragon), la dijonnaise (mayo et moutarde), l’aïoli (mayo et ail), etc.
Quoi qu’il en soit, rien ne vaut la recette maison : huile, jaune d’œuf, moutarde, vinaigre, sel et poivre. Certains ajoutent un filet de citron. Facile à réaliser, la mayonnaise demande quelques impératifs. Suivre la recette à la lettre, et surtout avoir tous les ingrédients à la même température, est indispensable.
La mayonnaise, c’est délicieux, mais à part des matières grasses et un peu de protéines, on trouve beaucoup de cholestérol et de sel (surtout dans les préparations industrielles). Maison, on peut opter pour de l’huile d’olive ou de colza pour leur apport en Omégas 3. Attention, toute mayonnaise maison qui a une odeur, couleur ou goût suspects, doit être impérativement jetée, pour éviter tout risque d’intoxication alimentaire grave (salmonelles, listéria, etc.)
Le Dr Corinne Chicheportiche Ayache est notre invitée.
La moutarde est le troisième condiment préféré dans le monde après le sel et le poivre. Elle s’invite sur toutes les tables et peut se déguster froide ou chaude, comme avec du lapin par exemple.
Forte, extra-forte, douce, en grains, à l’ancienne, il existe de nombreuses recettes qui plairont au plus grand nombre.
Vous avez un rhume et le nez bouché ? Testez la moutarde. Elle contient de la myrosine et de la sinigrine, deux substances qui ont le pouvoir de fluidifier le mucus pour mieux l’évacuer.
En pratique, écrasez quelques cuillerées à soupe de graines de moutarde avec une tasse de farine de blé et un peu d’eau. Mettez au préalable un corps gras sur la poitrine (de type vaseline) et posez le cataplasme. Laissez poser maximum 15 minutes (pas plus sous peine de brûlure).
Le cataplasme de moutarde peut aussi soulager en cas de douleurs musculaires ou dorsales. Mais il est fortement déconseillé aux personnes souffrant de troubles graves de la circulation ou veineux comme les varices. Dans tous les cas, demandez impérativement conseil à votre médecin avant utilisation.
Julien Allaire naturopathe est notre invité. Plus d’informations sur julienallaire.com
On nous répète à longueur de temps de manger des fruits, d’en faire manger à nos enfants. Alors quoi de plus normal que de leur donner du jus de fruits pour profiter de toutes les vitamines et minéraux ?
Seulement voilà, comme tout produit transformé, les jus de fruits du commerce ne peuvent malheureusement pas rivaliser avec un jus de fruits frais maison. Et à cela, plusieurs raisons. La première est l’ajout important de sucre. La deuxième, les techniques de conservation qui dénaturent forcément le produit. Et la troisième c’est que rien ne remplacera le « home made » (fait maison).
Préférez toujours une orange en quartiers plutôt que son jus. Vous profiterez ainsi mieux de ses fibres et du plaisir de mâcher votre fruit. C’est aussi valable évidemment pour les clémentines et les mandarines. D’ailleurs, un jus de clémentine a rarement le même goût qu’une clémentine fraîche.
Tenez compte aussi de votre tolérance intestinale. Ainsi, si vous constatez que les jus de fruits vous ballonnent, causent des remontées acides ou des coliques, optez pour la version naturelle et comparez.
Contrairement à la centrifugeuse, l’extracteur ne détruit pas la structure du fruit et fournit 30% de jus en plus. Les jus se conservent un peu plus longtemps. Quoiqu’il en soit, un jus frais se boit immédiatement sous peine de perdre sa précieuse Vit C.
Anne-Laure Possard, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
Les céréales sont une excellente source de glucides complexes et de fibres. Elles contiennent des vitamines B1, B2 et B3 indispensables au système nerveux et à un bon apport énergétique.
Elles renferment aussi du fer qui favorise l’oxygénation du sang, des cellules et des muscles. Mais elles jouent également un rôle dans le renforcement du système immunitaire. Les céréales présentent l’avantage d’être nourrissantes, variées et bon marché.
Si les céréales font partie intégrante de nos habitudes alimentaires, n’oublions pas qu’elles nourrissent aussi les animaux d’élevage (maïs, blé, orge). Un hectare de céréales produit 4,5 tonnes de viande.
Nous serons près de 10 milliards d’humains en 2050. Les céréales seront donc une denrée encore plus précieuse qu’aujourd’hui pour nous nourrir.
Le gluten peut provoquer des ballonnements et troubles intestinaux. Choisissez plutôt le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, le soja, le sorgho, le fonio, l’amarante ou le teff. Utilisez la farine de sorgho pour la pâtisserie. Le fonio, proche du riz, regorge quant à lui de vitamines et minéraux. L’amarante à la saveur poivrée est riche en protéines, fer et calcium. Le teff, originaire d’Éthiopie, contient 6 à 9 fois plus de calcium que le blé.
Muriel Blachère diététicienne nutritionniste est notre invitée
C’est comme tout : consommés de temps en temps, les sodas restent des boissons plaisir. Mieux vaut éviter de les proposer systématiquement à de jeunes enfants. Un soda contient en effet l’équivalent de 100 à 120g de sucre par litre, soit 22 à 24 morceaux.
C’est une teneur élevée qui peut entraîner, surtout chez les petits, des caries, de l’obésité, du diabète ou de l’hyperactivité causée par le trop-plein de sucres et la caféine ajoutée aux colas.
En 2022, un article incroyable a été écrit par une journaliste, Virginie Menvielle. Elle révèle les ravages des boissons à base de cola que l’on met dans le biberon des enfants de moins de 6 ans. Elle a réalisé son étude dans la région lilloise.
Face aux problèmes de santé générés par cette consommation inappropriée, certains parents et professionnels de santé se mobilisent. Leur souhait : faire étiqueter ces boissons avec un avertissement ou logo type « interdit aux enfants de moins de 6 ans ». À suivre…
Si les boissons gazeuses sucrées sont en cause, le problème de la prise de poids et d’obésité est aussi lié à l’association soda-junk food. Quand boit-on un soda ? Souvent avec un aliment gras, burger, chips, nuggets. Notons par ailleurs un manque d’activité physique. Si on aime le côté gazeux, pourquoi ne pas presser un jus de fruit frais dans une eau pétillante ?
Le Dr Juliette Hazart addictologue, nutritionniste, spécialiste en santé publique et conférencière, est notre invitée.
La vigne poussait déjà à l’état sauvage sur les continents américain et européen. D’ailleurs, les premiers navigateurs venus de Scandinavie qui accostèrent en Amérique nommèrent cette terre « Vinland ». La culture de la vigne commença à peu près en même temps que l’olivier et les céréales. C’était il y a 10 000 ans environ.
Toutes les civilisations antiques ont fêté le vin (Sumer, Babylone, l’Égypte, la Grèce, l’Empire romain, etc.). Bacchus était le dieu de la vigne chez les Romains. Dionysos celui des Grecs anciens.
Que le vin rouge contienne des polyphénols et du resvératrol, excellents pour lutter contre les radicaux libres, ne veut pas dire qu’il faut en abuser. Les recommandations des hautes autorités de santé précisent bien de ne pas dépasser un verre de vin (12,5 cl) par jour et pas tous les jours. Si on respecte ces consignes, le vin peut en effet avoir des vertus pour la santé et protectrices, notamment sur le cholestérol, ou encore certaines maladies cardiovasculaires.
Au-delà, le vin et l’alcool en général peuvent générer des cancers, troubles hépatiques, neurologiques ou psychologiques. Soulignons également les comportements violents exacerbés par la consommation régulière d’alcool et les comas éthyliques possibles.
Le vin et plus généralement les alcools sont strictement interdits aux femmes enceintes et/ou allaitantes. Tout comme pour les personnes prenant des médicaments.
Le mélange alcool et traitement chimique peut entraîner un état de « potentialisation » aux conséquences parfois mortelles. Autre règle absolue : on ne prend pas le volant si on a bu, même légèrement.
Audrey Volpoet, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
La pomme de terre est très appréciée un peu partout dans le monde. Ce féculent a, il est vrai, beaucoup d’atouts : parfaitement équilibré sur le plan nutritionnel, bon marché et plutôt facile à préparer. Elle plaît à toute la famille et regorge de bienfaits.
Elle est source de protéines, potassium, calcium, fer magnésium, vitamines B et C. La pomme de terre nouvelle est d’ailleurs celle qui contient le plus de vitamine C.
Son mode de cuisson est très important. À l’eau, en robe des champs ou à la vapeur, est l’idéal. Les vitamines et minéraux sont ainsi préservés. En revanche, frites, sautées à la poêle ou en purée, l’indice glycémique augmente. Quant aux chips, elles sont évidemment très caloriques. Sachez qu’elles contiennent de l’acrylamide, un composé potentiellement cancérigène.
Il existe environ 200 variétés en France. Plus de 1000 à travers le monde.
Le saviez-vous ? La patate douce peut être consommée par des personnes diabétiques contrairement à des pommes de terre classiques. Mais attention, à déguster cuites à la vapeur seulement et de temps en temps.
Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste, journaliste et auteure de « La Méthode douce pour mieux manger » aux éditions Leduc est notre invitée. Conférencière, elle consulte en cabinet et en visio. sur sophiejanviernutritionniste.com
C’est la boisson la plus consommée dans le monde avec le thé et le maté. Une légende raconte que c’est en Abyssinie qu’un berger remarqua que ses chèvres étaient toniques après avoir mangé les fruits rouges (ou cerises) d’un arbuste. Le berger essaya à son tour sous forme de boisson. Le café était né.
Si vous êtes amateur de café (caféophile), les résultats de cette récente étude vont vous satisfaire : boire deux à trois tasses par jour réduirait les accidents cardiovasculaires.
L’étude a été réalisée par le Professeur Peter Kistler du Baker Heart & diabete institute, de Melbourne. Son travail a porté sur 450 000 personnes âgées de 40 à 69 ans, sans aucune pathologie cardiovasculaire. Leur risque de décéder d’une maladie cardiaque était inférieure de 27% par rapport aux personnes qui n’en consomment jamais.
Une conclusion intéressante, surtout quand on sait que le café contient plus de 100 composants biologiquement actifs. Magnésium, polyphénols, antioxydants, le « petit noir », comme on l’appelle, a bien des atouts santé.
Aujourd’hui, les principaux pays producteurs de café sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l’Éthiopie.
Il est néanmoins recommandé de ne pas dépasser trois tasses par jour, de limiter le robusta, plus corsé que l’arabica et d’éviter d’en boire après 17h00 si l’on est sujet aux insomnies. Même si l’effet peut être variable, bien sûr, d’une personne à l’autre.
Le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste, est notre invitée.
Pourquoi tant d’idées reçues sur le chocolat ? Peut-être parce qu’on a entendu tout et son contraire à son sujet. Fait-il grossir ? Est-il néfaste pour notre organisme ? Donne-t-il des migraines ? Est-il bon pour le cœur ?
Pour pouvoir répondre honnêtement à ces questions, il faut définir de quel chocolat on parle.
Comme vous le savez, chocolats noir, au lait, blanc ou aromatisé n’ont pas exactement les mêmes vertus. Comme souvent, tout est question de mesure.
Mangez-vous un carré de chocolat de temps en temps ou des pots entiers de pâte à tartiner ? Vous contentez-vous de quelques douceurs au moment des fêtes ou finissez-vous la boîte de 50 ? Pourquoi rend-il malade certaines personnes et pas d’autres ? La piste d’un foie fragile n’est pas à négliger. Sans parler de certaines intolérances ou allergies possibles.
Bien que sucré et à classer dans la famille des aliments « plaisir », le chocolat, à raison d’une fois par semaine, serait bénéfique au cœur. Il aiderait à garder les vaisseaux sanguins en bonne santé. Il serait bon également pour leur pression artérielle.
De par sa teneur en flavonoïdes, polyphénols, acide stéarique et méthylxanthines, il réduirait les inflammations et augmenterait le « bon » cholestérol (HDL). Sa teneur en magnésium serait utile pour lutter contre le stress (surtout le noir à 85% minimum).
Magali Paré, fondatrice de miamnutrition.com, est notre invitée.
Depuis l’Antiquité, on prête au miel mille vertus thérapeutiques, surtout antibactériennes. D’ailleurs, aujourd’hui, plusieurs hôpitaux l’utilisent pour désinfecter certaines plaies et activer leur cicatrisation.
En France, il existe sept principaux types de miels polyfloraux : de haute montagne, de maquis, de printemps, de forêt, de causse et de garrigues.
Nectar des dieux, emblème de la science et de la poésie, associé au don de prophétie chez les Grecs, offrande sacrée chez les Romains, c’est l’un des ingrédients de la boisson d’immortalité, « l’ambroisie ». Vous avez déjà entendu parler du miel de Manuka, puissant antimicrobien mais connaissez-vous celui de Pitcairn ? C’est un îlot volcanique situé au sud de l’océan Pacifique. C’est un produit exceptionnel, très pur, d’une extrême rareté. Ce qui lui vaut le titre de meilleur miel du monde.
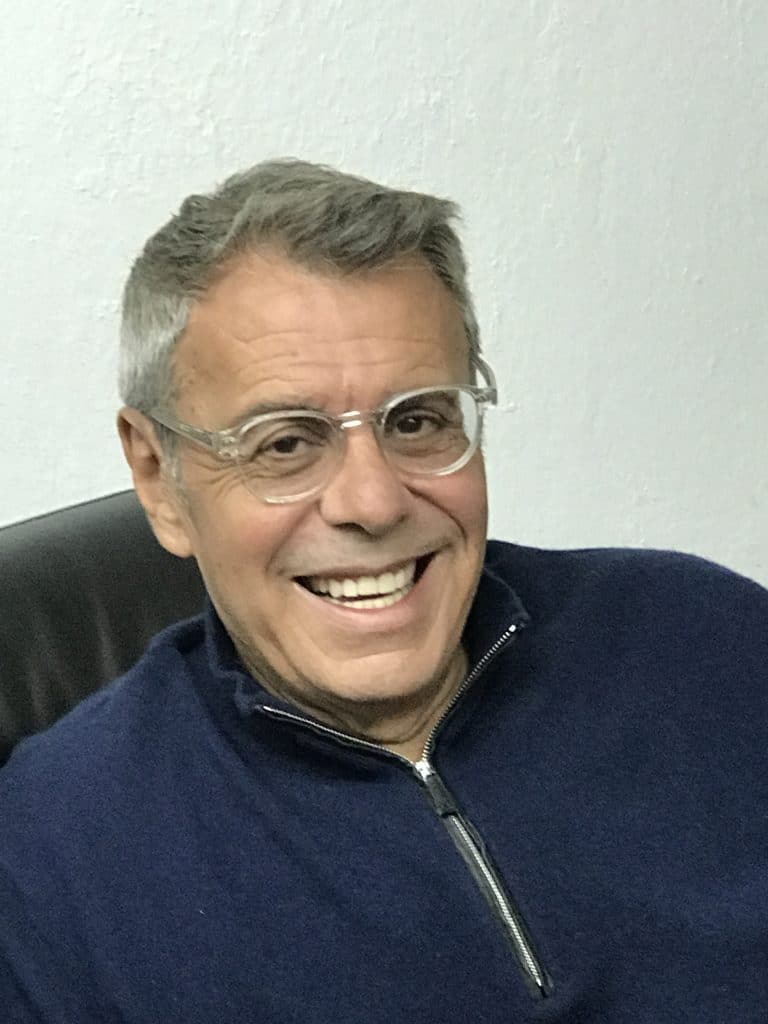
Pour savoir s’il s’agit d’un miel naturel ou non, suivez nos astuces. Commencez par mettre une cuillerée dans un verre d’eau froide, sans le mélanger. Si la substance tombe directement au fond du verre sans se diluer, il s’agit d’un miel authentique. Dans le cas contraire, c’est « de mauvaise qualité ». Surprenant, mais contre toute attente, la France n’est pas le premier pays producteur au monde, il s’agit en effet de la Chine, suivie de l’Argentine et de l’Ukraine.
Le Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, est notre invité.
La confiture est un mélange gélifié de sucre, de pulpes ou de purées d’un ou plusieurs fruits. On les fait réduire puis confire dans une bassine en cuivre idéalement. Autrefois, c’était un excellent moyen de conserver les fruits les plus fragiles. Aujourd’hui, si elles sont faites maison, il peut être intéressant d’utiliser des fruits gâtés ou au goût un peu amer, comme l’orange amère, ou astringent comme le coing.
La marmelade est quant à elle essentiellement constituée d’agrumes (orange, citron, mandarine, etc.). Contrairement à la confiture, la gelée est fabriquée à partir de fruits filtrés dont on conserve le jus comme un sirop.
La texture et la saveur du fruit d’origine doivent être préservées pour faire une bonne confiture. Elle doit aussi être malléable, épaisse et facile à tartiner. Pour se lancer dans la fabrication d’une confiture, mieux vaut ne pas choisir des fruits trop mûrs. Le résultat risquerait d’être moins savoureux. Privilégiez alors les fruits de saison, locaux et bio (si votre porte-monnaie le permet). Les confitures du commerce ne peuvent avoir l’appellation « confitures » qu’à la condition de contenir au minimum 55% de sucre.
Si vous vous posez la question, oui, la confiture est un produit calorique, déconseillé absolument aux personnes diabétiques. Attention également si vous êtes soucieux de votre poids, sinon, vous pourrez l’utiliser comme fond de tarte, la mélanger à du yaourt ou du fromage blanc. Optez pour une compote faite maison si vous voulez contrôler le taux de sucre.
Isabelle Torrès, diététicienne nutritionniste et professeure d’éducation physique, est notre invitée.
Les crustacés et les mollusques, appelés aussi fruits de mer, ont la particularité d’avoir leur squelette en dehors de leur corps. Huîtres, moules, calamars et poulpes sont des mollusques car dépourvus de coquilles.
En revanche, les crustacés ont une carapace recouverte de chitine. Elle les protège surtout des prédateurs. Homards, crevettes et crabes appartiennent à cette famille.
Les fruits de mer fournissent des protéines d’excellente qualité. Ils apportent des Oméga 3, indispensables à une bonne santé cardiovasculaire. Ils sont également sources de vitamine B12, zinc, sélénium, cuivre et phosphore.
Les crustacés renferment peu de graisses. Mais saviez-vous que les poulpes et les crevettes contenaient du cholestérol ?
On ne doit pas ramasser les crustacés ou fruits de mer sur une plage ou aux abords d’un quai. En cas de doute, se référer aux autorités sanitaires pour savoir s’ils sont comestibles. Le risque de transmission de virus de l’hépatite B est possible. Mieux vaut donc acheter ses fruits de mer chez le poissonnier. Frais, ils se gardent quelques heures seulement à 0°C couverts de glace pilée. À consommer le jour de l’achat.
Clémence Fouillade, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
L’étymologie du mot vinaigre est très simple : « vin / aigre ». Sa fabrication se fait en deux étapes de fermentation naturelle. Il s’agit de la fermentation alcoolique et de la fermentation acétique. Celle appelée « alcoolique » est la transformation des sucres en alcool. L’autre, l’acétique, est la transformation de l’alcool en vinaigre.
C’est Louis Pasteur qui, en 1863, a découvert ce phénomène de transformation de l’alcool par la fermentation d’une solution d’acide acétique.
Le vinaigre de cidre bio est le plus intéressant et regorge de minéraux : calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium, zinc, cuivre et manganèse. Il s’utilise aussi bien pour assaisonner sa salade et ses crudités qu’en cosmétique pour lutter contre l’acné ou les pellicules. Pris dans de l’eau à raison de 4 cuillères à café, c’est un tonique et un fortifiant exceptionnel. Si l’on ajoute un peu de miel, cette mixture est idéale pour booster le système immunitaire. Elle est absolument déconseillée en revanche pour les personnes souffrant d’ulcère.
Cette boisson ne saurait en aucun cas se substituer à un traitement en cours. Demandez conseil à votre médecin en cas de prise de médicaments.
Attention également si vous utilisez le vinaigre blanc (cristal) pour faire le ménage : ne le mélangez jamais avec de l’eau de javel. Les émanations produites peuvent s’avérer mortelles.
Nathalie Cvetkovic, naturopathe, est notre invitée.
La Crète est l’une des premières régions où la culture de l’olivier aurait émergée entre 3500 et 5000 avant Jésus-Christ et se serait ensuite répandue tout autour du bassin méditerranéen. Selon la légende, Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. Elle revint avec un rameau d’olivier dans son bec. Aujourd’hui encore, l’olivier est un puissant symbole de paix, d’intelligence et de prospérité.
L’huile d’olive est très prisée dans la cuisine méditerranéenne. Présente sur toutes les tables, elle permet d’assaisonner crudités et salades mais aussi viandes blanches et pâtes. Une astuce : huilez légèrement votre pain au lieu de le tartiner de beurre. Et frottez une gousse d’ail (si vous aimez). Cela vous fera un excellent antibactérien.
Pour être sûr de la qualité des huiles que vous consommez, tournez-vous vers des producteurs locaux et bio. Aussi, ne laissez pas l’huile de noix ou de lin à l’air libre, à la lumière et à la chaleur. Conservez-les dans un endroit frais ou au réfrigérateur. Ne faites pas brûler ces huiles délicates, réservées à une dégustation crue.
Contrairement à une idée reçue, l’huile crue est excellente pour notre organisme. Elle lubrifie notre cerveau et nos artères et fournit les omégas 3 dont nous avons besoin. En revanche, brûlée, grillée, frite, elle est une menace pour notre santé. L’huile d’olive supporte ainsi une température de 180 °C maximum.
Morgane Farrica, diététicienne nutritionniste spécialiste de l’alimentation des sportifs, est notre invitée.
La viande blanche regroupe la famille du porc, veau, lapin et les volailles. Elle est pauvre en graisses et riche en protéines. Elle est fortement recommandée en période de régime et elle est rassasiante, apporte des vitamines A et B et des minéraux indispensables.
Ajoutons que le poulet contient du tryptophane, un acide aminé qui favorise le sommeil et agit aussi contre la dépression.
Les graisses de la volaille se concentrent sous la peau. Poulet, pintade et canard contiennent la même proportion de cholestérol soit 75 mg pour 100g. La dinde n’en apporte que 65mg. Le poulet est une bonne source de zinc, très utile pour renforcer le système immunitaire. Les volailles fournissent de la vitamine B6, excellente pour notre peau et notre système nerveux. Il faut néanmoins pendre garde à la cuisson de la volaille. Contrairement à la viande rouge, une viande blanc rosé ne doit pas être consommée. En cause : le risque de contamination bactérienne.
Si vous utilisez une planche en bois pour découper votre viande crue, attention à bien la désinfecter ensuite : aspergez-la de vinaigre blanc et laissez agir avant de la nettoyer avec du liquide vaisselle.
Morgane Farrica, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
Aujourd’hui, par nécessité médicale, conviction, souci éthique, respect animal ou religion, beaucoup se sont tournés vers le végétarisme. D’autres sont flexitariens, c’est-à-dire qu’ils mangent moins de viande mais de meilleure qualité. La viande rouge est-elle mauvaise pour notre santé ? Comme pour tout autre aliment, tout est question de dosage, de qualité du produit et du mode de cuisson choisi.
Il convient d’abord de ne pas faire frire sa viande à haute température dans du gras et ne pas la faire griller excessivement au barbecue. Mieux vaut n’en manger qu’une à deux fois par semaine, plutôt avec des légumes. La viande crue doit par ailleurs être consommée rapidement. La viande rouge apporte par ailleurs de nombreuses vitamines et notamment la B12. Indispensable à notre système nerveux et immunitaire, les végétariens doivent se supplémenter pour ne pas en manquer.
La viande rouge est soupçonnée d’être possiblement l’une des causes du cancer du côlon. Mais des chercheurs d’Harvard travaillent sur l’implication du fer héminique et des additifs nitrités, très présents dans la charcuterie et la viande transformée.
Serait-il possible alors que ce soit les additifs qui favorisent les tumeurs plus que la viande elle-même ? Réponse dans quelques années sans doute.
Christelle Aurensan, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
Les Français mangent environ 25 kilo de poisson par an et par personne. C’est une excellente nouvelle car les peuples qui en consomment beaucoup présentent des particularités épidémiologiques.
Par exemple, les Japonais : 72 kilo par an et par personne et le taux de décès d’origine cardiovasculaire le plus bas au monde. Idem pour les Inuits, qui sont de gros mangeurs de poisson cru. On connaît aussi la longévité exceptionnelle des Crétois (population maritime), amateurs de poisson.
Le principal inconvénient à manger du poisson est la possible contamination aux métaux lourds (PCB, mercure etc…). Premier conseil : choisir de préférence des sardines, maquereaux, anchois, harengs. Le colin, la sole, le cabillaud sont acceptables. Second conseil : pour éliminer une grande partie des polluants, faites d’abord cuire votre poisson à la vapeur. Les métaux lourds « tomberont » ainsi dans l’eau.
Et pour les amateurs de sushi ou tartare de poisson, méfiance. Sachez qu’il peut y avoir des bactéries et parasites. Aussi, la femme enceinte devrait s’abstenir d’en manger.
Prenez garde à la fraîcheur du poisson, c’est une denrée fragile qui, à l’air libre, développe des micro-organismes responsables d’intolérances alimentaires. C’est pourquoi le poisson est conservé dans la glace tout de suite après avoir été pêché.
Marion de Vitis, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.
Pendant plus de 5000 ans, le quinoa était la base de l’alimentation des Amérindiens des hauts plateaux des Andes. Malgré la sécheresse et la pauvreté des sols, il est une culture rentable.
Surnommé « l’or des Incas » ou « caviar des végétariens », le quinoa est une pseudo céréale de la famille des épinards. Il en existe plus de 3000 variétés, sauvages ou cultivées : on en trouve du rouge, noir et blanc. Il se déguste chaud, façon semoule, dans un couscous par exemple. Mais également froid, en salade ou taboulé, c’est exquis. Le quinoa peut aussi être dégusté en dessert avec du lait et du caramel.
Avec une bonne teneur en protéines, en fibres et en fer, il est également sans gluten. Source exceptionnelle d’acides aminés, les scientifiques le considèrent comme l’une des céréales les mieux équilibrées du règne végétal.
Pour limiter l’amertume, rincez le quinoa avant la cuisson. Attention d’utiliser une passoire à petits trous, sinon il terminera dans l’évier. Et pour ceux qui n’ont jamais réussi une cuisson parfaite, voici quelques conseils : dosez un verre de quinoa. Rincez-le bien. Remplir deux verres d’eau froide à mettre dans une casserole. Ajouter le quinoa. Salez. Portez à ébullition et couvrir pendant 10 minutes. Lorsque les grains sont translucides, c’est prêt !
Magali Paré, fondatrice de miamnutrition.com, répond à nos questions.
Composé de farine, d’eau et de sel, la fabrication du pain est assez basique. Manger du pain remonte d’ailleurs à la nuit des temps. Les hommes préhistoriques en mangeaient déjà.
Hormis dans certains pays asiatiques, il est consommé dans le monde entier : pains indiens bhakri, chapati ou délicieux naan, pita importée du Moyen-Orient. Bagel venu d’Europe de l’Est et très consommé aux États-Unis, la Ciabatta à l’huile d’olive en Italie. Muffin en Angleterre. Pain de Maïs au Portugal. Pumpernickel ou noir en Allemagne. Lavash en Iran. Galettes de manioc en Afrique…
Le brioché est quant à lui agrémenté d’œufs, de lait, de matières grasses et de sucres. Le saviez-vous ? Le pain de seigle et le pain au seigle sont différents. Le premier est obtenu avec au moins 65 % de farine de seigle, de blé et est acidulé. Le second est fabriqué avec 10% de seigle seulement et a un goût moins prononcé.
Source de glucides complexes, excellentes pour l’énergie, il contient des protéines végétales, des fibres, des vitamines et minéraux. Notons qu’il contient aussi du sel, du sucre et du gluten (à éviter en cas d’hypertension, de diabète ou maladie cœliaque). Il peut être aussi source d’allergie pour les personnes sensibles aux moisissures.
Muriel Blachère, diététicienne nutritionniste, est notre invitée.