
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
De quelle façon le saumon peut permettre de se réinventer pour relever les défis de la vie ? C’est ce que s’attachent à expliquer Camille Syren, psychologue, et Alice Hachet, clown contemporain, avec humour et profondeur dans « La Gymnastique du saumon ou l’art de se réinventer ». Depuis deux ans, elles jouent ce spectacle est un peu partout en France, et déjà vu par plus d’un millier de personnes, dans lequel elles offrent un regard croisé et un éclairage sur la capacité de chacun à se réinventer.
Les deux femmes vont le présenter pour la première fois à Paris, le 18 juin, au théâtre du Petit Saint-Martin, dans le 10ᵉ arrondissement.
AirZen Radio. Comment est né ce spectacle ?
Camille Syren. Chez moi, c’est parti d’une envie de différencier quelque chose qu’on confond beaucoup dans l’océan de développement personnel : « bien-être » et « être bien ». On confond les deux. « Bien-être », ce n’est pas “être bien”. C’est d’abord apprendre à devenir un peu un spécialiste du décodage de ces états pour qu’ils nous délivrent toutes les informations pour nous orienter, décider et agir, etc. Donc, évidemment, la gymnastique du saumon, est une manière d’assouplir, de muscler son intelligence émotionnelle. Ça consiste finalement à nous équiper avec des fondamentaux pour bien comprendre la grande mécanique et pouvoir devenir des spécialistes de tout ce que l’intelligence artificielle ne pourra jamais faire à notre place.
Alice Hachet. Le sous-titre de notre livre, c’est l’art de se réinventer. Je pense que ça rejoint complètement ce dit Camille sur savoir-faire avec nos états émotionnels. Pour ça, le clown contemporain est un maître en la matière. On travaille vraiment sur comment on fait pour capter nos signaux, nos émotions, nos états émotionnels. Et, après, comment on va développer le jeu à partir de ça. Puis ça va venir toucher l’art de se réinventer. C’est-à-dire se transformer à l’intérieur de soi. On ne change en rien, finalement, et en changeant tout à la fois. Ce qui est un peu paradoxal. Moi, j’aime bien dire “c’est se transformer de soi en soi-même”.
Selon vous, en quoi ce spectacle est bénéfique ?
Alice Hachet. D’un point de vue du clown contemporain. Je pense que le clown contemporain aujourd’hui a toute sa place comme il l’avait autrefois. Parce qu’il vient des fous du roi. De cet archétype du personnage libre, qui pouvait être dans la cour du roi et pouvait dire tout haut ce qu’on ne pouvait pas forcément dire. Souvent, le clown permet aussi de revenir sur quelque chose de très incarné, de vrai, de très juste, authentique et qui rassemble. Ça fait qu’on est entier avec son corps, son esprit, sa pensée et ses émotions. Je pense que dans l’époque dans laquelle on vit, cela est beaucoup théorisé. Mais ce n’est pas toujours très efficient ou efficace dans ce sens-là. Je pense que la Gymnastique du saumon nous ramène à quelque chose d’efficace dans le bon sens du terme.
Camille Syren. Oui, c’est tout à fait ça. C’est-à-dire qu’en matière d’émotions, ce n’est pas toujours ceux qui en parlent le plus qui les éprouvent le mieux. En ce sens, la pratique du clown est très sensée. Si on veut aussi prendre encore un peu plus de hauteur sur les enjeux sociétaux, je trouve qu’aujourd’hui on parle de transition écologique, économique, des organisations, des modes d’organisation. Mais comme le disait très bien Pierre Rabhi, il n’y aura pas de changement de société sans changement des humains. Et au fond, il n’y aura pas de changement des humains sans changement de chacun.
Donc, pour accompagner toutes ces transitions très macro, il va bien falloir qu’on soit bien équipé au niveau micro, c’est-à-dire au plus intime de nous. En la matière, le saumon détecte des tas de signaux. Et chez nous, humains, tout est là. On est doté du tableau de bord le plus high-tech que la nature n’ait jamais inventé. Et bizarrement, on va chercher toujours à l’extérieur ce qu’on a déjà à l’intérieur de soi. Il faut donc réapprendre à se fréquenter, à pratiquer l’intériorité en quelque sorte. Cest un enjeu pour l’humanité
Qu’est-ce que ça représente pour vous de jouer à Paris, le 18 juin ?
Alice Hachet. Pour moi, c’est une immense fierté, évidemment. C’est aussi assez inattendu parce que c’est une aventure incroyable qui a commencé avec un spectacle. On n’avait pas du tout fait de business plan ou de plans sur la comète. Ça s’est fait un peu comme ça, au fil de l’eau. Puis, la vie nous a guidés jusqu’à cette date à Paris. C’est encore plus incroyable parce que cette adresse était l’ancienne école du mime Marceau. Pour moi, le mime Marceau est un grand bonhomme qui a marqué le théâtre du chapeau. Et c’est par là que j’ai commencé le mime classique, la pantomime.
Camille Syren. Tout ce chemin parcouru. Ce dont je suis fière, aussi, c’est finalement la façon dont ça a pris forme. En faisant nous-même de la Gymnastique du saumon. Ça a commencé par suivre le fil d’un indice de plaisir. On était au fond, on était dans la flaque. Une opportunité s’est présentée. On a créé en effet ce spectacle dont on a trouvé le nom un peu par hasard. Et, en fait, à sa première représentation à Bordeaux, beaucoup nous ont dit : « C’est génial, il faut que vous continuiez ». C’est ce qu’on a fait. Ça fait maintenant deux ans. Comme une gymnastique, ce spectacle s’est peaufiné, amélioré, précisé. Et voilà, aujourd’hui c’est génial parce qu’on se retrouve à Paris.
Les noyades sont la première cause d’accidents de la vie courante chez les enfants. En effet, malgré des mesures de sécurité – telles que l’accès aux piscines protégé par des couvertures, des barrières et des alarmes – ces dernières peuvent parfois être contournées. Par ailleurs, lorsque les enfants vont se baigner, ils sont souvent équipés de brassards, de bouées, de gilets de natation ou même de maillots de bain flottants.
La plupart des accidents surviennent lorsque les enfants se retrouvent dans l’eau de manière imprévue, comptant alors principalement sur la surveillance des adultes. Malheureusement, la vigilance des adultes n’est pas toujours infaillible et, dans la majorité des cas de noyades, un adulte était présent à moins de 20 mètres.
C’est à partir de ce constat que le tee-shirt Floatee a été développé. Ce vêtement anti-UV peut se porter en dehors de l’eau, comme un tee-shirt classique, et se gonfle automatiquement en cas d’immersion dans l’eau, que ce soit lors d’une chute accidentelle ou d’une baignade non surveillée. En moins de 5 secondes, le tee-shirt anti-noyade retourne alors l’enfant sur le dos et maintient ses voies respiratoires hors de l’eau, quelle que soit sa position de chute, et ce, même s’il est inconscient.
Il s’agit du premier produit au monde à assurer ce retournement automatique de l’enfant sur le dos. Breveté et certifié selon un protocole basé sur la norme ISO 12402 des gilets de sauvetage, Floatee est une solution pour les parents en matière de sécurité au bord de l’eau.

Ce tee-shirt à déclenchement automatique est conçu pour les personnes ne sachant pas nager ou ayant une faible autonomie dans l’eau. Similaire au tee-shirt anti-noyade pour enfants, il se gonfle automatiquement en cas d’immersion involontaire dans l’eau. Le dispositif est également bénéfique pour les proches de personnes en situation de handicap, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire lors des activités aquatiques.
Le tee-shirt à déclenchement manuel, conçu pour accompagner l’utilisateur dans l’eau et le secourir en cas de difficulté (fatigue, crampe, courant, etc.), est adapté aussi bien aux sportifs qu’aux seniors. Il offre une grande liberté de mouvement tout en assurant la sécurité de l’utilisateur en le retournant sur le dos, en moins de 5 secondes.
Il y a un peu plus de deux ans et demi, Clara Rohmer et Morgane Le Hir ont créé à la Cité Fertile, le premier festival Tout Day, dédié à l’économie circulaire. Pendant deux jours, différents ateliers, activités et autres animations faisaient part égale avec un food market de produits bio et locaux. Y étaient mis en avant également l’antigaspi, le recyclage, le zéro déchet, et la seconde main.
Mais tout ceci n’était qu’un premier pas pour les deux entrepreneuses qui souhaitaient créer un commerce en dur. Dans les premiers mois de 2025, le premier superstore dédié à l’économie responsable va ainsi voir le jour à Paris et l’on devrait y trouver tout ce qui a fait le succès des festivals. Shopping (seconde main, reconditionné, upcycling, antigaspi et vrac, pour des produits d’alimentation, loisirs, hygiène, mode, maison…), services (réparation et location d’objets, troc, ateliers, click & collect, événements…), mais également un lieu de restauration (café-bar-restaurant sur place ou à emporter, bio, fait-maison, de saison, en circuits courts, antigaspi…).
Un lieu complet et nouvelle génération qui permet ainsi de mieux repenser notre quotidien. Ce premier superstore parisien ne devrait pas être le seul. En effet, Clara Rohmer et Morgane Le Hir souhaitent rapidement développer l’offre, ouvrir un autre magasin dans la capitale, puis plusieurs dans toute la France.
Courses hippiques, boxe, lutte, criquet… À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, le musée Marmottan Monet à Paris propose une exposition sur l’histoire du sport vu par les peintres. Plus de 160 œuvres ont été réunies, provenant de collections des quatre coins du monde : États-Unis, Italie, Danemark, Paris et Montpellier. D’abord adopté par l’aristocratie anglaise, le sport se popularise peu à peu au XIXe siècle. La pratique sportive, très moderne, intéresse artistes, peintres, sculpteurs et photographes. Les peintres impressionnistes comme Edouard Manet ou Edgar Degas représentent régulièrement des sportifs pratiquant du tennis ou encore de l’escrime.
“L’exposition “En jeu ! Les artistes et le sport” est une promenade dans le temps de 1870 jusqu’en 1930. Nous évoquons l’évolution sociale, organisationnelle, institutionnelle et politique du sport”, explique Aurélie Gavoille, attachée de conservation du musée. L’exposition se divise en huit grandes sections, dont une est notamment dédiée à l’histoire des femmes dans le sport. On y découvre notamment une œuvre rare de Gustave Courbet, La dame au podoscaphe, représentant une femme libre, cheveux au vent, sur un podoscaphe, l’ancêtre du paddle.
Apprendre à lire aux enfants : c’est la première mission des Petits champions de la lecture. La lecture est une compétence « socle » sans laquelle les enfants, puis les adultes, ne peuvent progresser dans le savoir. Mais la lecture n’est pas seulement un atout, explique l’association sur son site internet. Elle devient rapidement facteur de liberté, foyer de l’imaginaire, source de jeux, des rêves. La compréhension de l’écrit, nous rappellent les spécialistes, est indissociable du plaisir pris à lire. Tous les enseignants et médiateurs du livre le savent. Il s’agit de la première difficulté : entrainer les enfants à lire sans transformer la lecture en impératif. C’est bien le message qu’a porté le parrain des premières éditions, Daniel Pennac. Parmi les droits du lecteur soulignés par le célèbre écrivain, figurent le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, et le droit de lire à haute voix.

C’est justement pour donner le goût de la lecture plaisir qu’a été créé le concours des Petits champions de la lecture. Le concept ? Proposer aux enfants et à leurs enseignants une aventure fondée sur le plaisir, sur une expérience ludique et accessible, puisqu’elle laisse l’enfant libre de choisir son texte et de le partager avec sa classe. L’expérience engage la sensibilité de l’enfant, qui révèle des qualités spécifiques et développe sa confiance en lui. Elle replace aussi la lecture au cœur de la sociabilité. Les enfants lisent les uns pour les autres et se recommandent des livres.
Le 24 avril 2024, se déroulait au Théâtre des Amandiers à Nanterre la finale régionale d’Ile-de-France. Seize jeunes franciliens se sont retrouvés sur scène, le temps de la lecture d’un extrait de livre à voix haute devant un public. Cette année, Rihab, élève de CM2 à l’école Antoine de Saint-Exupéry à Gagny en Seine-Saint-Denis, a remporté l’édition 2024. Elle se retrouvera en juin à la Comédie Française à Paris pour l’ultime rencontre, la finale nationale.
Pour aller plus loin > Développer nos capacités cognitives et notre vitesse de lecture

Antoine Repussard et Thomas Beaurain, les cofondateurs historiques de Zenride, sont partis de leur expérience personnelle pour créer leur projet. Avant 2018, ils sont amenés à énormément se déplacer à travers l’Ile-de-France dans le cadre de leur travail. Seulement, ils n’ont pas droit à un véhicule de fonction. Ils se tournent alors vers leur employeur pour solliciter une aide et accéder à une solution cyclable, mais rien n’existe. L’idée émerge alors. Olivier Issaly les rejoint ensuite dans l’aventure. Ayant grandi en zone rurale, la cyclo-mobilité a toujours été un réflexe du quotidien. Cela lui a tout de suite paru évident d’œuvrer à promouvoir une solution pour rendre le vélo accessible, notamment financièrement, au plus grand nombre.
Car l’aspect financier représente l’un des freins les plus importants à l’accès au vélo. “Il faut avoir en tête que le prix moyen d’un vélo à assistance électrique est de l’ordre de plus de 2 000 euros. C’est légèrement supérieur au salaire médian français”, explique Olivier Issaly, aujourd’hui président de Zenride.”En le rendant accessible par la location longue durée, qui est cofinancée par l’employeur, on lève ce blocage important”.
C’est d’ailleurs aujourd’hui la motivation première qui met les gens sur un vélo pour aller travailler. “On a vu selon les périodes des motivations différentes émerger, explique Olivier Issaly. Avant le Covid-19, il y avait déjà une dimension environnementale très importante, qui s’est renforcée après le confinement. Avec l’enjeu sanitaire, les gens préféraient être à l’air libre plutôt qu’enfermés dans les transports en commun. Et puis, dès 2022, on a senti un enjeu de pouvoir d’achat assez important, la volonté très claire de faire des économies sur son plein d’essence à la fin du mois”. Et quand bien même vous seriez motivé par un enjeu de pouvoir d’achat, l’impact environnemental est concret, réel, donc les différentes motivations se complètent tout à fait.

Le deuxième frein au vélotaf – pratique consistant à utiliser la bicyclette pour les trajets domicile-travail – est celui de la sécurité. C’est sur cet aspect que Zenride se propose d’accompagner les collaborateurs à travers des formations de sécurité routière. Des e-learnings sur la sécurité routière sont rendus obligatoires au moment de la commande. Car si c’est une chose de savoir faire du vélo lors de balades pendant ses week-ends ou ses vacances, ça en est une autre d’évoluer dans la circulation automobile, par tous les temps. Il est toujours utile de se remettre les principes de sécurité de base en tête avant de se lancer dans le vélotaf.
L’évolution et l’amélioration constante et récente des infrastructures cyclables à travers la France ont l’avantage de booster la pratique. Un cercle vertueux qui ne fait qu’inciter de plus en plus de salariés à passer au vélo. “À Paris, par exemple, une vraie révolution du vélo s’opère. C’est vraiment la ville emblématique dans la transformation vers le vélo. Il y a énormément de pistes cyclables disponibles, et d’autres en cours de construction, donc ça emmène beaucoup de cyclistes. C’est souvent plus rapide de se déplacer à vélo qu’en transports en commun, et encore plus qu’en voiture évidemment, donc il y a une vraie révolution à ce niveau-là. Mais ce qu’on constate aussi, c’est qu’il y a une sorte de révolution silencieuse dans les territoires”.
L’an dernier, Zenride a livré près de 80% de ses vélos en dehors des dix plus grandes villes de France, souvent dans des villes de taille moyenne, de quelques dizaines de milliers d’habitants. Dans les zones où il y a une dépendance à la voiture, on note que le maillage des transports en commun n’est pas suffisant. Pourtant, les salariés n’habitent pas si loin de leur lieu de travail, à quelque 5 à 10 km. Et puisque la France a la chance d’être bien pourvue en réseaux de routes secondaires à très faible trafic, cela permet de profiter d’axes cyclistes intéressants. Il y a donc un changement particulièrement instructif et encourageant dans des zones où l’on n’attendait pas un sursaut cycliste de prime abord.
“On dit souvent que l’on crée du cycliste parce qu’on accompagne les gens. On les met, on les remet sur un vélo, et ça va inciter aussi à développer de plus en plus d’infrastructures. Et plus on développe d’infrastructures, plus ça attire de nouveaux cyclistes, donc les deux sont vertueux. On travaille vraiment sur le côté “usages”, à équiper les salariés d’un vélo pour emmener de plus en plus de monde sur les pistes”, se réjouit le président de Zenride.

Si le choix est laissé aux collaborateurs quant au type de vélo, Olivier Issaly note qu’environ 80% des salariés choisissent des vélos à assistance électrique. Le reste opte pour des vélos que l’on appelle classiques ou mécaniques, qui coutent moins cher, et sont donc encore plus accessibles financièrement, et d’autant plus vertueux d’un point de vue environnemental qu’ils ne nécessitent que l’énergie des muscles. Et c’est encore meilleur pour la santé parce qu’on fait davantage d’activité physique. Avec ces vélos mécaniques, les collaborateurs vont venir rechercher des spécificités, par exemple des vélos pliants, d’une grande aide dans le cas d’une intermodalité, avec un TER par exemple. On va aussi retrouver des Gravel, vélos à tout faire, aussi efficaces pour aller au travail, faire les courses, que pour des randonnées le week-end, voire des vacances en cyclotourisme. Ce sont des vélos très polyvalents pour lesquels une forte demande est observée depuis maintenant deux ans.
“Avec Zenride, c’est un vélo personnel, attitré, que l’on a choisi. C’est pour ça qu’on laisse vraiment le choix dans plus de 600 magasins partenaires, parce que je pense que pour convertir les gens aux vélos, pour que ça devienne un réflexe au quotidien, ce qui est important, c’est que ce soit un vélo qui leur ressemble”. En effet, nous n’avons pas tous les mêmes morphologies, les mêmes usages. Certains ont besoin de passer déposer un enfant à vélo à l’école avant de commencer leur journée de travail, d’autres de pratiquer des randonnées le week-end. On ne passe pas tous par les mêmes itinéraires, en centre-ville ou par les chemins de traverse. C’est pour cela qu’offrir le choix le plus vaste possible va convaincre de passer le cap.
L’essayer c’est l’adopter ! Les bénéfices se font rapidement ressentir, que ce soit pour l’employeur comme pour le salarié. Du point de vue du bien-être physique pour commencer. Beaucoup d’études s’accordent à dire qu’une légère activité physique quotidienne apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Conséquence : une réduction des arrêts maladie notamment, donc des collaborateurs plus productifs, plus frais, plus éveillés le matin. On peut ainsi facilement pratiquer une activité physique deux fois par jour sans même s’en rendre compte.
Les entreprises, de leur côté, sont souvent motivées par le fait de faire briller leur marque. Leur engagement va permettre de faciliter les recrutements, avec un avantage utile et distinctif. La moitié des salariés exprime que leur trajet automobile domicile-travail n’est pas agréable, voire pas du tout satisfaisant, ce qui peut être une source de départ de l’entreprise. Proposer un cofinancement pour l’acquisition d’un vélo permet donc aussi de fidéliser ses collaborateurs, avec un trajet domicile-travail plus léger, lorsque les distances sont compatibles. Cela participe aussi à les rendre plus détendus et impliqués.

Fondée en 2017 par un petit groupe de résidents passionnés par la préservation de l’environnement, l’association Fontenay Environnement et Transition est rapidement devenue une force pour le changement écologique dans la région. Leur mission ? Sensibiliser, éduquer et agir pour favoriser une transition vers un mode de vie plus respectueux de la planète. “Nous souhaitons véritablement nous engager dans une démarche de transition écologique. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, avec son mode de consommation, est en passe de connaître une transformation inévitable. Nous devons nécessairement revoir nos modes de fonctionnement et de consommation. Le principe des mouvements de transition consiste à anticiper cette diminution des ressources limitées de notre planète”, explique Christophe Guyon, co-fondateur de l’association Fontenay Environnement et Transition.
L’une des réussites les plus récentes de l’association est la création des jardins partagés florissants. Les habitants peuvent cultiver des fruits et légumes biologiques tout en apprenant les bases de l’agriculture durable. Ces jardins sont devenus des lieux de rencontre et d’échange pour les habitants de Fontenay-aux-Roses. De plus, ils renforcent les liens sociaux tout en favorisant la biodiversité locale. Nous comptons actuellement trois ou quatre adhérents qui acceptent de partager une partie de leur jardin privé afin de créer un jardin partagé pour l’association. Nous expérimentons les techniques de permaculture qui privilégient une culture plus productive et respectueuse de l’environnement. Cela nous permet non seulement d’optimiser nos rendements, mais aussi de réduire notre consommation d’énergie et de préserver la nature”, souligne-t-il.
Des initiatives comme celles menées par l’association Fontenay Environnement et Transition montrent que des solutions positives et innovantes peuvent émerger au niveau local. En unissant leurs forces et en mettant en œuvre des actions concrètes, les citoyens de Fontenay-aux-Roses montrent la voie vers un avenir plus vert et plus durable pour tous.
Si l’on doit résumer la vie de Jean-Pierre Braun, la citation d’Eleanor Roosevelt lui va comme un gant : « le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
Oui, sa vie actuelle a commencé par un rêve. Une nuit, il se voit en haut d’un immeuble en train de vendre des glaces à quatre inconnus. Dans ce rêve, il est glacier et c’est normal. Au réveil, la vie reprend le dessus, il n’est absolument pas glacier, mais cette idée l’a interpellé… Quelques nuits plus tard, un autre rêve vient à lui. Il voit écrit « R-E-Ÿ-S » et une voix lui dit : « c’est le nom des glaces ! »
Alors qu’il souhaitait changer de vie professionnelle, ce dernier songe est la révélation qu’il attendait. Jean-Pierre Braun, amoureux des gelati italiennes, va alors se former en Italie à l’art de la crème glacée.
De plus, il a une idée très claire de ce qu’il veut faire : travailler ses glaces comme on travaille un parfum. Il veut transmettre des souvenirs et des émotions dans ses fragrances.
Ainsi, aujourd’hui, depuis trois ans, chez Reÿs, on retrouve des parfums tels que « Vanille intense », « Chocolat de Pépé Charles », mais aussi « Balade à Bangkok » un délicieux mélange de glace au riz thaï parfumé au jasmin, cuit comme un risotto, dans du lait de coco et de la citronnelle, ou encore « Élixir de Java », fascinant parfum mangue, gingembre, citron vert et poivre long de Java…
Glacier unique en son genre, Jean-Pierre Braun a fait de ses rêves et de ses souvenirs une réalité pour lui-même et pour des centaines de gourmands.
C’est un véritable festival de joie et d’enthousiasme. Lors du Festi’Dog, le square de la Liberté se transforme en un paradis pour les chiens, avec des activités pour tous les goûts. Entre démonstrations d’agilité impressionnantes, un parcours canin et stand proposant café, viennoiseries et croquettes, tout est prévu pour satisfaire chiens et propriétaires.

Ce qui rend le Festi’Dog si spécial, c’est son ambiance chaleureuse et conviviale. Les visiteurs se retrouvent dans un environnement où la passion pour les chiens crée des liens instantanés. “Il existe différents types d’animations, dont un spécialement dédié aux animaux de compagnie. Nous avons une comportementaliste animalière. Elle assure la présence et dispense des cours d’agilité aux participants désireux d’offrir à leur chien cette opportunité d’animation”, explique Fabienne Jan-Evanno, conseillère municipale en charge de l’environnement et du bien-être animal. De plus, il y a des démonstrations de la brigade canine de la police municipale qui font de la ville du Plessis-Robinson la plus sûre d’Ile-de-France cette année.
Les conversations animées entre propriétaires sur les caractéristiques de leurs races préférées ou les astuces pour l’éducation canine sont monnaie courante. “C’est vraiment un moment fantastique. C’est ma première fois ici avec mon chien. Je ne suis pas déçu”, partage Nicolas, un habitant du Plessis-Robinson. Les chiens sont célébrés, choyés et appréciés à leur juste valeur. Le Festi’dog est un souvenir précieux de l’amour et de la joie que nos amis à quatre pattes apportent dans nos vies.
C’est à l’adolescence que l’idée de sous-vêtements adaptés a germé dans l’esprit d’Aleksy Roxlau, 26 ans. “Je suis moi-même trans et durant ma transition, j’ai eu besoin d’avoir recours à des accessoires pour mon torse. Or en France, il n’y avait aucune marque qui proposait cela. En tant que mineur, sans carte bancaire, c’était extrêmement compliqué de se procurer des sous-vêtements. Les pièces étaient seulement disponibles sur internet, à l’étranger, avec de longs délais de livraison”. Sa marque, Be who you are, est destinée aux personnes transgenres (dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique de naissance), ou queer (dont l’identité ou l’orientation sexuelle ne correspond pas aux modèles dominants).

Des ventes en expansion
Les sous-vêtements phares de Be who you are sont les “benders” et des “tucking panties”. “Les tucking panties sont des culottes non extensibles, pour que le tissu masque bien le volume des parties génitales. Elles possèdent une base plus large à l’entre-jambe, afin d’assurer un meilleur maintien de celles-ci. Les benders s’enfilent sur le torse. “Plus ou moins courts, ils sont pourvus d’une doublure épaisse pour aplanir le torse”, relate Aleksy. Toutes les pièces sont fabriquées dans des ateliers en France, avec du coton français et du lycra italien. “On vend de plus en plus de pièces depuis la création de la boîte. L’un de nos objectifs, c’est de pouvoir retrouver Be who you are en point de vente, pour que les mineurs soient aussi capables de s’en procurer”, sourit Aleksy.
Du 14 au 25 mai se tient la première édition du Decolonial Film Festival. Plusieurs organisations culturelles aux engagements antiracistes, féministes, queers et diasporiques ont été invitées pour proposer une programmation de films décoloniaux. Les projections des films ont lieu à Paris et en région parisienne. On parle du contenu de l’événement culturel avec Coralie Mampinga, chargée de production.

C’est un festival de cinéma alternatif. On souhaite, à travers ce festival, interroger la question de la décolonisation à travers des récits parfois trop marginalisés, des films qui, selon nous, méritent davantage d’être mis en lumière. Ils sont importants pour le travail de mémoire, pour que les gens se documentent, pour qu’ils se rappellent ou apprennent ce qu’il s’est passé pendant les colonisations. J’insiste bien sur les colonisations parce que, bien évidemment, il y en a eu plusieurs à différentes époques dans différents pays, effectuées par différents colons.
Le point de départ du projet, c’est vraiment la censure dans ses formes les plus absolues, dans toutes les strates du milieu culturel, dans les cinémas. C’est le fait de se voir refuser de projeter un film parce que trop politique ou trop “niche”, ou parfois parce qu’il a une portée considérée comme trop anticoloniale. Je sais que ces mots – coloniale, colonisation – font peur, parce qu’ils renvoient à des vérités qui dérangent, qui mettent mal à l’aise. Je trouve ça un peu dommage puisque le cinéma est éminemment politique. Il l’a toujours été. Toutes ces choses-là nous ont mis surtout en colère, on s’est dit :”on en a marre, on va créer notre propre festival”.
Alors ça fait peur, car dans l’idée des gens, c’est de l’accusation. Ça renvoie à quelque chose de négatif ; or, il faut s’approprier cette histoire. Il ne faut pas la taire. Justement, il faut en parler pour que les gens puissent s’en souvenir et qu’on se dise : « OK, plus jamais ça, plus jamais de colonisation, plus jamais de racisme, plus jamais de massacres ». Donc c’est pour ça que ces mots-là, il faut les démystifier. Il ne faut pas en avoir peur.
Il s’agit d’essayer de comprendre leur essence et pourquoi il est important de les garder tels quels, de les estampiller, les placarder un petit peu partout, pour que les gens se rappellent que les colonisés font partie de l’histoire du monde, de l’histoire de la France. Ces récits sont importants, notamment pour le travail de mémoire et pour toutes les personnes qui souffrent encore et qui ont souffert.
Il va y avoir toutes sortes de films. On aura du court, du long, de la fiction, du documentaire, donc une belle programmation éclectique provenant des quatre coins du globe, des Caraïbes en passant par l’Afrique du Nord ou encore le Moyen-Orient. Il y a des films qui parlent de Frantz Fanon, figure emblématique des luttes contre le racisme et le colonialisme. On aura des films qui parlent des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata du 8 mai 1945.
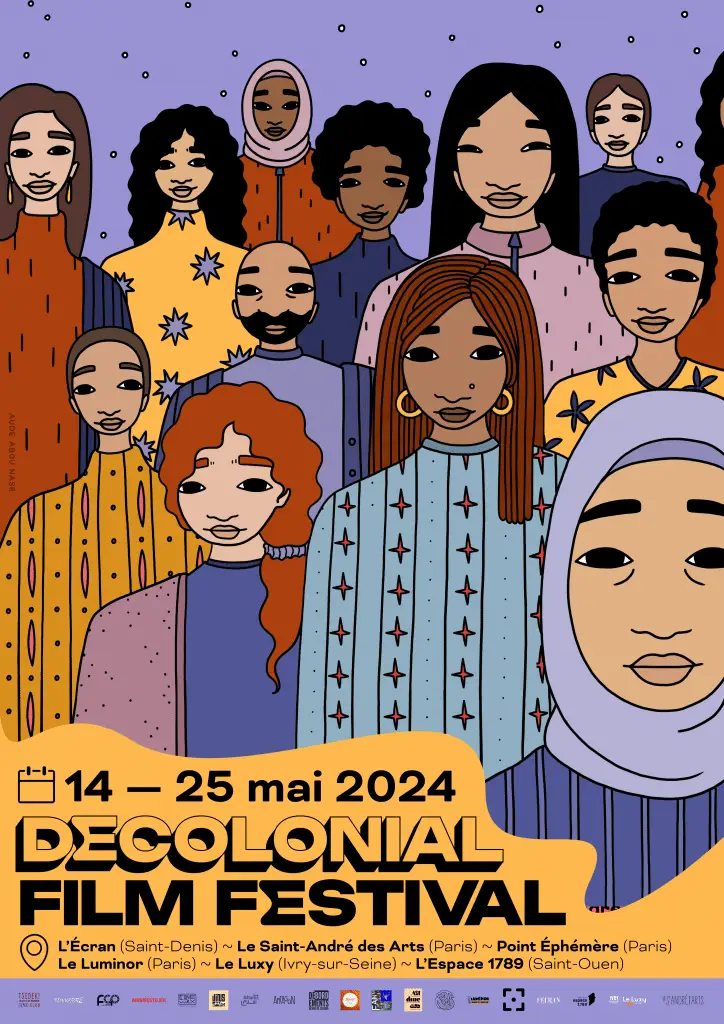
On a choisi plusieurs thèmes : héritage, résistance, terre, diaspora, spiritualité. Et en fait, j’ai vraiment l’impression que ces thèmes forment une boucle plutôt cohérente, qui va amener plusieurs questions. Notamment, qu’est-ce qui nous reste après la colonisation ? De quoi hérite-t-on ? Quels sont les séquelles, les traumatismes transgénérationnels ? Qui a résisté ? Qui a collaboré ? Comment se réapproprier nos terres ? Faire repartir aussi une économie ? Comment reconstruire un pays massacré ? Qu’est-ce qui a disparu ? Qu’a-t-on délaissé ? Qu’est-ce qui a été assimilé ? Ce qui, pour moi, revient à la question de la religion versus la spiritualité. Je sais qu’on a beaucoup ce débat, notamment dans des pays d’Afrique. Donc voilà, on aura des thèmes très intéressants qui, je pense, vont susciter de nombreux débats.
Il est important d’être représenté et de pouvoir mettre en avant des récits qui leur parlent. Ce festival est nécessaire, parce qu’à un moment donné, il faut adopter un positionnement clair sur ce que représente le cinéma parce qu’il est très diversifié. Il y a des récits qui sont parfois un petit peu passés sous silence. Alors, est-ce qu’on tend de plus en plus vers une censure absurde et totale des cinémas, des collectifs, des histoires ? Ou est-ce que justement, on renverse un petit peu tout ça et on laisse l’espace de parole à tout le monde ?
C’est la volonté de notre festival. Nous avons une réelle volonté de casser cette image de l’industrie du cinéma qui est un cercle élitiste, sexiste, raciste et qui met comme ça des personnes parfois racisées ou des personnes LGBT au compte-gouttes, ou parce qu’il faut répondre à des quotas. En tout cas, je pense que sincèrement notre festival, il est juste. Il n’est pas radical. Ce festival de films alternatifs laisse la place aux désaccords, aux prises de différentes positions. Justement, après les séances, on aura des moments de discussion avec le public, avec les cinéastes, c’est important de faire participer tout le monde.
Le cinéma est politique, donc sa vocation, elle est aussi de faire passer des messages, même si on ne regarde que la fiction. C’est peut-être aux gens d’être plus aiguisés dans leur analyse pour comprendre certains messages qui sont parfois un peu cachés pour éviter la censure. Donc oui, le cinéma est pour moi, au même titre que la radio ou d’autres médias, un moyen de faire passer de l’information, de mettre en visibilité et en valeur des récits et des histoires.
Un renouveau. C’est pour ça que le symbole du festival, c’est une vague parce qu’on souhaite s’étendre un petit peu partout aussi. Cette première édition a lieu en région parisienne. Mais le festival a vocation à s’étendre dans d’autres villes en France et notamment Marseille. C’est une ville qui a de gros réseaux militants, qui est très engagée, qui a des cinémas, aussi, qui sont très engagés. On souhaite justement que le Decolonial Film Festival devienne un modèle de référence tant dans son modèle économique que dans son engagement en matière de choix de programmation.
Non, ce n’est pas un hasard. On veut leur faire de l’ombre clairement (rires). Ça a été vraiment choisi parce qu’avec le Décolonial Film Festival, on veut revenir à l’essence du cinéma. Bannir un peu le strass, les paillettes et revenir au fondamental du cinéma, qui est de raconter des récits intéressants, politiques, engagés, parfois de la fiction.
On nous donne rendez-vous à la Fabrique, un café associatif sur les hauteurs d’Issy-les-Moulineaux. Julien est déjà là, sourire aux lèvres et regard gentil. Il nous raconte ce qu’on fait ici, dans cet espace calme, une semaine sur deux. On se réunit, entre “capitalistes”. Entre capitalistes anonymes. Attention, il ne s’agit pas d’un groupe de financiers qui célèbrent les prouesses du CAC40, mais d’un groupe de personnes marchant vers la sobriété.
Pourquoi pas les “sobres anonymes”, alors ? “Parce qu’il faut nommer l’objet addictif”, répond simplement Julien, le fondateur de ce cercle de parole. Et d’ajouter : “on n’est pas accros à un système économique, mais au mode vie consumériste qu’il nous vend”. Les premiers anonymes arrivent. De tous âges, hommes et femmes. Certains, comme Tania, ne loupent pas une séance. “Cela me fait du bien de m’entourer de gens bienveillants qui sont sur la même longueur d’onde. Et on s’échange des bonnes pratiques”, confie-t-elle alors qu’on pose les chaises en cercle.
D’autres, comme ce jeune diplômé, sont présents pour la première fois. “Oui, je me sens seul dans ma prise de conscience. Ou peut-être que je me suis isolé, ne comprenant pas pourquoi les autres ne font rien face au bouleversement climatique”. Il vient de répondre à la première question posée par Julien, “Vous sentez-vous seul ?”.
Question posée après l’exposé des règles. La parole est libre, mais personnelle. On doit parler en “je” pour éviter les généralités. On peut lever la main pour montrer son accord, croiser les bras lorsque ce n’est pas le cas. Et on se respecte les uns les autres.
Aujourd’hui, nous assistons à la 8ᵉ étape du programme. Celle qui interroge sur le rapport aux autres : comment convaincre, comment embarquer son entourage vers la sobriété ? Une méthode calquée sur le modèle des Alcooliques Anonymes. Il s’agit plus d’un cheminement de pensée que d’un parcours progressif.
“Mes parents prennent énormément l’avion et je n’arrive plus à en parler de façon dépassionnée avec eux”, déclare une participante. “J’ai la chance d’être en couple avec quelqu’un qui va à la même vitesse que moi”, confie une autre. “Je pense qu’il faut encourager, et non pas tenter de convaincre coûte que coûte parce qu’on s’épuise” dit un troisième.
La session dure 1h30, on en ressort le sourire aux lèvres. L’ambiance est chaleureuse et douce. Julien nous confie être extrêmement sollicité depuis la médiatisation de son groupe de parole. “Aujourd’hui, j’ai été appelé par une trentaine de personnes qui veulent lancer des groupes ailleurs en France. Mais aussi en Belgique, en Suisse et même au Mexique”.
Derrière une longue grille noire aux pancartes colorées, de la végétation en pagaille. Un poulailler, des vélos pour enfants, des chiens tenus en laisse. Au 49 boulevard de Ménilmontant à Paris, les anciens jouent aux échecs. Les ados du lycée d’à côté se réunissent dans des bosquets, les enfants fêtent leur anniversaire. Ici, la nature est reine. Sur les 6000 mètres carrés de terrain de la TEP (Terre d’Écologie Populaire) Ménilmontant, 4000 mètres carrés sont dédiés à la végétation.
Cet ilot de verdure, situé dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, était auparavant un terrain d’éducation physique. En 2019, la mairie souhaitait y construire un bâtiment de 85 logements sociaux, avec une déchetterie, un gymnase et des jardins partagés. Les habitants du quartier s’y sont fermement opposés. En effet, selon le géographe Cédrick Allmang, le 11e est “l’arrondissement le plus dense d’Europe et qui compte le moins d’espace vert par habitant”. Chaque parcelle de verdure compte.

Cinq ans plus tard, la TEP Ménilmontant est devenue un jardin ouvert à tous. Une vingtaine de bénévoles se relaient pour ouvrir et fermer ses grilles. Il n’y a pas de chef : le lieu fonctionne “à la débrouille”. Depuis ces dernières années, l’occupation et la gestion de cette parcelle de terrain n’est pas légale, mais “tolérée par la mairie”, selon François, l’un des bénévoles.
Chaque semaine, Ines se rend à la prison avec détermination. Elle fait son service civique dans le cadre de l’association Grandir Dignement. Les interventions de cette structure visent à rejoindre les jeunes là où ils sont, c’est-à-dire dans le contexte carcéral, afin de tisser un lien dehors/dedans et de les mettre au contact de questions de société, de citoyenneté et de solidarité. C’est également la possibilité pour l’équipe associative de créer des liens en amont de la libération.
“On a sélectionné un certain nombre de thématiques comme les médias, les stéréotypes femmes/hommes, les inégalités et le climat. À partir de ces thématiques, on élabore des ateliers durant lesquels ils vont pouvoir s’exprimer, donner leur avis, s’informer et ouvrir leur esprit. Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes comme des ateliers-jeux sur les inégalités dans le monde, des débats autour de questions de société ou alors des réflexions autour de courts-métrages”, explique Ines.
Mais son impact va au-delà du simple aspect pratique. Ines apporte aussi une lueur d’espoir et de compassion à un environnement souvent marqué par la stigmatisation et le désespoir. Sa présence encourage les détenus à croire en leur capacité à changer et à se réhabiliter.
Pour Ines, ce service civique en prison n’est pas seulement une expérience professionnelle. Chaque interaction avec les détenus lui offre de nouvelles perspectives sur la vie, la justice et la nature humaine. Elle apprend autant qu’elle enseigne, et cette expérience la façonne profondément en tant qu’individu et future professionnelle du droit.
À l’origine de Kerzon : deux frères, Etienne et Péa Delaplace qui ont eu envie de créer une marque de soins naturels pour la maison, le linge et le corps. Ils se sont inspirés des odeurs de leur maison de famille pour donner vie à leurs produits.
« Notre souhait était de créer des produits plaisir autour du parfum. C’est un très bon vecteur d’histoire. Les odeurs sont les premiers souvenirs que l’on se crée, que ce soit les odeurs de son papa ou de sa maman. Nous avions envie de développer cette sensibilité au parfum dans des produits du quotidien. Il s’agit de produits simples tels que du parfum, du savon, de la lessive, formulés à partir de très peu d’ingrédients », détaille Péa, l’un des co-fondateurs.
Des parfums travaillés avec des maitres parfumeurs de Grasse sont infusés dans leurs produits. « Le parfum est le socle, la colonne vertébrale de notre projet. Nous essayons que nos parfums soient vecteurs d’histoires », explique Péa.
À la naissance du projet, il y a dix ans, les deux frères ont tout de suite eu envie de tendre vers le mieux-agir. « Notre quête de naturalité et de qualité est basée sur le respect de la nature et des hommes, autour d’ingrédients naturels et végétaux, d’une fabrication à faible impact pour l’environnement et sans cruauté animale », souligne l’entrepreneur.
Les produits Kerzon sont notamment accessibles en ligne, mais aussi dans la boutique Kerzon, au 68 rue de Turenne, Paris 3ème.
Son histoire impose le respect. Prince Saint Florent Serry, plus connu sous le nom de scène Jah Prince, est une figure du reggae africain. Franco-ivoirien, il a grandi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avant de partager sa vie entre la Côte d’Ivoire et la France. Il vit de sa musique et de concerts, entre les deux pays. Installé une quinzaine d’années à Abidjan, il a pour projet de monter un studio et une école de musique pour diffuser le reggae dans son pays d’origine.
Mais en 2012, le chanteur est arrêté à son domicile ivoirien. En cause, sa passion pour le reggae et sa proximité avec le rastafarisme. Il est condamné à une peine d’un an de prison et une interdiction de séjourner en Côte d’Ivoire pendant 5 ans. Une arrestation arbitraire et un emprisonnement injustifié, selon Jah Prince, dont le véritable prétexte serait une tentative de censure de la part du gouvernement ivoirien à l’encontre de ses textes engagés.
Il sera libéré un an plus tard, avec 3000 autres prisonniers de droit commun. À sa sortie de prison, il n’a plus rien, spolié de ses terres, de son matériel, de son argent. Expulsé, il se réfugie en France. Jah Prince s’installe alors au bois de Vincennes dans une tente. Un peu plus de 10 ans plus tard, il s’y trouve encore. Désormais, Jah Prince veut revenir sur le devant de la scène. Après 45 ans de reggae, il vient de sortir un clip tourné dans le bois de Vincennes. Il a aussi réédité son album « Prisonniers de Babylone » et prépare désormais son retour sur scène avec sa première date de concert, le 19 juin 2024, au New Morning à Paris.
Pour aller plus loin > Science : voici pourquoi la musique donne envie de danser
“Quand on entend Paris, on pense à ce grand bassin industriel, explique Éric Ollivier, auteur du guide “Guide Tao Paris et sa région, éthique et écologique”, mais souvent, les gens ne savent pas qu’en Ile-de-France, il y a quatre parcs naturels régionaux – probablement bientôt 5 -, plus de 50% de surface cultivable ou de forêt, et qu’il suffit de parcourir une vingtaine de kilomètres hors du centre pour trouver de nombreux espaces verts, que les randonneurs et les amoureux de nature peuvent sillonner à loisir. Sans compter le bois de Boulogne et le bois de Vincennes.”
Ce sont les avantages des défauts, car plus la région est dense, plus le maillage des mobilités douces est important. D’abord, pour arriver dans la capitale, on peut recourir au train, au covoiturage, au car, voire même au vélo si l’on se sent le courage ou que l’on est bien préparé et entraîné. En effet, la Scandibérique passe par Paris. C’est la portion française de l’EuroVelo 3, la plus longue véloroute de l’Hexagone, reliant la Norvège à l’Espagne, en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle couvre plus de 1700 km et traverse 20 départements, quatre régions et des grandes villes comme Paris et Bordeaux.
D’ailleurs, au cœur même de Paris, les habitants, y compris ceux de la petite couronne, utilisent désormais plus le vélo que la voiture pour leurs transports quotidiens. Les pistes cyclables sont d’ailleurs en augmentation constante. Il existe aussi un réseau de location de vélos chez les professionnels, ou en libre-service à chaque coin de rue.
Il est très facile de se déplacer à 50 km de Paris si l’on n’est pas motorisé, que ce soit en TER ou RER, avec la possibilité de mettre son vélo dans les trains, mais pas encore dans le métro. Il faut juste penser à le faire hors des heures de pointe. “Le Guide Tao Paris et sa région” partage de nombreux conseils pour se faciliter la vie dans les transports avec son vélo. Paris est par ailleurs une capitale relativement petite, ce qui permet de la visiter à pied et de se repérer facilement grâce à la Seine et ses grandes artères.
Sans oublier la possibilité de se déplacer à Paris sur l’eau. Outre les célèbres bateaux-mouches, le “Guide Tao Paris et sa région” propose de louer un bateau électrique, dont la vitesse ne dépasse pas les 8 km/h. Ces balades sont réalisables le long du canal de l’Ourcq, en partant du quartier de La Villette avec son esprit culturel, puis en avançant en direction d’une partie plus industrielle agrémentée de street art, avant de rallier des coins très nature, avec le parc forestier de la Poudrerie en Seine-Saint-Denis, par exemple, où on peut s’arrêter, laisser son embarcation et aller se balader à pied puis revenir. On peut aussi louer un canoé et faire de belles balades le long de la Seine ou de la Marne, remonter les canaux en toute sérénité.
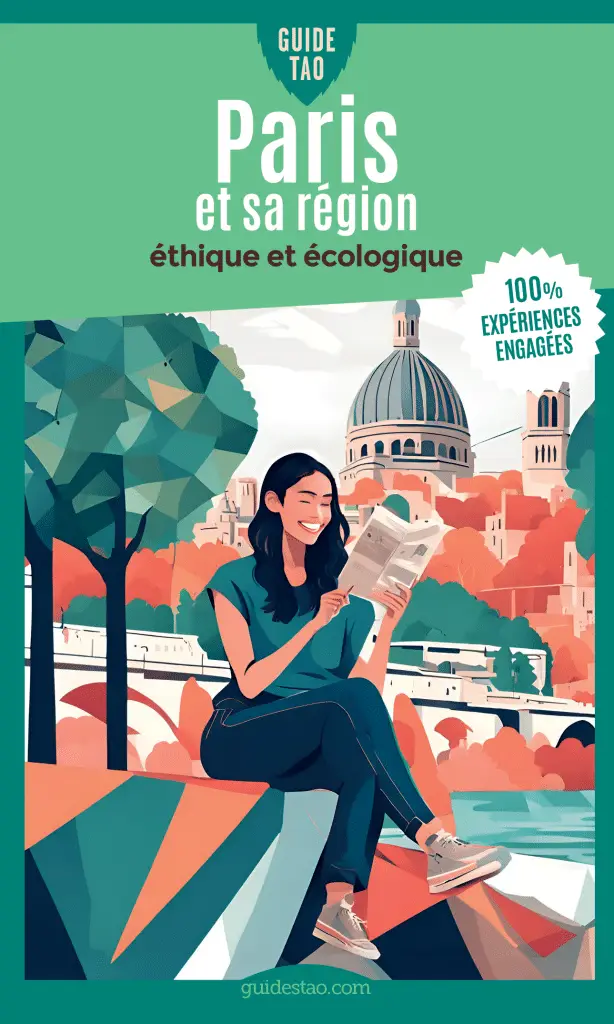
Ces idées ne sont pas inintéressantes à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui ne manqueront pas de ravir ceux qui souhaitent sortir du tumulte à ce moment-là ou faire une pause salutaire entre deux compétitions. Car ils seront légion, en provenance du monde entier, à investir la capitale le temps de quelques semaines, athlètes, staff, média, public.
“Notre point n’est pas de dire que les JO sont verts”, précise Eric Ollivier, “en revanche, on constate les progrès qui ont été faits depuis Londres, par exemple”. Dans le guide, un chapitre est d’ailleurs consacré à la question, celle d’avoir su transformer des structures existantes en les rendant plus écoresponsables, sans en créer de nouvelles, dans 95% des cas. La piscine de Saint-Denis, par exemple, a été pensée écologiquement. “Il aurait peut-être été plus judicieux de créer plusieurs petites piscines, mais l’infrastructure a le mérite d’exister désormais, dans un département où seulement 50% des habitants savent nager. On veut insister non seulement sur l’aspect écologique, mais aussi sur l’aspect social.”
Même chose à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), où auront lieu les épreuves d’aviron et de canoé kayak, dans un lieu préexistant mais où des panneaux photovoltaïques, notamment, ont été ajoutés, rendant le lieu plus écoresponsable, ce qui n’aurait sans doute pas été possible sans la venue des Jeux olympiques.
Autre sujet qui touche Parisiens, franciliens et touristes, celui de la baignade dans la Seine, interdite par arrêté préfectoral depuis 1923, mais bravée jusque dans les années 60 par les locaux. Si les athlètes seront les premiers depuis des décennies à nager dans le fleuve, trois lieux ont été identifiés où de gros moyens de pompage et nettoyage seront mis en action pour que tous puissent réaliser en 2025 le rêve de pouvoir à nouveau plonger en plein cœur de Paris. “Plus profondément, s’enquérir de la qualité de l’eau ici, partout, est un sujet primordial aujourd’hui et tant mieux que les Jeux olympiques et paralympiques permettent de se pencher sur la question. Que cela éveille les consciences me parait très positif”, insiste l’auteur.
Si vous comptez vous rendre aux compétitions, préférez des modes de déplacement écoresponsables et privilégiez des hébergements et restaurants labellisés. “Parler de cette période olympique était un prétexte pour montrer que l’offre écoresponsable, éthique, durable est très importante en Ile-de-France. Il est possible de sortir des sentiers battus, hors des grands classiques.”
Tous les bons plans dans le détail – et ils sont nombreux – sont à retrouver dans le “Guide Tao Paris et sa région, éthique et écologique“, qui vient de paraître, en librairie, sur le site des guides Tao et sur l’application éponyme, en version papier ou numérique.
Quand on passe la porte du Village des enfants extraordinaire, à Saint-Maur-des-Fossés, on pénètre dans un lieu entièrement dédié aux enfants. Les salles de jeux ont des allures de forêts de conte de fées. Jeux numériques, salle Snoezelen, mobilier sensoriel, tout est réfléchi pour stimuler et apaiser les enfants autistes ou porteurs de handicap.
Ici, “pas de jugements de la part des adultes ou des enfants”, décrit Christine, la mère du jeune Nolan, porteur de TDHA. “ En France, la prise en charge des enfants TDHA ou autistes est un processus très lent et difficile. À l’école, on a dû mettre en place un ordinateur pour accompagner Nolan durant les cours. Et en dehors de l’école, pour l’occuper, c’est assez compliqué. Alors, quand j’ai appris l’ouverture de cet endroit, j’ai tout de suite foncé.”
“Ce lieu a été entièrement conçu pour les enfants atteints de troubles cognitifs ou polyhandicapés. On accueille aussi bien les enfants extraordinaires que leur fratrie ou le reste de leur famille. Cet endroit a vocation de rompre l’isolement de ces enfants, de leur apprendre des choses et de se sociabiliser”, explique Stéphanie Le Marec, la directrice des lieux.
“Entre parents, on se retrouve dans la cuisine à l’étage et on organise un café des parents. On s’échange nos astuces, nos adresses, nos praticiens”, précise Fadoua, mère de deux enfants autistes. En France, au moins 11 000 enfants handicapés attendent une place en institut médico-éducatif, selon le ministère de l’Éducation nationale.
L’association Maisons des Jeunes Talents a vu le jour avec une mission claire : démocratiser l’accès aux prépas et aux grandes écoles. Consciente des inégalités persistantes dans le système éducatif français, elle s’est engagée à offrir aux jeunes talentueux, mais économiquement défavorisés, la possibilité de réaliser leur plein potentiel académique.
“Cette association a été créée pour permettre à ces jeunes d’être dans les conditions les plus favorables pour étudier dans un cadre adapté, sans se préoccuper de divers freins comme l’hébergement ou encore les questions financières de restauration”, explique Tanguy Jacob, coordinateur de l’association.
En plus de fournir un soutien académique de qualité, l’association offre un accompagnement personnalisé à chaque étape du parcours des étudiants. De la préparation aux concours aux conseils pour les choix d’orientation, en passant par le soutien psychologique et financier, rien n’est laissé au hasard. “Cette année, le programme d’hébergement et d’accompagnement de l’association Maisons des Jeunes Talents accueille 47 élèves à Paris et à Lyon. Dans chaque lieu d’hébergement, les élèves sont accompagnés par des encadrants qui vivent sur place ou qui assurent une présence hebdomadaire. Leur mission est de soutenir les élèves pendants ces deux années d’études intenses. Mais également de faciliter leur quotidien et de veiller à ce qu’ils adoptent un rythme de vie sain”, précise Tanguy Jacob.
Sur le plan scolaire, les élèves bénéficient de cours de soutien en mathématiques, physique, français, etc., grâce à des professeurs bénévoles. Enfin, chaque élève bénéficie d’un mentor issu des entreprises mécènes du programme pour l’aider à construire son projet professionnel et lui ouvrir son carnet d’adresses pour sa future recherche de stage ou d’emploi.
L’association Maisons des Jeunes Talents incarne ainsi l’esprit de solidarité et d’engagement envers l’égalité des chances. Elle offre un avenir prometteur à une génération de jeunes talentueux en leur ouvrant les portes d’un monde d’opportunités jusque-là hors de leur portée. L’année dernière, 100% des étudiants de l’association Maisons des Jeunes Talents ont décroché leur place dans une grande école.
Dans cet atelier situé au 84 quai de Jemmapes, à Paris, le temps semble s’être arrêté. Au plafond, sont accrochées des machines actionnées par un moteur du XXe siècle. Sur les tables en bois, des verres ébréchés, des statues en cristal et autres carafes s’accumulent. Ces objets trouvent ici une seconde vie grâce à Clémence Magnier, l’unique employée de la cristallerie Schweitzer.
“À la base, je suis formée au métier de tailleur de cristal. J’ai appris le métier de réparateur assez facilement, à force de pratique. Je peux réparer un verre, par exemple, en diminuant sa hauteur. Ou réparer une pièce cassée en deux avec une colle spécifique aux UVs, par exemple”, explique la jeune femme.
“Une cliente, un jour, m’a apporté un vase totalement cassé dont il restait à peine 2 cm à partir du fond. Elle souhaitait absolument qu’il soit réparé, car c’était un ami décédé qui le lui avait offert. J’ai donc finalement pu le transformer en pièce papier en gardant le fond du verre”, raconte Clémence.
L’après Covid a été particulièrement difficile pour la cristallerie. Les clients ne se déplaçant que très rarement, les pertes économiques ont été de taille. Clémence a alors cumulé près de 60 000 euros de dettes. “J’ai réussi à récolter près de 30 000 euros sur ma cagnotte en ligne. Je me sens vraiment très chanceuse, cela m’a permis de payer mon loyer. La situation s’améliore, même si je ne suis pas encore sortie d’affaire. On est sur la bonne voie”, sourit la gérante.