
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Pour faire face à la dépression, qui touche environ 280 millions de personnes dans le monde, selon l’OMS, voici une solution inattendue : marcher dans la nature. Ce remède a été prouvé par la science. En effet, une récente étude de l’Université de Boston confirme que la nature est une puissante alliée contre la dépression et l’anxiété. Celle-ci réduit l’activité de l’amygdale, une région du cerveau qui gère le stress et les émotions négatives.
Laurence Rouanet, sophrologue et experte en sylvothérapie, confirme que ces bienfaits incluent également une baisse du cortisol, l’hormone du stress. Elle constate ainsi auprès des personnes qu’elle accompagne une amélioration notable de la santé mentale.
“Le simple fait de marcher en forêt ou de jardiner stimule nos sens et nous reconnecte à notre essence”, détaille Laurence Rouanet.
Les phytoncides, des huiles essentielles libérées par les arbres, renforcent en effet le système immunitaire et apaisent l’esprit. “Même les enfants hyperactifs trouvent une concentration et un calme surprenants au contact de la nature.”
“Pas besoin de grandes forêts”, insiste Laurence Rouanet. Se promener dans un parc, contempler un arbre ou marcher pieds nus sur l’herbe suffit. Ces pratiques simples réduisent les tensions musculaires et apportent un apaisement intérieur durable.
Au Japon, les bains de forêt (shinrin-yoku) sont ainsi prescrits par les médecins. Avec une reconnaissance croissante des bienfaits de la nature, la France pourrait suivre cet exemple, offrant à tout un chacun une échappée belle contre le stress et la dépression. Des mutuelles commencent d’ailleurs à rembourser des séances de bain de forêt.
Avec 280 millions de personnes touchées dans le monde, la dépression est une des premières causes d’incapacité. En France, Santé publique France indique qu’en 2021, 12,5 % des adultes ont vécu un épisode dépressif.
Face à ce fléau, une récente étude de l’Université de Boston donne une perspective encourageante. Une simple promenade en nature pourrait, selon ce travail, réduire considérablement le stress et améliorer la santé mentale.
Marcher en forêt diminue l’activité de l’amygdale, la zone du cerveau liée au stress. Les bienfaits incluent ainsi une chute des niveaux de cortisol, une hormone responsable du stress.
Laurence Rouanet, sophrologue et praticienne en sylvothérapie à Toulouse, partage son expertise. Elle souligne l’importance des bactéries présentes dans le sol forestier, qui stimulent des réactions chimiques bénéfiques pour notre bien-être.
L’étude de Boston établit ainsi que l’exposition à la nature contribue à réduire les troubles cognitifs, favorisant donc une meilleure gestion des épisodes dépressifs. « Que ce soit une simple observation d’un arbre ou une immersion en forêt, l’effet est immédiat : détente musculaire, apaisement cardiaque et réduction des pensées ruminantes », ajoute Laurence Rouanet.
Elle insiste sur l’accessibilité de ces pratiques : « Même un parc en ville ou un pot de fleurs sur un balcon peuvent suffire. »
Ces bienfaits s’étendent à toutes les générations, « des enfants, des seniors et même des malades suivant un traitement lourd. Tous trouvent un apaisement significatif. Une marche lente, une contemplation ou des exercices simples suffisent », explique Laurence Rouanet. Cette dernière observe par ailleurs que les citadins, souvent coupés de la nature, ressentent un profond soulagement en renouant avec cet environnement.
« Nous avons une mémoire archaïque qui s’éveille en forêt. Cela apaise notre rythme intérieur et favorise un sentiment de sérénité. »://www.airzen.fr/depression-saisonniere-causes-symptomes-comment-en-sortir/”>dépression.
Une récente étude de l’université de Tsukuba au Japon montre que courir seulement 30 minutes deux fois par semaine peut améliorer la santé mentale. Les participants ont constaté une réduction du stress de 14 %, une amélioration de l’humeur de 18 % et une diminution des symptômes liés à l’anxiété et à la dépression. Selon le professeur Brendon Stubbs, spécialiste du lien entre mouvement et bien-être, « ces résultats démontrent qu’une petite quantité d’exercice régulier peut réellement aider les gens à se sentir mieux. »
Suzy One Coaching, coach et passionnée de course à pied, partage son expérience personnelle. « Quand on prend ses baskets et qu’on part courir, on ressent une vraie liberté. Parfois, certaines séances sont plus difficiles, mais globalement, c’est ce sentiment de bien-être qui nous motive. ». Avec le temps, c’est devenu une passion. Aujourd’hui, j’accompagne d’autres personnes pour leur permettre de découvrir ces bienfaits. »
Suzy insiste sur l’importance de progresser doucement : « Quand on débute, il y a un décalage entre ce que l’esprit veut et ce que le corps peut. Alternez marche et course au début pour laisser le corps s’adapter. »: « Cela occupe l’esprit tout en respectant votre rythme. »
La course à pied n’est pas réservée aux athlètes : « il n’y a pas d’âge pour commencer. J’ai vu des gens transformer leur vie grâce à la course”, notamment en arrêtant de fumer, en gagnant en confiance, ou simplement en prenant du temps pour soi. Suzy note aussi l’impact grandissant de la course à pied depuis la pandémie. « Les gens ont compris qu’elle pouvait apporter beaucoup, quel que soit leur niveau. ». Lorsqu’on l’accompagne de séances de yoga, de méditation ou de sophrologie, cela améliore l’impact sur la santé mentale.
Avec seulement deux séances par semaine, les bénéfices sur le mental et le corps sont accessibles à tous. Comme le dit Suzy, « il n’est jamais trop tard pour enfiler des baskets et se lancer. » Découvrez comment vous lancer dans la course à pied, les bienfaits de cette dernière ou encore comment régulariser votre pratique en écoutant les pastilles sonores en haut de l’article.
D’après une récente étude de l’université de Tsukuba, au Japon, la course à pied a de nombreux bienfaits sur la santé mentale. Des effets peuvent d’ailleurs être ressentis en deux séances de 30 minutes par semaine. Selon cette étude, les participants ont observé une amélioration de 18 % de leur humeur et une réduction de 14 % des symptômes de stress et d’anxiété.
Suzie One Coaching, coach sportive et experte en bien-être, partage son éclairage sur cette pratique bénéfique. Elle explique également comment l’intégrer dans une vie bien remplie.

La course à pied permet de s’accorder un moment rien qu’à soi. « Même 30 minutes suffisent pour se recentrer et être plus disponible pour les autres. Prendre du temps pour soi, c’est aussi mieux gérer ses relations au quotidien », souligne Suzie One Coaching.
Ce moment de pause active, bien qu’individuel, est aussi une expérience collective. «. »
Suzie remarque chez ses élèves un changement majeur. «. Ces succès sportifs impactent positivement d’autres aspects de la vie quotidienne. »
Elle ajoute que ce renforcement s’applique à tous, quel que soit le niveau initial. « Il n’y a pas de petite distance ou de petit objectif, chaque pas compte. C’est une progression qui nous apprend à nous dépasser. »
Suzie recommande aux débutants de démarrer doucement. Car au départ, « il y a souvent un décalage entre ce que l’esprit veut et ce que le corps peut. »
Un plan d’entraînement gratuit est d’ailleurs disponible sur son site, pour aider les débutants à courir régulièrement sans se blesser.
Pour maximiser les bienfaits, Suzie combine souvent la course à pied avec des exercices de respiration et de méditation. « La respiration agit directement sur les émotions, comme le stress ou la peur. Des techniques comme la cohérence cardiaque ou le yoga renforcent cet équilibre. » Ces pratiques favorisent le lâcher-prise, essentiel dans nos vies chargées. Ce qui est également le cas dans la sophrologie : « Apprendre à relâcher la pression demande parfois plus d’effort que de rester concentré. Avec un accompagnement, cela devient plus naturel. »
La science montre également que courir libère des endorphines. Ces hormones du bonheur « créent un état de bien-être que les coureurs appellent souvent le “flow”. Même après une séance difficile, on se sent léger et apaisé, ce qui incite à recommencer ».
Une étoile est avant tout un immense réacteur nucléaire qui produit de la lumière et de la chaleur. Selon Olivier Sanguy, rédacteur à la Cité de l’espace à Toulouse, “ce sont des soleils, mais situés à des distances bien plus grandes”.
Ce phénomène de fusion nucléaire génère une lumière visible qui atteint notre planète après des années-lumière. Certaines étoiles, comme Sirius ou Vega, sont particulièrement brillantes, tandis que la fameuse étoile polaire, bien que repérable, n’est pas la plus lumineuse.
Le scintillement des étoiles est une illusion d’optique causée par l’atmosphère terrestre. En effet, contrairement aux planètes, les étoiles apparaissent comme de minuscules points lumineux en raison de leur grande distance.
Les turbulences de l’air perturbent la lumière qui nous parvient, rendant les étoiles scintillantes. Ce phénomène n’existe pas dans l’espace, hors de l’atmosphère.
La couleur des étoiles n’est pas due à notre perception, mais à la température de leur surface, appelée photosphère. Les étoiles bleues, extrêmement chaudes, peuvent ainsi atteindre jusqu’à 25 000°C, tandis que les étoiles rouges sont plus froides.
Le Soleil, quant à lui, est une “naine jaune” dont la température de surface avoisine les 5 500°C. Une classification permet d’ailleurs d’organiser ces couleurs.
Ce qui est fascinant avec les étoiles, c’est que leur lumière met du temps à nous parvenir. Par exemple, une étoile distante de 15 000 années-lumière montre son état tel qu’il l’était il y a 15 000 ans. Cela permet d’observer l’univers dans un passé lointain.
“En regardant les galaxies lointaines, on reconstitue l’histoire de l’univers et du Big Bang”, explique Olivier Sanguy. Grâce aux étoiles, l’humanité a fait des découvertes majeures, comme la vitesse d’expansion de l’univers notamment. Qui sait ce qu’elles nous apprendront dans le futur.
La collection de bandes dessinées Système solaire des éditions Glénat, conçue en collaboration avec l’Observatoire de Paris, ouvre les portes de l’astronomie. Cette série BD, scénarisée par Bruno Lecigne, allie aventure et science et rend le système solaire accessible et captivant.
« La bande dessinée permet d’apporter une dimension supplémentaire à l’apprentissage scientifique, en ajoutant une touche d’imaginaire », explique Bruno Lecigne.
À travers chaque tome, le lecteur explore une planète du système solaire comme s’il y était, accompagné d’un vaisseau et d’une équipe de scientifiques fictifs. Cette approche permet de mélanger des faits scientifiques rigoureux et une dose de fiction captivante.
Les informations sont ici précises et validées par les experts de l’Observatoire de Paris. « On apprend par le divertissement », précise Bruno Lecigne. Un format idéal pour toucher tous les publics, notamment les jeunes intéressés par la science.
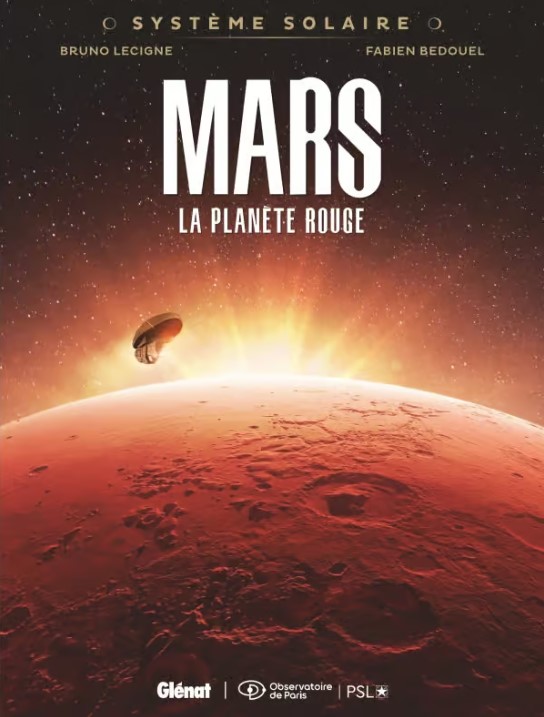
La série ne s’arrête pas aux planètes bien connues. En effet, elle explore également des lieux lointains, comme la ceinture de Kuiper ou le nuage d’Oort, des zones mystérieuses situées aux frontières du système solaire.
Les prochains volumes, prévus pour 2025, emmèneront le lecteur jusqu’à Uranus et Neptune, deux des planètes les plus méconnues.
Avec ce projet, les éditions Glénat offrent une nouvelle manière de découvrir la science. « C’est un moyen de rendre ces connaissances familières et d’illustrer les particularités de chaque planète », conclut Bruno Lecigne.
La collection Système Solaire a ainsi pour but de rendre l’astronomie accessible à tous, petits et grands, tout en éveillant une conscience écologique sur la fragilité de la Terre en comparaison de ses voisines hostiles.
La biodiversité, parfois invisible et insaisissable, devient plus accessible grâce à une innovation de Westlake University et de l’INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique). Leur caméra embarquée est le fruit de 3 ans de recherche. Elle capture des images en continu et les analyse en temps réel grâce à l’intelligence artificielle. Cet appareil léger et autonome, testé dans divers environnements en Chine, a révélé des comportements jusque-là inconnus, comme la pollinisation nocturne des fleurs de durian par des renards volants, une grande espèce de chauves-souris. Kevin Darras, chercheur INRAE, précise : « cette caméra nous permet d’observer des espèces qui échappaient aux méthodes traditionnelles. »
Contrairement aux « pièges photos » classiques, qui ne captent souvent que les gros animaux, cette caméra repère aussi les petits insectes et s’adapte aux conditions nocturnes. Elle a ainsi pu détecter des abeilles pollinisant des fleurs de colza ou des canards mandarins sur un lac. En se déclenchant au moindre mouvement dans son champ de vision, elle répond mieux aux défis du suivi automatisé des écosystèmes, permettant aux scientifiques de surveiller les interactions écosystémiques, de mesurer les impacts des changements climatiques et de documenter les espèces dans les zones les plus reculées.
Conçue pour fonctionner sans réseau électrique ni connexion internet, cette caméra est déployable sur tous les terrains. En outre, les plans de conception sont en libre accès et les pièces peuvent être imprimées en 3D, permettant à d’autres chercheurs de construire leur propre appareil à moindre coût. Accessible ainsi aux chercheurs des pays moins développés, cette innovation participe à la préservation de la biodiversité mondiale. Par ailleurs, une version commerciale, plus simple et abordable, est en cours de développement pour que ce dispositif devienne un outil central de la recherche écologique.
À Châteauroux (Indre), une innovation transforme l’expérience de la parentalité pour les personnes malvoyantes et aveugles. En effet, grâce à l’échographie haptique, ou « échographie en braille », les futurs parents peuvent toucher une représentation 3D de leur bébé.
Cette méthode offre ainsi un contact tactile unique. Celle-ci répond à un besoin jusque-là largement ignoré. En permettant aux parents malvoyants d’explorer les traits de leur bébé, cette méthode crée une connexion émotionnelle. Cette avancée technologique est notamment utilisée par Anthony Weber, échographiste engagé dans l’inclusion.
L’échographie haptique repose sur un processus relativement simple. Les données échographiques 3D du fœtus sont exportées pour être imprimées en résine. Ceci donne aux parents un modèle réaliste du visage, des mains ou des pieds du bébé.
La résine, choisie pour sa douceur au toucher, rend chaque détail perceptible, des narines aux lèvres. Elle permet aux parents de ressentir leur enfant. La fabrication de ces modèles peut être rapide, souvent en quelques jours, permettant d’organiser une consultation spécifique pour offrir aux parents cette première « rencontre » tactile.
Cette technologie représente bien plus qu’une simple innovation médicale : elle redéfinit l’expérience de la parentalité pour les personnes malvoyantes et aveugles, en leur offrant un accès direct à ce moment intime. Les retours des parents sont empreints de gratitude et d’émotion.
Enfin, pour beaucoup, l’échographie en braille permet de ressentir leur bébé autrement que par des mots, souvent perçus comme insuffisants pour transmettre l’ampleur de cette connexion. Anthony Weber constate également un intérêt croissant des associations pour faire connaître cette technologie et encourager son expansion en France.
Alors que cette pratique reste encore rare en France, son potentiel de croissance est évident. La simplicité de sa mise en œuvre et les possibilités qu’offrent les imprimantes 3D modernes pourraient en effet permettre à de nombreux autres cabinets de l’adopter. Au-delà de la parentalité, cette approche tactile ouvre la voie à de nouvelles applications médicales inclusives. Il est ainsi, par exemple, possible d’envisager d’étendre cette méthode aux personnes sourdes et malentendantes, en explorant des techniques basées sur les vibrations.
Pour l’instant, les modèles 3D ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, bien que leur coût reste relativement abordable (environ 40 à 50 €). De nombreux cabinets, dont celui d’Anthony Weber, offrent ce service gratuitement, afin d’encourager l’inclusion sans toucher au budget des futurs parents.
L’activité physique, longtemps sous-estimée dans le cadre du cancer, est aujourd’hui reconnue comme un atout thérapeutique essentiel. Des études montrent ainsi que pratiquer régulièrement un sport diminue la fatigue liée aux traitements d’environ 30%. L’activité physique réduit également la mortalité de certains cancers jusqu’à 40%.
En plus de booster le moral, le sport améliore la tolérance aux médicaments et renforce le système immunitaire, augmentant ainsi les chances de guérison.
L’un des principaux défis pour les patients est la perte de masse musculaire due aux traitements. Notamment dans le cancer du sein, où les femmes peuvent prendre du poids tout en perdant du muscle. Cette situation altère l’efficacité des soins et peut entraîner des complications.
Jean-Marc Descotes, directeur général et cofondateur de l’association Cami Sport et Cancer, explique que la pratique d’exercices physiques adaptés permet de lutter contre cette perte musculaire. D’autres bénéfices en découlent : réduction des douleurs ostéo-articulaires, effets inflammatoires moindres. Cela réduit aussi le risque de rechute jusqu’à 50%, tout en diminuant la durée des hospitalisations.
L’association Cami Sport et Cancer propose des programmes spécifiques, dès l’annonce du diagnostic. Ces derniers permettent aux patients de conserver ou développer leur masse musculaire, réduisant ainsi les douleurs associées aux traitements. Des activités comme la marche, le renforcement musculaire ou encore des exercices cardiovasculaires sont adaptés à chaque individu.
Les bienfaits psychologiques sont également majeurs : baisse de l’anxiété, diminution des symptômes dépressifs et amélioration de l’estime de soi. Une pratique régulière réduit par ailleurs le risque d’insulinorésistance et de diabète, tout en favorisant une rémission durable.
Combattre la maladie d’Alzheimer est l’un des grands défis de la médecine moderne. Cette pathologie pourrait voir ses effets ralentis grâce à une substance courante dans notre quotidien : la caféine.
Selon les travaux de David Blum, chercheur à l’INSERM et son équipe, une consommation régulière et modérée de café pourrait en effet aider à prévenir certains symptômes, en particulier le déclin des fonctions cognitives.
La caféine intervient en bloquant l’activité excessive d’un récepteur dans le cerveau, récepteur dont l’hyperactivation est observée chez les patients atteints d’Alzheimer. Cette hyperactivité est liée à la dégradation des fonctions cognitives et de la mémoire. En normalisant cette activité, la caféine pourrait ainsi contribuer à freiner la progression de la maladie.
Même si ces résultats sont encore en phase de validation clinique, ils ouvrent la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques, simples et abordables.
La consommation de café ne serait pas uniquement bénéfique contre Alzheimer. D’autres études indiquent en effet que, sous certaines conditions, la caféine pourrait aussi aider à réduire les risques de maladies comme Parkinson et certains cancers.
Toutefois, pour profiter de ses bienfaits, il est conseillé de ne pas dépasser les trois tasses de café par jour. L’Agence européenne de sécurité alimentaire recommande de limiter la consommation à 400 mg de caféine par jour pour éviter des effets indésirables, notamment sur le système cardiovasculaire.
Si les résultats de cette étude se confirment, ils pourraient avoir des implications majeures, notamment pour les pays en développement.
Contrairement à d’autres traitements coûteux, la caféine, présente dans le café et d’autres boissons, représente une solution peu chère et facilement accessible. Cela pourrait permettre une prise en charge préventive à grande échelle dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
Voyager 1 et 2 ont offert à l’humanité des découvertes inédites. Voyager 2, par exemple, est la seule sonde à avoir survolé Uranus et Neptune. En passant à proximité de Jupiter et Saturne, elles ont révélé des informations précieuses sur leur composition, leurs lunes et leurs anneaux.
Les données récoltées sont d’ailleurs encore étudiées aujourd’hui et ont ouvert la voie à de futures missions d’exploration spatiale. Grâce à elles, des mystères comme la complexité des champs magnétiques de ces planètes ont été partiellement percés.
Après avoir rempli leur mission principale, les sondes Voyager ne se sont pas arrêtées. En franchissant une frontière unique, elles sont devenues les premières sondes à sortir du système solaire et à pénétrer dans l’espace interstellaire.
Elles ont ainsi permis de mieux comprendre la frontière où le vent solaire, l’énergie émanant du Soleil, s’arrête et rencontre les particules des autres étoiles. Ce franchissement a confirmé des théories scientifiques sur les limites de notre système solaire.
Aujourd’hui, plus de 45 ans après leur lancement, les sondes Voyager continuent d’envoyer des informations vers la Terre. Elles ont par ailleurs dû réduire leur consommation d’énergie en désactivant certains instruments. Malgré leur âge, les sondes continuent de fonctionner dans des conditions extrêmes.
En 2023, Voyager 1 a rencontré une panne qui a failli mettre fin à sa mission. Elle envoyait en effet des données incohérentes et les ingénieurs craignaient qu’elle soit irrémédiablement endommagée. Mais grâce à la persévérance et à l’ingéniosité des équipes de la NASA, une solution a été trouvée. En analysant minutieusement le problème, elles ont découvert qu’une partie de la mémoire de la sonde ne fonctionnait plus correctement. Ils ont alors envoyé des instructions informatiques pour contourner cette mémoire défectueuse, permettant ainsi à Voyager 1 de reprendre ses transmissions scientifiques.
Un des aspects les plus fascinants de cette mission est le célèbre “Golden Record”. Ce disque en or embarqué à bord de chaque sonde contient des sons et images de la Terre. Il s’agit ainsi d’une sorte de message pour d’éventuelles civilisations extraterrestres qui pourraient, un jour, tomber sur ces sondes.
Le disque inclut également des salutations dans différentes langues, des sons naturels comme le chant des oiseaux et des photos qui représentent l’humanité et la vie sur Terre.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans cette interview avec Olivier Sanguy de la Cité de l’espace à Toulouse.
À Paris, la Cité des sciences et de l’industrie propose des stages variés qui plairont à tous les enfants. Ces ateliers, accessibles dès 6 ans, couvrent des thématiques fascinantes. L’occasion pour les petits passionnés d’astronomie d’apprendre à reconnaître les constellations et fabriquer des objets d’observation. Pour ceux intéressés par la technologie, un stage sur les drones permet aux enfants de programmer leurs drones et de participer à un spectacle à la fin du stage.
Un autre atelier permet par ailleurs de découvrir l’univers des abeilles. Les enfants y apprendront comment elles vivent, se nourrissent et fabriquent du miel. Ils repartiront même avec une ruche qu’ils auront construite eux-mêmes. Et pendant que les enfants s’amusent et apprennent, les parents peuvent télétravailler dans des espaces de coworking sur place.
Pour ceux qui préfèrent la nature, direction la Provence où une activité unique attend les jeunes explorateurs. Ces derniers pourront grimper dans les arbres et partir à la découverte des chauves-souris.
En plus de comprendre leur mode de vie, ils participeront à un protocole scientifique visant à préserver ces espèces. Ce stage combine activité physique et apprentissage scientifique, un combo parfait pour occuper les enfants en plein air.
À Toulouse, le Quai des Curieux et l’association Planète Sciences Occitanie organisent des stages pour les 7-13 ans. Au programme : création de jeux vidéo, programmation de robots et initiation à l’intelligence artificielle.
Les enfants auront également l’opportunité d’apprendre à protéger les océans. Et pourront voyager virtuellement dans l’espace.
Enfin, à Bordeaux, Cap Sciences propose des ateliers aussi captivants que variés. Les jeunes pourront plonger dans l’univers des dinosaures. Ou encore découvrir les secrets de l’océanographie et s’initier à l’archéologie.
Les punaises de lit et leurs piqûres nocturnes font des ravages ces dernières années. Cependant, grâce à une découverte scientifique, il est possible de s’en débarrasser facilement et sans produits chimiques.
L’équipe du parasitologue et entomologiste médical Pascal Delaunay a découvert les effets de la terre de Sommières. Ce produit naturel, disponible en magasins, s’avère en effet redoutable pour éliminer ces nuisibles de façon écologique. Grâce à son pouvoir déshydratant, il permet de se débarrasser des punaises de lit de façon simple, efficace, économique et respectueuse de l’environnement.
Pour éliminer efficacement les punaises de lit, il est essentiel de suivre un protocole précis. Avant d’appliquer la terre de Sommières, il faut ainsi ranger soigneusement les pièces infestées. Laver les textiles à haute température (60°C) ou les congeler à -20°C. Il est ensuite recommandé de passer l’aspirateur et d’utiliser de la vapeur sur les zones touchées. Ce processus permet d’éliminer une grande partie des punaises. C’est ici que la terre de Sommières entre en jeu pour compléter l’opération.
Une fois le logement bien nettoyé, il suffit d’appliquer une très fine couche de terre de Sommières dans les coins et recoins stratégiques. Par exemple, sous le lit, autour des lattes du sommier, le long des plinthes et au niveau des pieds de meubles. Il est aussi important de ne pas en mettre excessivement sur les surfaces directement en contact avec le corps, comme les draps ou le matelas.
La terre de Sommières possède des propriétés absorbantes uniques. Lorsqu’une punaise marche sur cette poudre, elle se retrouve couverte de minuscules particules qui absorbent rapidement l’eau et l’huile présentes sur sa carapace. Le tout va provoquer sa déshydratation en seulement 24 à 36 heures.
Son effet ne s’arrête pas là. Grâce à un phénomène de “contagion”, la punaise transporte la poudre lorsqu’elle se déplace. Elle la transmet ainsi aux autres membres de la colonie, provoquant une destruction progressive du groupe.
Contrairement aux insecticides chimiques, souvent coûteux et dangereux pour la santé humaine, la terre de Sommières ne présente aucun risque pour les habitants de la maison. Bien qu’il soit recommandé d’éviter de respirer directement la poudre, elle n’est ni toxique ni abrasive.
Cette solution durable, respectueuse de l’environnement et facile à mettre en œuvre s’adresse à ceux qui souhaitent éradiquer les punaises de lit sans nuire à leur santé ni à celle de la planète.
Facile de comprendre pourquoi la Terre est surnommée « la planète bleue ». Les océans couvrent 71 % de la surface du globe et produisent plus de 50 % de l’oxygène que nous respirons. Ils sont essentiels à la vie sur Terre.
Mais le changement climatique et les activités humaines la menacent directement. En France, des initiatives montrent qu’il est possible de renverser la tendance. C’est le cas dans la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales.
Cette réserve célèbre ses 50 ans d’efforts pour protéger la biodiversité marine. Pour obtenir des résultats, plusieurs actions concrètes ont été mises en place. La réserve, sous la direction de Frédéric Cadene, son conservateur, et Virginie Hartmann, responsable scientifique, a instauré une zone de protection renforcée.
Toutes les activités humaines y sont donc interdites, permettant aux habitats et aux espèces de se régénérer sans perturbations.
Dans les zones de protection partielle, des règles strictes encadrent la pêche et la plongée. Les pêcheurs professionnels, par exemple, doivent respecter des quotas et des tailles minimales de capture pour préserver les populations de poissons.
Grâce à ces mesures, la réserve a vu le retour en force de plusieurs espèces, notamment du mérou brun. Mais également le développement des herbiers de Posidonie, essentiels à l’écosystème marin.
Les résultats sont remarquables et démontrent que la protection des zones marines peut inverser la tendance destructrice des dernières décennies.
En doublant la surface de cette réserve, la France pourrait étendre ces bénéfices et inspirer d’autres nations à suivre cet exemple.
Pour contrer la baisse du niveau en sciences, chez les élèves en France, il existe des solutions novatrices. (Cf Rapport PISA publié tous les 3 ans, qui évalue les compétences des élèves dans trois domaines : sciences, mathématiques et compréhension écrite). C’est le cas du Congrès scientifique des enfants. Ce projet pédagogique annuel permet de raviver l’intérêt des élèves pour la science notamment.
En 2024, l’événement s’est distingué par un thème original collant à l’actualité sportive des Jeux de Paris. Avec les “Jeux Astrolympiques”, les élèves ont imaginé des sports pratiqués sur d’autres planètes. Ce projet, soutenu par l’Agence spatiale européenne et le programme éducatif ESERO, propose une approche ludique et engageante des sciences.
Au collège George Sand de Toulouse, les élèves de la classe de Cédric Marmande ont ainsi conçu le “Footsket”, un sport hybride mêlant football et basket et adapté aux conditions martiennes. Cette expérience leur a permis de développer des compétences dans plusieurs domaines – sciences, technologie, mathématiques, sport – tout en renforçant leur travail en équipe et leur estime de soi.
Les retours des collégiens sont enthousiastes. Non seulement, ils ont découvert des notions scientifiques de manière amusante, mais ils ont également présenté leurs projets devant un public lors du Congrès scientifique des enfants à la Cité de l’espace et ont été récompensés pour leurs efforts.
Ce type de projet, qui allie éducation et plaisir, pourrait bien être l’avenir de l’enseignement des sciences en France, en rendant les apprentissages plus concrets et motivants pour les élèves. Donnant ainsi un nouvel élan à l’éducation scientifique. Le congrès scientifique des enfants sera de retour en 2025 et à chaque année scolaire.
Gaëlle Giesin est ingénieure au CNES et vice-championne du monde de parachutisme. Elle se prépare par ailleurs pour un record du monde à couper le souffle. Passionnée par l’exploration sous toutes ses formes, elle vise en effet à battre le record du monde féminin de plongée en recycleur.
Cette technique permet de respirer en boucle fermée grâce à un système d’électronique et de chaux qui capte le CO2. Actuellement fixé à 198 mètres, le record de 200 mètres sera-t-il battu dans les prochains jours ? Un exploit jamais réalisé par une femme.
Le recycleur est un équipement de plongée avancé qui présente de nombreux avantages. Contrairement aux bouteilles classiques, il permet de réduire les coûts, notamment grâce à une moindre consommation d’hélium, un gaz coûteux.
De plus, il est silencieux et ne produit pas de bulles, ce qui minimise son impact sur la faune et la flore sous-marines. Cela permet une interaction plus harmonieuse avec l’environnement et prolonge l’autonomie des plongeurs.
Gaëlle établit un lien fascinant entre son défi et son travail au CNES. Elle explique que les plongeurs et les astronautes partagent des similitudes dans leur préparation et leur équipement. Les deux utilisent en effet des systèmes de respiration en circuit fermé et doivent suivre des procédures strictes pour gérer les niveaux de CO2. De plus, les expériences en plongée profonde peuvent apporter des pistes précieuses d’amélioration pour les sorties extravéhiculaires dans l’espace.
Cette tentative de record pourra ainsi faire avancer la science.
Le livre “Science en 4 saisons “, publié aux éditions EDP Sciences, répond à des questions que nous nous posons tous les jours, comme “faut-il courir ou marcher sous la pluie pour être le moins mouillé possible ?”. Antoine Guitton y apporte des réponses simples et claires, expliquées par la science, et issues de ses chroniques radio.
La vulgarisation scientifique est au cœur de l’ouvrage d’Antoine Guitton. Le tout, sans équations, mais avec des explications simples et des illustrations amusantes. Il répond par exemple aux questions suivantes : « pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ? », « quelle est la différence entre le verglas et le gel », ou encore « comment aider le Père Noël à descendre plus facilement dans la cheminée ? ».
Antoine Guitton intervient également dans les écoles pour partager sa passion, expliquer comment la science peut aider à résoudre les défis du quotidien et même sauver le monde. Avec son approche humoristique et décalée, il rend la science attrayante.
Le livre “Science en 4 saisons” est le fruit d’une collaboration avec un étudiant en art de Bruxelles, qui a réalisé les illustrations. Ensemble, ils ont créé un ouvrage qui mélange humour et rigueur scientifique. Ce manuel accessible et instructif fournit des réponses simples à de nombreuses petites questions du quotidien.
En 2018, plus de cinq tonnes de déchets étaient produits par habitant et par an, d’après le ministère de la Transition écologique. Alors, pour mieux les traiter et agir pour limiter l’impact de l’homme sur la planète, il est important d’en connaître leur histoire, dans l’humanité et l’univers.
Dans « L’Odyssée des déchets du big bang à nos jours », publié aux éditions Quae, Christian Duquennoi raconte l’histoire des déchets d’un œil scientifique. Le chercheur de l’INRAE est passionné d’archéologie, de sciences humaines et de physique.
Le mot “déchet” désigne ce qui est rejeté comme n’ayant pas de valeur. Cependant, avec le recyclage, cette notion change. Les déchets négatifs peuvent être désormais perçus comme une ressource précieuse. Cette perspective est d’ailleurs explorée par Christian Duquennoi.
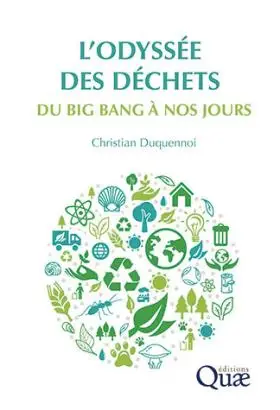
Les déchets ont toujours fait partie de la vie sur Terre. Christian Duquennoi conduit ici le lecteur dans un voyage à travers le temps, montrant que même les étoiles produisent des déchets. Le livre permet ainsi de comprendre l’évolution des déchets et leur rôle dans l’histoire. Car les déchets sont indissociables de la vie sur Terre. Chaque vie, depuis la nuit des temps, produit des déchets. Et chaque vie a une histoire intimement liée aux déchets. Mais leur perception et leur traitement a nettement évolué dans l’histoire.
Les premières civilisations sédentaires accumulaient leurs déchets, comme les amas coquilliers. Ces déchets étaient alors érigés comme preuves de richesse, en montagnes de coquillages. Ces déchets offrent un aperçu précieux de la vie quotidienne de nos ancêtres. Aujourd’hui, les déchets modernes reflètent d’ailleurs nos modes de vie et de consommation.
Voici une idée de collection de livres pour vous accompagner pendant les vacances d’été. Il n’est pas forcément facile de comprendre la science quand on n’est pas soi-même scientifique. Pourtant, il existe des ouvrages qui peuvent nous faire approcher les plus grands concepts et expliquer l’histoire des plus grandes idées, de façon très simple.
C’est le cas de la collection A la plage, proposée par les éditions Dunod. Parmi ces livres « Hawking à la plage : l’univers dans un transat », ou « Galilée à la plage : l’astronomie dans un transat »., dont nous parle son auteur, Arnaud Cassan. Lire ces livres, c’est comme apprendre la science dans un transat !
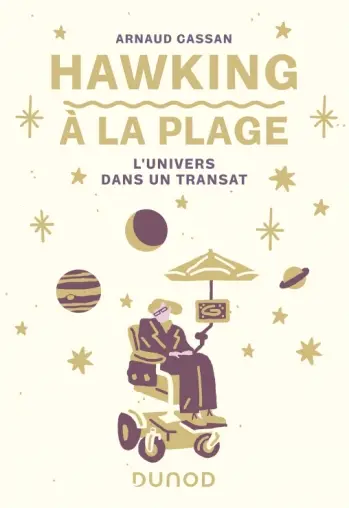
L’idée de départ est l’écriture scientifique. Raconter l’histoire d’une pensée scientifique et de son évolution. Expliquer comment telle ou telle idée sur l’univers, l’astronomie, les mathématiques ou même philosophiques sont nées. Pour Arnaud Cassan, « suivre un grand savant célèbre, comme Galilée ou Hawking, c’est aussi une manière de se laisser guider. De ne pas appréhender la connaissance sous forme de points : chapitre 1, chapitre 2. Mais au contraire de suivre l’évolution d’une pensée dans un contexte scientifique historique. Et, comme ça, de progressivement voir les idées germer. Et se laisser bercer au fil des pages. »
La collection À la plage des éditions Dunod permet une lecture divertissante et accessible sur des sujets sérieux et variés : psychologie, sciences, philosophie, histoire, et bien d’autres. Voici quelques titres : « Confucius à la plage », « Neandertal à la plage », « Tesla à la plage », « Hawking à la plage », etc
Un phénomène rare, habituellement réservé aux chanceux des pôles Nord et Sud. Les aurores boréales, ou aurores australes en fonction de l’endroit où on les observe, sont un phénomène intimement lié à l’activité du Soleil. Ce phénomène, habituellement réservé aux pôles, a pu être observé en France ces derniers mois. Il est dû au pic d’activité du Soleil dirigé vers notre Terre. Cette activité intense permet au phénomène d’être visible depuis d’autres lieux sur la planète.
Ce phénomène tout à fait normal provient du vent solaire. Ainsi, lors de ses pics d’activité, le Soleil dégage des éjections de particules. Puis, ces particules entrent en contact avec la haute atmosphère de la Terre et créent une réaction électrique. Ce qui provoque des aurores lumineuses.
Jean Lilensten est chercheur au CNRS, à l’institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble. Spécialiste des aurores boréales et australes, il explique que ces couleurs sont dues à la vitesse de l’éjection de matière et à la hauteur de leur rencontre avec l’atmosphère terrestre.
« Si les électrons arrivent lentement, c’est-à-dire autour de 700 000 km/heure, ils vont être arrêtés au-dessus de 200 km d’altitude et donc prendre la couleur rouge. S’ils arrivent à une vitesse un peu plus élevée, 1 500 000 km/heure environ, l’énergie se manifestera sous forme de lumière verte. Et s’ils arrivent entre 3 et 5 millions de kilomètres/heure, ils descendront plus bas dans l’atmosphère. »
Entre 80 et 100 km d’altitude, ils heurteront des éléments chimiques différents, produisant une lumière mauve et bleue. Le tout donnant lieu à un spectacle extraordinaire !