
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Notre sommeil s’est dégradé ce dernier siècle. Et le mode de vie qui découle de l’arrivée du Covid-19 n’a fait qu’accentuer ce phénomène. Il est donc primordial de réapprendre à dormir. C’est que nous propose la science dans le livre du professeur Pierre Philip. Il vient de publier le livre « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé » avec des fiches courtes et pratiques.
On peut logiquement se poser la question de la légitimité de la sieste, lorsqu’on souffre d’une dette de sommeil. Est-elle utile et combien de temps doit-elle durer pour être efficace ?
L’artiste espagnol Salvador Dalí adorait faire la sieste. Mais uniquement des micro-siestes. Il utilisait d’ailleurs une méthode bien particulière pour ne pas trop dormir et ne pas dérégler son horloge biologique. Pour faire une sieste des plus efficaces, c’est-à-dire très courte, il ne faut pas excéder les 10 à 15 minutes. L’artiste disposait ainsi une assiette au sol et s’endormait sur son fauteuil avec une cuillère ou une fourchette dans la main. Et se réveillait dès le moment où il lâchait l’ustensile, qui tombait alors sur l’assiette. De cette façon, il était sûr de se réveiller après seulement quelques minutes, pour une sieste optimale.
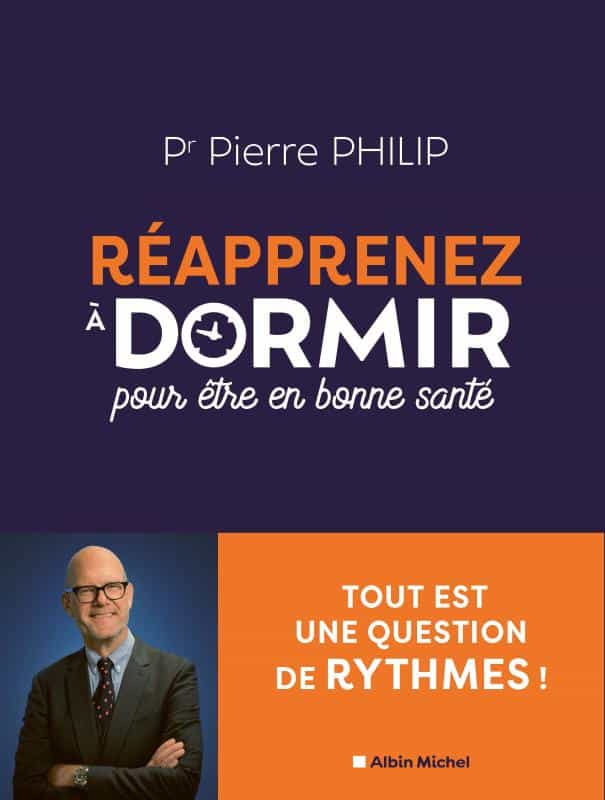
C’est d’ailleurs la conclusion des recherches scientifiques. La sieste ne doit pas durer plus de 10 à 20 minutes maximum. Mais elle doit être ponctuelle, car elle est le signe d’un dérèglement du sommeil.
Pour bien dormir, il existe quelques méthodes simples, comme la règle des 17 heures d’éveil minimum. Mais également les trois piliers principaux : la régularité, la durée et la qualité que nous explique le Pr Philip.
Cliquez ici pour plus d’articles sur le sommeil et nos conseils bien dormir…
La régularité, la durée et la qualité… Voici les trois piliers fondamentaux, les trois secrets pour un sommeil optimal et réparateur. C’est en tout cas ce que considèrent la science et les dernières recherches du professeur Pierre Philip. Il vient de publier le livre « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé », aux éditions Albin Michel.
Le sommeil est une composante fondamentale de notre bien-être et de notre santé, qu’elle soit physique ou psychique. Mais en France, une personne sur trois serait concernée par un trouble du sommeil.
Alors, comment retrouver des nuits sereines et reposantes ? Existe-t-il des méthodes ?
Le sommeil sur la planète se détraque depuis un demi-siècle. Et il a pris un nouveau tournant depuis le premier confinement de mars 2020, engendrant le « jetlag social ».
Sept heures de sommeil minimum sont généralement nécessaires pour bien récupérer et se sentir en forme au réveil. Mais il est également important que les heures de coucher et de lever soient régulières. Or, désormais de plus en plus de personnes accumulent une dette de sommeil en semaine, et essaient tant bien que mal de la récupérer le week-end.
Mais heureusement, le Pr Philip, psychiatre et spécialiste du sommeil a de précieux conseils à nous donner dans ce podcast.
Connaissez-vous ces initiales : INRAE ? L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est une organisation créée en 2020 pour relever les défis de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. La science pour la vie, l’humain et la terre. Un rôle essentiel pour l’évolution de l’humanité, en harmonie avec notre planète. L’INRAE a décidé de partager ses connaissances et d’ouvrir la réflexion au grand public. L’organisation a ainsi créé « Ressources », un magazine sur les actualités scientifiques de l’INRAE.
À une époque où la rapidité de circulation et de traitement fausse parfois l’information, l’INRAE propose de nous arrêter sur des sujets de société qui nous concernent tous. La revue “Ressources” vise à informer, décrypter, donner à réfléchir.
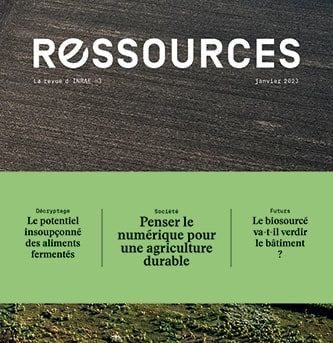
Avec, dans chaque numéro, trois dossiers développés à partir de travaux de recherche. Le magazine « Ressources » propose des chiffres clés, des infographies, une synthèse des travaux des scientifiques et des références pour renforcer nos connaissances, favoriser l’analyse et donner des perspectives aux enjeux d’avenir.
La revue est disponible en librairie.
Aliette, Maillard directrice adjointe de la communication à l’INRAE, nous en parle.
Elle est là, sous nos yeux. Invisible, mais pourtant perceptible, par ses effets sur l’univers et la matière visible. La matière noire et l’énergie sombre constituent le maillon manquant à notre compréhension de l’univers qui nous entoure. C’est « La plus grande énigme de l’astronomie » (éditions EDP Sciences), le titre du livre de l’astronome suisse André Maeder.
Une énigme passionnante dont il retrace l’histoire, de sa naissance à ses différentes théories. Également les questionnements qu’elle implique. Pourquoi toute la matière de l’univers ne s’est-elle pas rassemblée en un seul paquet ? Telle est la fameuse question qu’en 1692 le Dr. Bentley posa à Newton. En 1917, Einstein rencontra aussi le problème posé par Bentley.
Pour le résoudre, il inventa une force répulsive soutenant l’univers face à la gravitation. Dans les années 1930, Einstein retira cette force et la considéra comme la plus grande erreur de sa vie. Coup de tonnerre en 1998 avec la découverte que cette force existe vraiment et contribue pour 70 % à la masse-énergie de l’univers. C’est la fameuse « énergie noire » qui, avec la « matière noire » trouvée dans les années 1980, forme 95% de la masse-énergie. On ignore la nature de ces deux composantes noires, objectif majeur des recherches astronomiques et de physique des particules.
Ce livre retrace de manière simple et claire cet étonnant chemin qui va de la question de Bentley, jusqu’à son évolution actuelle.
André Maeder, auteur de ce livre et astronome suisse, revient avec nous sur la plus grande énigme de l’astronomie : d’où proviennent l’énergie noire et la matière noire qui composent 95 % de notre univers ?
En 2023 aussi, la science nous réserve de bonnes surprises ! Parmi elles, un vaccin contre le Covid-19, au niveau du système respiratoire. Celui-ci serait d’ailleurs particulièrement efficace chez la souris. Moins connue du grand public, la “vaccination mucosale” (au niveau des muqueuses) pourrait fournir une protection robuste aux infections par le SARS-CoV-2.
En effet, les cellules immunitaires localisées dans le nez et les poumons seraient ainsi mieux préparées à rencontrer et à bloquer le virus responsable du Covid-19. Une équipe de recherche internationale vient justement de démontrer que son vaccin nasal à base d’ADN est capable d’assurer la survie totale d’un groupe de souris infectées par une version du virus adaptée à cette espèce, alors que celui-ci décime habituellement 100 % des souris non vaccinées.
Cette vaccination au niveau des muqueuses se fait soit dans le nez soit directement dans les poumons, par un spray qui projette des gouttelettes.
Mis au point grâce à une équipe de chercheurs du CNRS au laboratoire Modulation des réponses immunitaires et inflammatoires, ce vaccin agit d’une façon proche de celle des vaccins ARN utilisés à l’heure actuelle. L’ADN délivré entre dans les cellules cibles, leur faisant produire une protéine du SARS-CoV-2. Cela permet au système immunitaire de se préparer en produisant des anticorps contre le virus. L’efficacité du vaccin dans la transmission du virus n’a pas été mesurée dans cette étude publiée en ligne dans Biomaterials.
Cependant, les scientifiques espèrent qu‘une méthode de vaccination basée sur ce principe pourrait compléter la stratégie actuelle, en apportant une meilleure protection contre la transmission.
Bruno Pitard, de cette équipe de recherche au CNRS, nous parle de cette découverte.
Antoine Balzeau et un paléoanthropologue passionné. Cette discipline est une branche de l’anthropologie, qui étudie l’évolution de l’être humain et les différentes étapes qui ont conduit l’homme à être ce qu’il est aujourd’hui.
Sa passion, Antoine Balzeau souhaite la partager avec le plus grand nombre. C’est la raison pour laquelle il a publié plusieurs livres et créé un site Internet sur lequel il diffuse son savoir sur l’évolution de l’homme et les dernières actualités en la matière.
Mais ce chercheur passionné ne s’est pas arrêté là. Dans sa quête de partage de savoir et d’amusement, il vient de créer Le Mystère Marcellin Darwin. Cet escape game, situé à Gometz-le-Châtel en Essonne, mêle paléoanthropologie, enquête, et éco-responsabilité. Le tout, dans une ambiance bon enfant.
Voici le pitch de l’escape game : « Un des fossiles humains les plus importants, le crâne de l’homme de Florès sur lequel travaillait le paléoanthropologue Antoine Balzeau, a disparu. On suspecte son étudiant Marcellin Darwin, pourtant brillant et sans histoire, d’être l’auteur du larcin. Grimés en employés de l’entreprise de nettoyage Green Clean, vous aurez une heure seulement pour découvrir si ces soupçons sont fondés et comprendre pourquoi le crâne a été subtilisé… »
Et si, un jour, un astéroïde venait menacer notre planète ? Ce scénario catastrophe rappelle plusieurs films comme “Armaggedon”, “Deep Impact”, etc. La science-fiction est devenue réalité, il y a quelques semaines avec la mission Dart.
Un vaisseau de la NASA s’est ainsi écrasé à 24 000 km/h sur un astéroïde. Le tout, à 11 millions de kilomètres de la Terre ! Cette incroyable prouesse a été réalisée, il y a quelques semaines, lors de la mission Dart de la NASA. Dart – fléchette en anglais – signifie « Double Astéroïd Redirection Test », c’est-à-dire : test de redirection d’un astéroïde double. En effet, ce vaisseau a percuté la petite « lune » d’un astéroïde plus imposant.
Le but était de tester dans des conditions réelles notre capacité de réaction pour protéger la Terre en cas de menace par un astéroïde croisant notre orbite.
Exploit réussi : la NASA a donc provoqué un impact sur l’astéroïde Dymorphos, 160 mètres de diamètre. L’objet a été frappé dans le sens inverse de sa rotation, entrainant un net ralentissement et donc, une variation d’orbite. L’impact a été extrêmement précis pour viser un petit objet de cette taille à plus de 11 millions de kilomètres de distance de la Terre.
Olivier Sanguy, spécialiste astronomie à la cité de l’espace, revient sur cette mission.
Notre Terre, que l’on surnomme « la planète bleue », est recouverte à 70% par des océans. Et les fonds océaniques sont si étendus que nous n’en avons pour l’instant exploré qu’une très infime partie : à peine 5%. Nous ne connaissons ainsi que 65% de notre planète. D’ailleurs, les océans qui recouvrent la terre sont si profonds, qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de les cartographier.
Hydrologie et océanographie : ce sont les deux mots qui résument les principales missions du nouveau satellite SWOT qui vient d’être déployé. Un satellite qui emporte à son bord Doris, un bijou de technologie ! Ce radar altimétrique et interférométrique de toute nouvelle génération est capable de mesurer avec une précision incroyable la hauteur des fleuves et des océans de notre planète. Et ceci, grâce à un nouveau procédé : « la large fauchée ». Comme nous l’expliquent Thierry Lafon et Pascale Ultré-Guérard du CNES, cette large fauchée est une bande de mesure beaucoup plus étendue que les satellites actuels, couvrant 120 km de large.
Cette mission sera essentielle pour notre connaissance de l’eau sur Terre, mais également pour les enjeux du futur, avec le réchauffement climatique, la sécheresse et la montée des eaux.
On parle de plus en plus d’espèces en voie de disparition. Mais il faut souligner que certaines autres réapparaissent ! C’est le cas du léopard d’Anatolie, une espèce que l’on croyait éteinte depuis les années 70. 50 ans qu’on avait perdu sa trace. Mais il a de nouveau été aperçu récemment, en Turquie.
Le nombre de tigres sauvages, aussi, continue d’augmenter sur la planète. Un bond de 40% qui s’explique par une nouvelle méthode de comptage mais également par des plans de conservation de l’espèce notamment au Népal. En France, aussi, le loup gris continue sa progression.
Une cornée bio artificielle a quant à elle pu rendre la vue à des patients aveugles. Grâce à une étude pilote en Suède, des implants à partir de cellules de porc ont permis à la totalité des patients en phase de test de retrouver la vue.
Autre nouvelle qui donne un grand espoir pour les prochaines années. Le rôle des vaccins à ARN dans la lutte contre le cancer. Une équipe de chercheurs américains a réussi à mettre au point un vaccin ARN avec d’excellents résultats sur des souris atteintes de mélanome métastatique. C’est-à-dire de tumeurs cancéreuses. Ces tumeurs, suite à l’effet du vaccin, ont été significativement inhibées. Et 40% des souris ont montré des signes de rémission complète sans récidive.
Et les microplastiques ? La science est en train de découvrir des procédés naturels pour filtrer et détruire les microplastiques qui envahissent notre planète. Notamment des extraits de plantes qui permettent de filtrer les particules dans des eaux usées. Mais également la découverte d’une larve mangeuse de plastique.
Ça s’est également passé cette année. Des jeunes diplômés d’AgroParisTech ont prononcé un puissant appel à déserter la voie qui leur était tracée. Refusant ainsi « des jobs destructeurs » pour l’humanité et la planète. Une décision qui prouve la prise de conscience globale qui est en train de naître partout sur la planète.
2022 a aussi été l’année où l’on a eu l’impression d’ouvrir les yeux sur notre univers. Avec les premières images du télescope spatial James Webb, qui nous prouvent qu’il va certainement révolutionner l’astronomie. On le surnomme d’ailleurs le télescope du siècle ! Ces images d’une incroyable netteté permettront des avancées spectaculaires dans notre compréhension de l’univers.
Nombreuses ont été les bonnes nouvelles de la science en 2022. Alors on attend celles de 2023 avec impatience.
Peut-on augmenter notre concentration ou nos capacités physiques, par exemple, en modifiant notre environnement sensoriel ? C’est la question que se pose en ce moment Roxane Bartoletti. Cette dernière est doctorante à l’université Côted’Azur. Elle travaille actuellement, pour sa thèse en psychologie cognitive expérimentale, sur la multi sensorialité. Autrement dit, les rôles et influences de nos sens sur nos capacités cognitives.
Durant sa thèse, elle s’est rendu compte que la réponse à cette question ne peut pas être très tranchée. Car si certaines personnes réussissent à mieux accomplir une tâche en étant dans leur zone de confort, avec des musiques habituelles, d’autres peuvent réaliser plus rapidement cette tâche en étant dans un environnement désagréable avec une musique ou des odeurs qu’elles n’apprécient pas.
Mais quoi qu’il en soit, c’est bien ici la preuve que notre environnement peut jouer un rôle sur nos capacités.
Nous en venons également à nous poser la question de la perception. Pourquoi ces personnes réagissent de façon différente ? Est-ce simplement une question de goût, ou de différence de perception ? Avons-nous la même perception de cette couleur bleue du ciel, ou des notes de cette musique ? La question mérite encore d’être creusée, afin de savoir si nous avons tous la même perception du monde qui nous entoure.
Certaines études scientifiques viennent de mettre en évidence que se mettre volontairement en état de peur contrôlée, de façon ponctuelle et mesurée, aurait des effets bénéfiques.
Sécrétion d’endorphine et d’adrénaline, angoisse contrôlée, activation des neurotransmetteurs, meilleure gestion du stress, préparation à des situations critiques, dopamine et sérotonine libérées… les bienfaits seraient nombreux.
Certains chercheurs projettent même d’utiliser les films d’horreur dans le cadre de désensibilisation à des phobies. N’ayons pas peur d’avoir peur, c’est un peu ce que l’on peut apprendre de cet entretien avec l’hypnothérapeute Jérôme Miranda.
La peur est une émotion normale et même indispensable à la survie de notre espèce. Sans peur, l’homme n’aurait pas survécu. Car c’est cet état d’alerte qui nous a sauvés de bien des situations difficiles dans l’histoire de l’humanité. La peur est indéniablement liée à l’instinct de survie.
Mais dans un mesurée, bien sûr. Car c’est quand nous sommes en état d’alerte permanente que notre corps et notre cerveau se dérèglent. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’on regarde trop souvent des chaînes d’information qui relaient des actualités anxiogènes à longueur de journée.
Écoutons l’avis et les conseils de Jérôme Miranda, hypnothérapeute.
Position exacte du soleil et de la Lune, mais aussi des planètes du système solaire, et de la Terre. Quelles comètes et astéroïdes s’approcheront de la planète bleue. Les éphémérides, la carte détaillées du ciel et la liste des constellations. Des données pour l’observation de la surface du Soleil, de la Lune et des planètes. La date des éclipses de soleil et de lune, et des phénomènes astronomiques les plus importants de l’année.
Voilà quelques idées de ce qu’on peut découvrir dans le nouveau guide des données astronomiques 2023. Un guide créé par l’IMCCE (Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides) de l’Observatoire de Paris.
Ce guide s’adresse aux professionnels et amateurs passionnés d’astronomie. Il existe également en version plus accessible au grand public, plus novice : sous forme d’agenda pour les non-scientifiques. Cet agenda explique certains phénomènes astronomiques et lumineux comme l’arc-en-ciel par exemple.
Pour l’occasion, nous avons demandé à Pascal Descamps, responsable du service de calculs astronomiques et de renseignements de l’IMCCE, et astronome de l’Observatoire de Paris, de nous parler des observations et phénomènes de l’année 2023.
Saviez-vous, par exemple, que la pluie d’étoiles filantes que l’on adore observer au mois d’août est en fait l’entrée de la Terre dans le nuage de poussière qu’une comète laisse derrière elle en se désagrégeant ?
Après avoir découvert que l’amitié tiendrait en partie à ce détail insolite : l’odeur, les scientifiques étudient le rôle de l’odorat et des molécules dans la transmission d’informations. Et notamment dans la transmission d’émotions positives ou négatives.
En effet, d’après des recherches scientifiques en cours, les molécules des odeurs corporelles pourraient transmettre des émotions ! Ainsi, des émotions positives pourraient se transmettre d’une personne à l’autre, par l’odorat. La signature chimique olfactive de nos molécules induirait donc une modification de sensations entre individus.
C’est-à-dire, de façon simplifiée, que l’odeur d’une personne heureuse pourrait transmettre des émotions positives à une autre personne qui ne l’aurait même pas vue, mais tout juste sentie inconsciemment. Car nous n’avons pas conscience de ce phénomène ni de cette odeur particulière. On pourrait d’ailleurs appeler ça, la « contagion émotionnelle ».
Cela se caractériserait notamment par des changements physiologiques, comme une variation du rythme cardiaque. Mais aussi au niveau comportemental : une sensation imperceptible de bonheur, et même une amélioration des performances dans les tâches de créativité notamment.
L’odeur peut donc faire circuler des émotions et influer sur l’humeur d’autres personnes. L’odorat humain est donc bien plus développé que ce que l’on pouvait imaginer il y a quelques années. Camille Ferdenzi, qui a mené ces recherches au CNRS, s’exprime depuis son laboratoire.
Une récente étude publiée dans la revue “Science Advance” a créé la surprise. Selon les recherches de scientifiques de l’Institut Weizmann des sciences, en Israël, les individus qui partagent une forte amitié pourraient présenter un point commun pour le moins étonnant : leur odeur corporelle.
Et cette odeur, nous pourrions la détecter dès les premières secondes en présence de nos congénères. Ce qui se passerait, serait ensuite, un « coup de foudre amical », d’après la chercheuse Camille Ferdenzi.
Nous aurions donc, comme les animaux, un sens développé de l’odorat inconscient, qui permettrait de reconnaître les odeurs corporelles des autres individus et partagerions des composés de molécules d’odeur semblables, si l’on est amis.
Camille Ferdenzi est chercheuse neurosciences au CNRS, elle travaille également sur l’odorat et les relations sociales. Celui-ci serait beaucoup plus impliqué dans les relations humaines que l’on ne le pensait auparavant. Nous n’en sommes qu’au début de découvertes concernant notre sens de l’odorat. Ce sens serait finalement beaucoup plus développé que ce qu’on pouvait le soupçonner.
L’homme serait donc bel est bien un « animal » à l’odorat puissant, mais n’en aurait pas vraiment conscience.
Ce mercredi 16 novembre, AirZen Radio et son partenaire fondateur Bricomarché vous donnent des astuces pour faire des économies d’énergie à la maison.
Des scientifiques de l’université de Cambridge, en Angleterre, viennent de réaliser un véritable exploit : recharger des appareils connectés, grâce a des algues bleues !
Comment ont-ils pu faire ? C’est la question que nous avons posée à Philippe Potin. Il est directeur de recherche au laboratoire de biologie intégrative des modèles marins au CNRS.
Les algues bleues, sont des cyanobactéries. Grâce à la photosynthèse, elles captent le rayonnement solaire et produisent un courant électrique continu, même lorsqu’il n’y a plus de soleil, pendant la nuit.
Ce courant électrique, les chercheurs ont réussi à le capter et à l’utiliser afin de mettre en charge un microprocesseur. La technique est assez complexe, mais elle pourrait apporter des solutions de production électrique 100% renouvelable et non polluante.
Des expériences similaires ont aussi récemment démontré que des algues et de la végétation pouvaient produire du courant électrique. Cette récente expérimentation ouvre également la voie à de nouvelles techniques pour produire des courants électriques avec de la végétation. Le but étant toujours de s’éloigner le plus rapidement possible des énergies fossiles polluantes.
Les échappées inattendues du CNRS est un nouvel événement visant à favoriser le dialogue autour de la science entre scientifiques et grand public.
Rendez-vous donc ce vendredi 17 et samedi 18 novembre au Centquatre à Paris et sur la chaine Youtube du CNRS.
Ce rendez-vous offre la possible de parler de sciences et de recherches avec celles et ceux qui la font, lors de moments grand public, ludiques et accessibles.
Le CNRS réunit pour cela des scientifiques menant leurs recherches sur les grandes questions ou défis actuels : l’avenir des villes, mais aussi sur des sujets plus surprenants comme la physique des bulles, la vie secrète des fourmis, les mystères de la cathédrale Notre-Dame, la planète Mars, etc.

Les scientifiques proposeront aux visiteurs de découvrir leur univers au travers de récits, d’expériences immersives, d’ateliers et de démonstrations réalisées en direct.
Le programme offre un accès privilégié à la science en train de se faire et à la démarche scientifique, au plus proche du travail mené dans les laboratoires. Ce nouveau dispositif de médiation viendra à la rencontre du grand public partout en France à partir de 2023.
Pour se faire, les échappées inattendues s’articuleront autour de 4 formats : débat grand format, micro-conférence, conférence démo, et conférence immersive.
Explications avec Céline Bézy, du CNRS.
Quelques jours après Halloween, nous vous confirmons que des monstres peuplent bel et bien notre quotidien. Chez nous, dans notre propre maison, voire même sur notre corps, se nourrissant parfois de nos chairs usées.
Ce sont en quelque sorte des « mini-monstres ». Car nous ne les apprécions pas, voulons absolument nous en débarrasser, et nous n’en connaissons d’ailleurs pas grand-chose.
L’exposition “Mini-monstres” vient d’ouvrir ses portes au Muséum d’histoire naturelle, au Jardin des plantes de Paris. Elle nous propose par des jeux ludiques et grandeur nature pour plonger au cœur du monde fascinant des poux, puces, acariens et de nombreux autres insectes minuscules.
Chacun d’entre eux possède des super-pouvoirs, faisant d’eux de véritables super-héros. Le pou, par exemple, est capable de vivre en apnée sur notre tête. La tique, elle, peut jeûner pendant 10 ans. Et la puce est capable de sauter 300 fois sa taille. C’est comme si un homme d’1,80 m sautait à 540 mètres de hauteur !
Grâce à des jeux d’échelles immersifs, vous pourrez approcher de plus près ces espèces insaisissables à l’œil nu.
Différents dispositifs emmènent au-delà des apparences pour mieux connaître ces espèces et comprendre leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes.
Et nous pourrons également glaner quelques précieux conseils préventifs pour éviter les piqûres ou les soulager avec des remèdes naturels.
Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les bonnes idées viennent souvent dans des circonstances pour le moins inattendues. Il vous est certainement déjà arrivé de trouver la solution à votre problème en faisant votre footing, en prenant une douche, ou peut-être même… En vous brossant les dents !
Mais pourquoi, est-ce justement au moment où on semble s’éloigner du problème, qu’il paraît justement s’éclairer ? La science a certainement trouvé l’explication, à ce phénomène.
De récentes études mettent en lumière un mécanisme précis. Lors de tâches habituelles, le cerveau entre dans un mode passif, un peu comme en état de veille. Mais ce n’est qu’en apparence. Car à l’intérieur, les idées et souvenirs les plus lointains bouillonnent, fusent, se croisent et s’entrechoquent pour, parfois, donner naissance à l’idée lumineuse !
Ce moment précis où le cerveau est dans un genre d’état de veille s’appelle le « réseau mode par défaut », un peu comme sur un ordinateur.
Notre cerveau a besoin de ce temps de repos pour classer les souvenirs, les pensées et il en découle parfois la solution à notre problème.
Alors, s’agit-il simplement de ne rien faire pour trouver la solution ? Pas exactement… Suliann Ben Hammed est directrice de recherche au CNRS, et elle nous explique les mécanismes de notre cerveau.
Le télescope James Webb est en service depuis quelques mois. Le JWST pour James Webb Space Telescope a été conçu par la NASA, avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC). C’est le télescope spatial le plus puissant, le plus grand et le plus cher jamais construit. Il va poursuivre et affiner les travaux du télescope spatial Hubble, opérationnel depuis les années 90.
Ses missions sont nombreuses : déterminer l’évolution des galaxies, de leur formation jusqu’à nos jours. Observer la formation des étoiles. Mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires. Rechercher les composants nécessaires à l’apparition de la vie dans l’atmosphère des exoplanètes. Et chercher les premières étoiles et galaxies apparues dans l’univers, au plus près du Big Bang…
Et on peut dire que, pour l’instant, James Webb émerveille les scientifiques par la qualité de ses images, plus merveilleuses les unes que les autres. Des clichés de planètes, de galaxies, et de nébuleuses, plus incroyables les unes que les autres.
Il aura fallu 20 ans et près de 10 millions de dollars pour faire de James Webb un télescope aussi pointu. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le JWST a déjà surpris à plusieurs reprises par ses fantastiques observations. Notamment en détectant du CO2 dans l’atmosphère d’une exoplanète.
Olivier Sanguy, spécialiste de l’astronautique à la cité de l’espace à Toulouse, nous en dit plus sur le James Webb.
C’était le 21 juillet 1969… Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se posaient sur la surface de la Lune pour la première fois dans l’histoire de l’humanité. Cela fait donc plus de 50 ans que l’homme n’est pas revenu sur le satellite de la planète Terre.
La mission Artémis de la NASA verra donc le retour de l’homme très prochainement sur la Lune. Ce retour se fera en trois étapes distinctes :
Les objectifs de cette mission sont multiples : en apprendre plus sur la terre primordiale, car la Lune n’est autre qu’un morceau de Terre encore stérile, qui avait été propulsé il y a des milliards d’années dans l’espace, lors d’un choc cataclysmique la Terre et une autre planète. Nous en apprendrons donc encore plus sur notre planète en effectuant des expériences sur la Lune.
Autre but scientifique : mesurer la résistance de l’homme et de l’organisme, la vie sur une autre planète, dans le but de conquérir Mars dans un futur proche. Un camp de base pourra donc être créé sur la Lune pour faire une étape de ravitaillement, avant d’aller se poser sur Mars.
Cette mission fait également rêver un bon nombre de personnes et sera un moteur pour la nouvelle génération, pour s’engager dans la voie scientifique.
Voici plus de détails avec Olivier Sanguy, spécialiste des questions spatiales à la Cité de l’Espace de Toulouse.