
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Emmanuelle Rigeade, infirmière puéricultrice, est aussi coordinatrice de l’application May, sur laquelle des professionnels répondent aux questions des parents, de la grossesse à l’entrée à l’école. Elle est également l’autrice des « Vrais besoins des jeunes enfants (et de leurs parents) », paru aux éditions Dunod. Concernant la santé environnementale, il est recommandé d’être prudent avec les produits de nettoyage et les toxines potentiellement nocives qu’ils peuvent contenir.
Notamment, « ce qu’on appelle des COV, des composés organiques volatils, qui sont toxiques pour le bébé. On va préférer des produits de ménage, qui ne vont pas en contenir. Donc, plutôt naturels, faits maison avec un savon naturel et de l’eau ou éco-labellisés », explique Emmanuelle Rigeade.
L’utilisation d’huiles essentielles pour parfumer les produits de nettoyage est généralement déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans. La consultante en puériculture et en parentalité suggère par ailleurs une alternative : « Vous glissez quelques gouttes de citron, par exemple, dans votre produit ménager fait maison. Cela donnera une odeur de propre. »
Pour les rénovations ou l’achat de nouveaux meubles, Emmanuelle Rigeade recommande de choisir des matériaux sans COV et de permettre une période de dégazage d’au moins trois mois avant d’introduire le bébé dans la pièce rénovée. Les jouets en matériaux naturels et aux normes de sécurité sont aussi à privilégier. Si la maman enceinte souhaite participer aux travaux, elle doit absolument mettre un masque et des gants. Idéalement, elle ne participe pas.
Concernant l’alimentation, l’infirmière puéricultrice souligne l’importance de choisir des biberons en verre ou en plastique sans bisphénol. Elle conseille également de surveiller attentivement la qualité de l’eau utilisée pour préparer les biberons. « L’alimentation infantile en France est de très bonne qualité. […] Vous pouvez donner sereinement des petits pots à votre bébé. »
Concernant les produits de soin pour bébé, Emmanuelle Rigeade conseille de privilégier des produits bio ou naturels. Elle recommande aussi de limiter l’utilisation de substances contenant des additifs potentiellement nocifs. L’infirmière puéricultrice conseille également d’utiliser des huiles végétales comme l’huile de tournesol pour masser les bébés. « Évitez les huiles à base de fruits à coque, comme l’huile d’amande douce. »
L’invitée.

Emmanuelle Rigeade est infirmière puéricultrice, diplômée en psychologie de l’enfant et en psychologie de la parentalité, formée aux neurosciences et à la santé environnementale. Elle cumule plus de vingt années d’expérience de soins à l’enfant (et d’accompagnement de leurs parents) en pédiatrie, en néonatalogie, aux urgences pédiatriques, en psychiatrie de l’enfant et en libéral. Emmanuelle Rigeade coordonne actuellement une équipe de soins pour May, une plateforme digitale de soutien à la parentalité, et exerce toujours en libéral pour accompagner les parents dans l’accueil du nouveau-né et à la parentalité.
Elle est l’autrice des « Vrais besoins des jeunes enfants (et de leurs parents) », paru aux Éditions Dunod.
La suivre sur Facebook et Instagram
Retrouvez tous nos contenus sur la grossesse ici…
Christine Zalejski, docteure en biologie spécialisée en diversifications et éducation alimentaire infantile, partage avec nous son expérience et ses connaissances. Elle est l’autrice de « L’Éducation alimentaire positive pour les 0-6 ans », paru chez Thierry Souccar éditions.
Selon Christine Zalejski, il est tout à fait normal que les enfants traversent une période de néophobie alimentaire, de leurs 18 à leurs 24 mois. “Néo, ça veut dire Nouveau. Phobie, cela veut dire Peur. C’est donc le tout-petit qui commence à avoir peur des choses qu’il ne connaît pas bien. Ce qui est tout à fait normal […] C’est la même chose pour nous, en tant qu’adulte. On a moins peur de ce que l’on connaît bien”, explique-t-elle.
L’experte encourage les parents à partager les repas en famille. En effet, l’exemple des parents est essentiel pour l’éducation alimentaire des enfants.”L’humain apprend par l’exemple. Donc si papa et maman mangent varié et équilibré, l’enfant sera plus enclin à faire de même.”
Christine Zalejski recommande d’introduire les morceaux dans l’alimentation du tout-petit dès la diversification. “Il est important de ne pas tarder à introduire les morceaux, car cela aide l’enfant à développer ses capacités de mastication et à découvrir de nouvelles textures.” Il n’est pas nécessaire d’attendre que les premières dents de l’enfant aient poussé. Ainsi, « on va texturer ses purées. C’est-à-dire qu’on va enlever beaucoup d’eau de cuisson pour que la purée soit bien épaisse, pour qu’il soit obligé, entre guillemets, de faire ces premiers mouvements de mastication. »
Votre enfant recrache un peu les aliments ? C’est normal au début. Mais si la situation s’éternise, n’hésitez pas à consulter un médecin. « Il peut y avoir une problématique au niveau de la langue, des dents ou une douleur quelque part qui ferait que l’enfant ne déglutit pas. »
“Il est normal que les enfants soient parfois réticents à essayer de nouveaux aliments. Mais il est important de ne pas se décourager et de continuer à leur proposer une variété d’aliments.” Christine Zalejski encourage les parents à rester positifs et à valoriser les efforts de leur enfant.
L’enfant joue avec la nourriture ? « C’est quelque chose d’essentiel pour lui. Tous les mammifères de la planète jouent pour apprendre. Il faut laisser aussi nos enfants jouer. » Vous pouvez cependant lui expliquer que « quand la nourriture est tombée par terre, après, on ne peut plus la manger parce qu’elle a été salie. Donc il ne faut pas réitérer la chose. » Il suffit de « le répéter gentiment sans que ça soit une punition ».
L’invitée.

Christine Zalejski est docteure en biologie, spécialisée en diversifications et éducation alimentaire infantile. Fondatrice du site et de l’organisme de formation Cubes et Petits pois, elle accompagne avec pédagogie et simplicité depuis 2010 les parents et les professionnels de la santé et de la petite enfance à apprendre à bien nourrir bébé.
Son approche repose à la fois sur la connaissance des besoins de l’enfant, la mise en place d’une éducation alimentaire dès le plus jeune âge et le lien que l’enfant tisse avec son alimentation et son accompagnant au moment du repas. Elle est l’autrice de « L’Éducation alimentaire positive pour les 0-6 ans », paru chez Thierry Souccar éditions.
La suivre sur Facebook et Instagram
Jules Fougère, le pédiatre le plus suivi des réseaux sociaux, alias Ped.Urg, a écrit « Mon guide anti-paniqu : Brûlure, chute, fièvre… 50 fiches pour savoir quand courir aux urgences pédiatriques », paru aux éditions Marabout.
Le Docteur Jules Fougère partage la technique du Quick Look qui est « utilisée par les professionnels de santé pour savoir si un enfant doit rapidement être vu par un médecin des urgences ou s’il peut patienter en salle d’attente ». Cette technique se résume en trois lettres CRC : Conscience, Respiration, Coloration. « Si l’enfant a un comportement plutôt habituel, qu’il est bien éveillé, s’il respire correctement et s’il est rose, on peut se dire que le Quick look est normal, on a donc le temps de réfléchir. Par contre, si l’enfant est somnolent, pas comme d’habitude ou qui respire mal, voire même pâle ou cyanosé, c’est-à-dire qu’il a les lèvres bleues, là, on doit réagir. » Il est alors impératif de consulter rapidement aux urgences pédiatriques.
En cas de maladie ou de symptômes chez l’enfant, Ped.Urg encourage les parents à contacter leur médecin traitant en premier lieu. Si ce n’est pas possible, des alternatives comme la prise de rendez-vous en ligne avec d’autres médecins ou l’appel du 116 117 pour être dirigé vers un médecin disponible peuvent être envisagées. Si des hésitations persistent sur le degré d’urgence de l’état de l’enfant, il est conseillé de composer le 15. Ce numéro d’urgence médicale peut être contacté pour des conseils médicaux, évitant ainsi des déplacements inutiles aux urgences pédiatriques.
“Si on peut éviter d’arriver aux urgences en pensant que son enfant va bien, cela évite d’attendre pendant des heures et de potentiellement contracter d’autres maladies en salle d’attente”, souligne le Dr Jules Fougère.
“La température n’est jamais un critère de gravité, jamais. C’est la tolérance de l’enfant qui doit inquiéter les parents”, souligne le médecin. Ainsi, un enfant peut avoir une température élevée, comme 40 degrés, sans que cela ne soit nécessairement grave, tant que la fièvre est bien tolérée.
Ped.Urg souligne l’importance de l’âge dans la gestion de la fièvre chez les enfants. Les bébés de moins de 3 mois sont ainsi plus susceptibles d’attraper des infections bactériennes, pouvant nécessiter des antibiotiques. Au-delà de 3 mois, le système immunitaire se renforce et les infections virales deviennent plus fréquentes, généralement moins graves et ne nécessitent pas toujours de traitement.
Docteur Fougère insiste sur la notion de tolérance à la fièvre après 3 mois. Si l’enfant semble bien tolérer la fièvre, sans présenter de signes de mauvaise tolérance tels que la cyanose, les marbrures, des tremblements prolongés, ou des pertes de connaissance, il est généralement possible de patienter et de contacter le médecin généraliste sans urgence.
Un traumatisme crânien peut être bénin ou grave, en fonction de la présence ou non de saignements internes. Les signes à surveiller sont la somnolence anormale, les vomissements répétés, la douleur persistante, la perte de connaissance et les troubles de la parole et du mouvement.
“Si l’enfant se cogne la tête, mais ne présente pas ces signes, on peut se permettre de le surveiller à la maison pendant 24 heures, à condition que ces signes n’apparaissent pas”, explique le Docteur Jules Fougère.
Ped.Urg rappelle également que la noyade sèche, lors de laquelle un enfant pourrait mourir dans son sommeil, sans signe avant-coureur, quelques heures ou quelques jours après avoir bu la tasse, n’existe pas. Toutefois, dans de très rares situations, un enfant qui boit la tasse peut présenter une pneumopathie dans les huit premières heures. « Dans ce cas, l’enfant présente une gêne respiratoire, avec une toux, de la fièvre et des signes de lutte respiratoire. Vomissement, pâleur ou bleuissement des lèvres peuvent aussi apparaître. Il faut alors se rendre aux urgences.
Enfin, le Docteur Fougère encourage les parents à se méfier des remèdes de grand-mère non fondés et des mythes circulant sur Internet. Il rappelle ainsi que la vigilance, la connaissance des signes de tolérance à la fièvre et la consultation précoce si besoin sont essentielles pour assurer la santé et le bien-être des enfants.
L’invité.

Jules Fougère, plus connu sous le nom Ped.Urg, est un pédiatre urgentiste normand de 29 ans, qui a fait ses études et exerce à Rouen. Il y a 4 ans, il a décidé de créer un compte Instagram pour vulgariser la pédiatrie et aider les parents à mieux comprendre les maux de leurs enfants, ne pas paniquer au moindre problème de santé et ainsi décharger les services des urgences. Le Docteur Fougère a décidé de mettre ses conseils à l’écrit avec “Mon guide anti-panique : Brûlure, chute, fièvre… 50 fiches pour savoir quand courir aux urgences pédiatriques”, paru chez Marabout.
Maman de cinq enfants, Melody Lopez est professeure des écoles. Elle a créé Happee Kids, une association de soutien à la parentalité. Elle est également l’auteure de « 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer », paru aux éditions Eyrolles.
Melody Lopez explique que dès les premières heures après la naissance, les sages-femmes observent les réflexes archaïques. Ainsi, elles peuvent évaluer la santé neurologique des bébés. Parmi eux, le réflexe de marche automatique. Le bébé, alors placé en position verticale et légèrement incliné vers l’avant, effectue quelques pas de manière automatique. L’agrippement palmaire ou plantaire et le réflexe de succion, sont également observables dès la naissance. “Ces réflexes agissent au niveau de trois sphères, cognitive, émotionnelle et corporelle, influençant ainsi les différentes phases d’apprentissage”, précise la spécialiste.
Chez les nourrissons, les réflexes archaïques s’expriment automatiquement, car ils sont immatures neurologiquement. Les enfants plus âgés doivent apprendre à intégrer les réflexes archaïques et à les utiliser de manière appropriée dans des situations spécifiques. Par exemple, lorsqu’un enfant trébuche en courant, ses mains se déploient automatiquement pour protéger son visage. Il s’agit du « réflexe de parachute ».
Les conditions de la grossesse, le type d’accouchement, les chocs physiques ou émotionnels, ainsi que les mauvaises habitudes posturales peuvent par ailleurs influencer l’intégration des réflexes archaïques. Melody Lopez souligne que l’intervention précoce peut prévenir des complications futures, comme des problèmes de posture ou de langage. Mais « on peut travailler sur nos réflexes à n’importe quel âge, que ce soit en consultant un professionnel ou en adoptant des exercices spécifiques ».
Pour favoriser une intégration saine des réflexes archaïques, Melody Lopez recommande des approches spécifiques, telles que des massages du visage, des exercices de succion et des stimulations adaptées. “La motricité libre, permettant au bébé d’expérimenter ces réflexes, favorise leur intégration progressive, essentielle pour un développement sain.”
Melody Lopez démontre par ailleurs une relation étonnante entre les réflexes archaïques et l’utilisation prolongée de la tétine. Elle explique ainsi comment certains réflexes du visage peuvent être mal intégrés. Ils conduisent alors à des comportements de succion compensatoires, même chez l’adulte qui peut ressentir le besoin de fumer ou de mâchouiller un crayon.

L’invitée.
Maman de cinq enfants, ancienne ingénieure, Melody Lopez est professeure des écoles. Après une formation auprès d’Isabelle Filliozat, elle a créé Happee Kids. Elle anime au sein de cette association des ateliers de soutien à la parentalité ainsi que de portage bébé, de massage bébé, de communication gestuelle associée à la parole. Elle propose également des ateliers de yoga enfant et en famille, de brain ball, de brain gym et de réflexes archaïques.
La suivre sur Instagram
Aude Becquart est autrice de “La Nouvelle Méthode chrono-dodo, aidez votre enfant à bien dormir”, paru aux éditions Leduc. La professionnelle des métiers de la petite enfance et Gestalt-thérapeute du lien partage ses connaissances et son expérience. “La nouvelle méthode chrono-dodo consiste à accompagner son enfant pour qu’il acquière de bonnes habitudes de sommeil. L’idée est de rassurer et de sécuriser l’enfant ou le bébé, qui a besoin d’être rassuré et sécurisé lors de l’endormissement ou des réveils nocturnes.”
Aude Becquart souligne l’importance de cette présence tout en mettant en garde contre une présence excessive qui pourrait créer une dépendance. “Chez certains enfants, ça fonctionne très, très bien. Mais chez d’autres, ça peut leur faire croire qu’il y a un danger à dormir”, explique la coach parentale. Dans la méthode chrono-dodo”, le “chrono” sert à guider les parents dans la fréquence des visites auprès de leur enfant pendant un temps ultra court. “Plus le parent est guidé, plus ça rassure l’enfant parce qu’il sent ses parents dans une posture ferme et bienveillante.”
Selon Aude Becquart, les parents doivent habituer leur enfant à dormir malgré les bruits environnants, tels que “le frère qui crie, qui chante, le lave-linge en essorage, la douche, la chasse d’eau, les voisins qui font du bruit, les pompiers qui passent”. Cette habitude permet à l’enfant de développer une relation saine avec le sommeil, sans être perturbé par des stimuli sonores.
La mise en place d’un rituel du coucher constitue un des fondamentaux de la méthode chrono-dodo. Ce “petit moment en tête-à-tête avec papa ou maman dans la chambre avant de quitter la chambre” est un “moment privilégié” où les parents partagent des moments d’affection, racontent des histoires et créent une base émotionnelle favorable à un sommeil paisible.
Si passé les 4 mois, l’enfant dort avec sa tétine, Aude Becquart propose un sevrage progressif. Les parents, en suivant les outils de la méthode, accompagnent l’enfant vers une autonomie sans la tétine. Si cela peut engendrer des pleurs au début, l’idée est d’accompagner l’enfant en lui disant : “Je sais que tu vas y arriver”.
Aude Becquart encourage les parents à comprendre les raisons des réveils nocturnes de leur enfant. L’experte évoque divers scénarios, tels que des problématiques d’endormissement, une dette de sommeil ou des habitudes liées à la consommation de biberon la nuit. Cette analyse permet aux parents d’ajuster leur approche en fonction des besoins spécifiques de leur enfant.

L’invitée.
Aude Becquart est spécialiste du sommeil du bébé et de l’enfant. Professionnelle des métiers de la petite enfance, elle a travaillé pendant 20 ans en milieu hospitalier pédiatrique et en crèche. Elle est l’autrice du best-seller ” La Méthode chrono-dodo” et ” La Nouvelle Méthode chrono-dodo”, paru aux éditions Leduc. Suite à une solide formation de 6 années, elle est également Gestalt-thérapeute du lien pour les adultes.
Être parent d’une fratrie est une fabuleuse aventure humaine, riche… et parfois épuisante. Élodie Crépel est psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l’hypersensibilité. Elle est notamment autrice de “Ma famille atypique”, paru aux Éditions Leduc.
Vous rêviez d’une famille joyeuse où les enfants joueraient toujours paisiblement (et calmement) ensemble ? Elle n’existe qu’à la télévision et dans les vidéos scénarisées de certaines influenceuses. La psychanalyste met en garde contre l’illusion selon laquelle le bonheur familial serait une constante où “tout le monde va bien, tout le monde est content d’être avec tout le monde, tout le temps”. Les disputes font en effet partie des relations intrafamiliales. L’équilibre familial est “toujours un peu précaire” car les enfants grandissent, les parents évoluent et l’harmonie familiale est en perpétuel mouvement. La famille, en tant que premier noyau central, joue ainsi un rôle essentiel dans l’apprentissage des règles sociales.
Pour prévenir les disputes, Élodie Crépel souligne l’importance d’identifier les moments propices aux disputes et de travailler sur les éléments déclencheurs pour apaiser les tensions. Elle invite les parents à se faire confiance en rappelant qu’ils sont forcément les “meilleurs experts” de leur propre famille. Ainsi, les disputes peuvent être considérées comme des opportunités d’apprentissage et de renforcement des relations familiales.
La compétition étant naturelle au sein de la fratrie, la médiatrice familiale recommande de proposer des activités favorisant la coopération et la complémentarité entre les enfants. En effet, créer des “objectifs de cohésion” entre les enfants est essentiel pour développer des liens fraternels forts et durables.
Lorsqu’il s’agit d’intervenir lors des disputes, Élodie Crépel recommande une approche de médiateur plutôt que celle d’un juge. Selon elle, il est crucial d’éviter de créer un “rapport de force”, favorisant plutôt une communication non violente entre les enfants. Comprendre les émotions, encourager la communication non violente et favoriser la résolution de conflits par les enfants eux-mêmes sont par ailleurs des étapes clés pour développer des relations saines au sein de la fratrie.
Pour que chaque enfant puisse s’exprimer à tour de rôle sans couper la parole de l’autre, la psychanalyste encourage l’usage d’un bâton de parole.

L’invitée.
Élodie Crépel est psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l’hypersensibilité. Elle codirige l’Observatoire de la sensibilité. Hypersensible, surdouée et maman de 4 enfants atypiques, elle a à cœur de montrer, à travers ses livres et ses réseaux, comment il est possible de faire des atypies des atouts dans la vie professionnelle. Elle est notamment autrice de la bande dessinée “Atypiquement nôtre, vivre sa singularité en famille”, paru aux Éditions Leduc.
Lee Audras-Torrent est psychologue en pédopsychiatrie au CHU de Montpellier. Elle a écrit « 100 idées pour aider les enfants à s’affirmer », paru aux éditions Tom Pousse.
L’affirmation de soi n’est pas simplement une compétence innée, mais plutôt un comportement qui peut être appris. “Contrairement à l’estime de soi et à la confiance en soi, l’affirmation de soi repose sur la capacité à exprimer ses pensées et ses sentiments tout en respectant les opinions des autres. C’est le fait de pouvoir exprimer ce qu’on ressent, ce qu’on veut, tout en respectant ce que pensent les autres. Sans aller à la confrontation, mais en même temps sans la craindre”, explique Lee Audras-Torrent.
L’estime de soi et la confiance en soi sont des jugements de valeur plus subjectifs construits au fil de la vie. Ainsi, l’estime de soi concerne le jugement de valeur que l’on porte sur soi-même. La confiance en soi est davantage liée à la capacité à faire face aux défis quotidiens. “La confiance en soi, c’est la confiance qu’on s’accorde à affronter telle ou telle situation du quotidien, qui peut être difficile”, précise la spécialiste.
Pour aider un enfant timide qui semble avoir des difficultés à s’affirmer à l’école, la psychologue propose aux parents d’observer attentivement le comportement de leur enfant à la maison. Cela leur permettra de comprendre s’il s’agit réellement d’un problème nécessitant une intervention. Elle recommande des exercices de jeu de rôle à la maison. Ceux-ci permettent à l’enfant de pratiquer des situations où il se sent mal à l’aise. Ils renforcent ainsi sa capacité à s’affirmer dans le monde extérieur.
“Il est essentiel d’aider l’enfant à identifier les émotions qu’il ressent dans les situations où il a du mal à s’affirmer. C’est une première étape clé pour apprendre à s’affirmer par la suite”, explique Lee Audras-Torrent. La psychologue encourage les parents à exprimer leurs émotions. Ainsi, “si les enfants voient leurs parents exprimer ouvertement leurs émotions, ils seront plus enclins à le faire de même.” L’apprentissage de ces compétences n’est pas linéaire et nécessite du temps et de la pratique.
Pour aider un enfant anxieux à s’affirmer, il est important de l’aider à calmer les signes physiques du stress. La défocalisation et “des exercices simples tels que la respiration abdominale peuvent être enseignés aux enfants pour les aider à gérer le stress”.
Face aux insultes, Lee Audras-Torrent propose la technique des “flèches”. L’idée n’est pas de répondre à une insulte par une autre, mais plutôt de court-circuiter l’agresseur en répondant de manière inattendue. La psychologue recommande ainsi des jeux de rôle à la maison pour préparer l’enfant à utiliser cette technique sans tomber dans le cycle de l’escalade verbale.

L’invitée.
Lee Audras-Torrent est psychologue en pédopsychiatrie au CHU de Montpellier. Elle travaille notamment auprès d’enfants et adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement, des troubles du comportement ou de l’anxiété. Lee Audras-Torrent anime également des groupes pour enfants autour de l’affirmation de soi, dans lesquels elle met un point d’honneur à inclure les parents. Elle a écrit « 100 idées pour aider les enfants à s’affirmer », paru aux éditions Tom Pousse.
Christine Zalejski, docteure en biologie spécialisée en diversifications et éducation alimentaire infantile, partage avec nous son expérience et ses connaissances. Elle est l’autrice de « L’éducation alimentaire positive », paru chez Thierry Souccar éditions.
Le concept central de l’éducation alimentaire positive réside dans l’accompagnement du tout-petit à travers chaque étape de son développement. Cela va au-delà de simplement éveiller ses papilles au goût des aliments. “Éduquer son enfant aux aliments commence bien avant la diversification alimentaire. Le tout-petit doit apprendre à connaître les aliments qui composent son univers, à les toucher, sentir et même à comprendre leur origine”, explique Christine Zalejski. “C’est un apprentissage continu qui s’inscrit dans son développement global.”
“Il est important de comprendre que le contexte du repas influence l’appétit et le plaisir de l’enfant. Un cadre calme et propice à l’échange favorise une prise alimentaire plus sereine”, souligne la spécialiste. L’écosystème de la prise alimentaire englobe bien plus que la simple ingurgitation de nourriture. Le contexte, le lieu et le moment du repas sont cruciaux pour créer une expérience positive.
L’éducation alimentaire commence bien avant que l’enfant débute la diversification alimentaire. Christine Zalejski explique que, dès la grossesse, le fœtus est sensible aux saveurs, pouvant distinguer les nuances entre le sucré, le salé, l’acide, l’amer, et même l’umami. Des expériences montrent que les bébés in utero réagissent aux saveurs consommées par leur mère. “Le fœtus peut ressentir les saveurs vers le quatrième ou cinquième mois. Et cette sensibilisation précoce a un impact sur les préférences alimentaires ultérieures”, précise la Docteure.
Les enfants ont un besoin naturel de classer les objets. Cela s’applique également aux aliments. “Les enfants qui comprennent la catégorisation des aliments sont moins enclins au rejet. Plus ils connaissent, plus ils apprécient. Il ne s’agit pas de tromper l’enfant, mais de lui montrer les aliments de manière claire et visuelle”, explique Christine Zalejski.
Christine Zalejski encourage l’implication des tout-petits dans la préparation des repas. Même avant l’introduction des solides, les parents peuvent ainsi stimuler l’odorat des bébés en les exposant à diverses senteurs. “Cuisiner ensemble, même à un très jeune âge, a des bénéfices inattendus. Les enfants peuvent participer simplement en transvasant des morceaux de fruits ou légumes, créant ainsi une connexion positive avec la nourriture”, ajoute-t-elle.

L’invitée.
Christine Zalejski est docteure en biologie spécialisée en diversifications et éducation alimentaire infantile. Fondatrice du site et de l’organisme de formation Cubes et Petits pois, elle accompagne avec pédagogie et simplicité depuis 2010 les parents et les professionnels de la santé et de la petite enfance à apprendre à bien nourrir bébé. Son approche repose à la fois sur la connaissance des besoins de l’enfant, la mise en place d’une éducation alimentaire dès le plus jeune âge et le lien que l’enfant tisse avec son alimentation et son accompagnant au moment du repas. Elle est l’autrice de « L’éducation alimentaire positive », paru chez Thierry Souccar éditions.
La suivre sur Facebook
La suivre sur Instagram
Pour dévoiler les secrets d’une révision efficace, Marie Costa, enseignante, conférencière, et autrice du livre “50 clés pour aider un enfant à mémoriser”, publié aux éditions Eyrolles, partage ses connaissances ainsi que des conseils pratiques liés à la mémoire.
L’approche traditionnelle de la révision par une simple relecture du cours s’avère souvent inefficace. Il faut souligner qu’elle ne permet « que 10% de rétention d’information ». Pour bien mémoriser, avant de commencer la lecture, Marie Costa recommande de se préparer mentalement à apprendre la leçon. L’enseignante suggère des activités complémentaires telles que la réécriture, la discussion et l’utilisation de supports multimédias, soulignant l’importance de manipuler l’information de différentes manières.
Un sommeil adéquat et une alimentation équilibrée sont nécessaires pour entretenir et optimiser la mémoire. De plus, Marie Costa insiste sur le fait que l’eau en particulier joue un rôle essentiel dans la mémoire. Elle ajoute que, selon une étude belge, « 2 enfants sur 3 arrivent à l’école déshydratés ».
Il existe plusieurs types de mémoires interconnectées dans le cerveau. Marie Costa identifie la mémoire épisodique, la mémoire procédurale, la mémoire sémantique et les mémoires sensorielles. Toutes ces mémoires collaborent pour former une toile unique de souvenirs et de connaissances.
La mémoire épisodique est associée à nos souvenirs, intimement liée aux émotions. Des souvenirs agréables ou désagréables sont stockés, formant ainsi notre autobiographie.
La mémoire procédurale enregistre les gestes et actions, permettant à des activités comme marcher et faire du vélo de devenir automatiques.
La mémoire sémantique est une banque de connaissances. Apprendre de nouveaux mots et concepts enrichit cette mémoire.
Les mémoires sensorielles, liées à la vue, à l’odorat, au goût, à l’ouïe et au toucher, capturent des expériences à travers nos sens.
La mémoire de travail stocke temporairement des informations nécessaires à des tâches immédiates.
Pour réviser une dictée préparée et mémoriser correctement les mots, Marie Costa propose des approches ludiques. Écrire dans le sable, utiliser des couleurs et explorer la mémoire kinesthésique en écrivant dans la semoule sont autant de méthodes stimulantes pour rendre l’apprentissage plus ludique.

Marie Costa, experte en parentalité, auteure et conférencière, a accompagné de nombreuses familles durant 25 années d’enseignement et de coaching parental.
Diplômée d’un master en sciences de l’éducation, d’un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale, elle est fondatrice de M&C Parentalité et du programme de coaching « Développer ses talents de parents ».
Elle est l’autrice de « 50 clés pour aider un enfant à mémoriser » paru aux Éditions Eyrolles
La suivre sur Instagram et sur Facebook
Comprendre l’humour chez les enfants va au-delà de la simple observation des rires. C’est un outil essentiel pour soutenir leur développement émotionnel et social. La pétillante Florence Millot, psychologue et psychopédagogue partage ses connaissances et son expérience. « Souvent, ce qu’on observe, c’est que les bébés rient en lien avec une forme d’étonnement », explique-t-elle.
Les premiers rires des bébés sont souvent liés à l’étonnement, comme lors du jeu du coucou caché. Lorsque l’objet ou la personne réapparaît, l’enfant ressent alors une intense joie. Cette réaction est liée à la compréhension progressive de la permanence de l’objet, une notion importante dans le développement de l’enfant.
Le bébé peut comprendre que lorsque quelque chose disparaît, c’est pour toujours. Cependant, avec le temps, il apprend que les objets peuvent être cachés et réapparaître. Cela construit la base de la compréhension que même si quelque chose n’est pas visible, elle peut continuer d’exister. Florence Millot souligne que faire rire un enfant en jouant sur des éléments liés à la disparition et à la réapparition renforce sa sécurité émotionnelle. Pour cela, le parent peut, par exemple, jouer au « coucou caché ».
Lorsque des frères et sœurs taquinent ou se moquent, il est essentiel pour les parents de comprendre la dynamique. Si un enfant est sans cesse taquiné sans pouvoir se défendre, les parents doivent intervenir pour rétablir l’équilibre. Encourager la rotation des taquineries entre les enfants favorise en effet une dynamique saine.
Certains enfants peuvent être plus susceptibles que d’autres, réagissant fortement à la moquerie. Dans de tels cas, il est crucial que les parents interviennent et soutiennent émotionnellement l’enfant taquiné. Créer une dynamique fluide où chacun peut être tour à tour taquiné contribue ainsi à l’apprentissage de la défense personnelle.
À mesure que les enfants grandissent, leur perception de l’humour devient plus complexe. Certains peuvent être plus susceptibles en raison de fragilités émotionnelles. Dans ces situations, les adultes doivent être attentifs à déceler si l’humour est une manière détournée pour l’enfant d’exprimer des préoccupations plus profondes.

Lorsqu’un enfant réagit de manière excessive à une blague, il est crucial de ne pas rester fixé sur la blague elle-même, mais de chercher à comprendre ce qui se cache derrière cette réaction. Les parents peuvent offrir un soutien émotionnel en restant présents, même si l’enfant semble les repousser.
L’invitée.
Florence Millot est psychologue et psychopédagogue en libéral à Paris. Spécialiste dans la gestion des émotions et dans la communication bienveillante en famille, elle est autrice de 30 livres autour du parenting et du développement personnel, dont “Les Principes toltèques appliqués aux enfants”, paru chez Marabout. Elle est spécialisée dans l’approche TTC (tête, cœur, corps) et propose des conférences dans toute la France pour parler des émotions et de la communication en famille.
Solène Collin est diététicienne spécialisée en pédiatrie. Elle partage avec nous ses conseils éclairés et bienveillants pour passer un repas festif en famille. Une plongée instructive au cœur des réjouissances, où la sagesse alimentaire et les délices festifs se rencontrent.
Vous recherchez une idée de repas festif ultime et équilibré pour les enfants ? Solène Collin nous rappelle que les fêtes ne représentent qu’une petite fraction des repas annuels d’un enfant. Ainsi, elle estime à 1460 le nombre total de repas sur une année. Elle adopte une approche réaliste en préconisant de ne pas trop se préoccuper de l’équilibre nutritionnel pendant les fêtes. Elle invite à mettre l’accent sur le partage, la famille et la réduction de la pression alimentaire. « L’exception fait aussi les souvenirs », relativise-t-elle.
Aucun interdit alimentaire, donc, mais la recommandation d’éviter les aliments crus potentiellement risqués pour les enfants, tels que le poisson, la viande, les fruits de mer et le foie gras.
Solène Collin suggère la réalisation de petits biscuits sablés en famille. Elle souligne la flexibilité de cette recette. En effet, celle-ci permet d’ajuster la quantité de sucre et d’expérimenter avec des épices comme la cannelle, la muscade ou des saveurs d’orange. Les enfants peuvent choisir les formes des biscuits, participer à la décoration et même composer les sachets-cadeaux. Ils transforment ainsi une simple préparation culinaire en un moment de partage mémorable.
Pour un repas festif, la nutritionniste pédiatrique recommande de laisser une petite touche sucrée sur la table tout en offrant des alternatives plus saines aux enfants. « Vous serez peut-être surpris en laissant le choix de finalement voir qu’il va être s’orienter de lui-même vers une clémentine plutôt que vers la part de bûche au chocolat », affirme-t-elle. Elle conseille de proposer des bûches sorbet, des clémentines, et des fruits exotiques tels que la mangue, le litchi et l’ananas. Il est possible de rendre attractifs les fruits en les coupant de manière amusante avec des emporte-pièces ou en ajoutant des vermicelles colorés et des décorations ludiques.
Solène Collin aime particulièrement la recette du pain d’épices. Elle partage des détails sur l’histoire fascinante de ce mets, soulignant son origine en Chine et son évolution à travers les siècles. Elle nous apprend qu’à l’origine, le sucre était, comme la cannelle et la noix de muscade, considéré comme une épice.
Solène encourage la création, en famille, de ce dessert emblématique des fêtes. La diététicienne suggére de le personnaliser avec différentes formes et décorations, offrant ainsi une expérience aussi mémorable que délicieuse.

L’invitée.
Solène Collin est diététicienne spécialisée en pédiatrie et en trouble de l’oralité alimentaire de l’enfant. Bienveillance, écoute et bonne humeur sont les trois grands principes de sa pratique quotidienne. Elle s’efforce en effet chaque jour à promouvoir une alimentation positive, intuitive et une relation saine à la nourriture dès le plus jeune âge.
Nadège Pétrel, infirmière puéricultrice et professeure de yoga, partage avec nous son expérience et ses connaissances. Elle est connue sur les réseaux sociaux sous le compte Un Amour au naturel. Nadège Pétrel est également autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant », paru aux éditions Eyrolles.
« Il n’y a pas d’âge pour faire du yoga », répète la spécialiste. Pour les tout-petits, elle suggère d’intégrer le yoga dans le quotidien en plaçant son tapis au milieu du salon. Bébé est ainsi initié naturellement à la pratique. L’idée est d’incorporer des gestes simples entre les postures. La pratique du yoga en famille offre de beaux moments de complicité.
Lorsque les enfants commencent à marcher, le yoga en famille prend une dimension différente. Le jeu devient la clé, avec des postures associées à des animaux ou à des histoires. L’utilisation d’accessoires tels que des cartes, un dé ou des livres stimule l’imagination des enfants.
L’aspect ludique ne se limite pas aux postures physiques, mais s’étend également à la respiration. L’utilisation de jeux simples, comme souffler des bulles dans un bol de chocolat chaud imaginaire, permet aux enfants de développer une conscience de leur respiration de manière amusante et éducative.
La pratique du yoga en famille offre une expérience unique, alliant complicité, jeu et bien-être. Nadège Petrel partage son approche, mettant en lumière l’importance de la flexibilité et de la créativité dans cette aventure partagée.
« Quand on fait des séances avec les enfants, il ne faut pas avoir une idée trop arrêtée de ce qu’on va faire et vraiment se laisser guider par l’énergie de notre enfant au jour le jour. Parce qu’il y a des fois où ils vont avoir aussi beaucoup, beaucoup besoin de bouger et de se défouler. Et d’autres où, peut-être, ils seront plus fatigués et ils auront besoin d’une séance un peu plus calme. » Ainsi, elle conseille de « ne pas se fixer trop d’impératifs de temps et de vraiment se laisser porter et observer son enfant ».
Outre les bienfaits physiques, le yoga en famille peut également être un outil puissant pour aider les enfants à gérer leurs émotions. La pratique régulière offre en effet un espace où l’enfant peut se concentrer sur lui-même. Il peut alors apprendre à réguler sa respiration et, avec le temps, développer des compétences d’auto-régulation face au stress et aux émotions.

L’invitée.
Infirmière puéricultrice, maman de deux filles, Nadège Pétrel est instructrice en portage de bébé et enseignante de yoga. Elle apprend aussi aux parents à masser leur bébé. Elle anime des ateliers collectifs de yoga avec les enfants, un yoga naturel, à partager en famille, sans modération.
Sur les réseaux sociaux, elle aborde de nombreuses questions qui concernent le lien parent-enfant et la gestion des émotions des petits.
Quelle est l’importance d’un bon microbiote pour l’enfant ? Comment un microbiote au top peut-il améliorer ses performances scolaires ? Quel petit-déjeuner pour un microbiote sain ? Céline Richonnet, diététicienne-nutritionniste pédiatrique, partage avec nous son expertise. Elle est l’autrice de “Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top”, paru en août 2023 chez Marabout.
« Le microbiote intestinal, c’est l’ensemble des micro-organismes, en majorité des bactéries, qui colonisent le tube digestif, principalement au niveau du côlon », explique Céline Richonnet.
Pour en prendre soin, l’ingénieur en nutrition préconise des fruits et des légumes à chaque repas, « même à l’apéritif et au petit-déjeuner », si possible bio. Elle conseille d’éviter le sucre, les émulsifiants, les produits ultra-transformés et de bannir les édulcorants.
Elle encourage à limiter les pâtes et à en remplacer certaines par des légumineuses (par exemple les lentilles, haricots blancs, pois chiches). Pour booster le système immunitaire, elle encourage à favoriser les activités en contact avec la nature et les animaux.
Prendre soin du microbiote de son enfant a un effet sur sa concentration et son apprentissage.
Ainsi, explique Céline Richonnet, « le système nerveux de l’intestin est constitué d’un milliard de neurones, donc il y a une véritable conversation entre l’intestin et le cerveau. On sait, par exemple, que l’abondance de certaines bactéries à l’âge d’un an dans le microbiote de l’enfant est corrélée avec le développement neurologique et notamment les capacités de langage et cognitives à l’âge de deux ans. Les bactéries de l’intestin vont faciliter l’apprentissage, la mémorisation, la planification, l’attention, la mémoire de travail, en mobilisant les neurones qui sont reliés au cerveau. »
Pour un microbiote au top, la diététicienne-nutritionniste pédiatrique préconise un petit déjeuner qui n’élève pas trop la glycémie. Elle déconseille les céréales « qui sont ultra-transformées et très glycémiantes » et invite à privilégier le pain, « idéalement du pain au levain qui va nourrir la flore du microbiote intestinal » avec des matières grasses (par exemple : beurre, purée de noisettes ou d’amandes) ainsi qu’un fruit.
Votre bébé a de la dermatite atopique ? Bonne nouvelle : il est possible de la réduire en améliorant son microbiote. « Le lait maternel, s’il est possible d’allaiter, est le facteur le plus protecteur pour le risque d’allergie, le risque notamment d’eczéma, et à peu près toutes les intolérances alimentaires. »
Lors de la diversification, il est important d’exposer l’enfant à un certain nombre de prébiotiques. « Les prébiotiques sont les aliments qui viennent nourrir les bonnes bactéries intestinales », détaille la spécialiste. On les retrouve principalement dans les fruits et les légumes.
Si l’enfant a une alimentation équilibrée, sauf cas exceptionnels, la supplémentation en probiotiques achetés en pharmacie ou parapharmacie ne présente pas d’intérêt.
« Pour qu’un probiotique soit efficace, il faut qu’il soit vivant au moment où il est ingéré. Il faut surtout qu’il passe la barrière gastrique, qu’il ne soit pas attaqué par l’acidité gastrique de l’estomac ». Céline Richonnet recommande certaines souches « qui peuvent être intéressantes » comme des levures capables de booster le microbiote après un traitement antibiotique, comme les saccharomyces.

Céline Richonnet est diététicienne-nutritionniste pédiatrique, ingénieur en nutrition, spécialisée dans le comportement alimentaire de l’enfant depuis plus de 20 ans. Elle est coprésidente du Club Européen des Diététiciens de l’Enfance. Depuis 2017, elle accompagne les parents en alimentation bienveillante pour construire le microbiote de leurs enfants et forme les professionnels de santé. Elle est l’autrice de “Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top” paru chez Marabout.
Stéphanie Abellan est thérapeute en mémoires cellulaires. Elle est l’autrice de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels “Mon Journal de Noël”, paru chez Le Courrier du Livre. Elle y partage ses nombreux conseils pour émerveiller et captiver les enfants pour un Noël plein de surprises.
“Mon Journal de Noël” n’est pas seulement un divertissement festif, c’est aussi une expérience de développement personnel invitant l’enfant à se centrer sur ce qu’il ressent. Stéphanie Abellan explique : l’idée est également de “faire découvrir aux enfants les prémisses de notions qui pourront les aider plus tard, des clés de développement comme celle que la gratitude.” Un quart d’heure détente différent, de yoga, relaxation ou de sophrologie, est proposé chaque semaine.
Mon Journal de Noël” est bien plus qu’un livre pour enfants. C’est une invitation à explorer l’imaginaire, à partager des moments de complicité en famille, et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie.
Parmi les activités préférées de Stéphanie Abellan, il y a la préparation du pull de Noël pour chaque membre de la famille. “L’idée, c’est de fabriquer un pull avec des décorations de Noël, que vous allez pouvoir coller un peu partout, avec des guirlandes. Vous pouvez même dessiner dessus.” Peur que votre pull soit ridicule ? “Tout l’intérêt est justement d’en rire”, explique l’autrice.
Autre activité qui remporte un grand succès auprès des enfants : la chanson à trous. “On rigole vraiment en mettant à la suite les uns des autres des mots qui n’ont rien à voir. L’idée, c’est qu’une fois que la chanson est terminée, toute la famille la chante en même temps le jour de Noël”, souligne-t-elle. Fous rires garantis.
“L’activité qui plaît le plus, surtout aux parents, peut-être un petit peu moins aux enfants, c’est le grand tri des jouets. Elle permet de travailler sur la partie Feng shui. C’est-à-dire dès leur plus jeune âge, apprendre aux enfants que pour avoir un esprit sain, il faut un environnement sain. Donc une chambre qui soit aérée, propre et rangée. Il faut leur donner cette habitude et leur faire conscientiser le ressenti avant et après rangement. Ensuite, la partie développement personnel passe par sensibiliser les enfants au fait de trier et de donner aux enfants qui n’ont pas la chance d’avoir des jouets”, partage l’autrice.
Finalement, tout le monde est heureux. Même les enfants, car le Père-Noël aura plus de place pour dépose de nouveaux jouets.
“La gratitude pour moi, c’est quelque chose qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Souvent, on le découvre un peu sur le tard, quand on est adulte et que l’on commence un petit peu à s’intéresser au bien-être, à la spiritualité. C’est vrai que si on dit aux enfants : “regarde, là, tu peux ressentir de la gratitude pour ce que tu as”, je pense que ça peut permettre de faire une génération d’adultes qui seront vraiment bien mieux dans leur peau”, affirme Stéphanie Abellan. Parmi les exercices qui permettent d’exprimer la gratitude, elle aime particulièrement celui du grand chef étoilé. L’enfant prépare un encas, un gâteau ou un repas pour ceux qu’il aime. Ainsi, “ tous les membres de leur famille ressentent de la gratitude, comme une vague d’amour, grâce à cette activité ”.

Stéphanie Abellan est thérapeute en mémoires cellulaires. Elle est l’autrice de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels “Mon Journal de Noël” paru chez Le Courrier du Livre. Elle partage ses nombreux conseils pour émerveiller et captiver les enfants pour un Noël plein de surprises.
©Stéphanie Abellan
Si traditionnellement, les punitions ont été considérées comme des outils éducatifs, de plus en plus de parents se tournent vers des approches mettant l’accent sur la bienveillance.
Marie Costa, experte en parentalité, est autrice de “100 idées pour éviter les punitions, un livre pour redonner le sourire aux parents et aux enfants”, paru aux Éditions Tom Pousse. Elle y partage ses connaissances, son expérience et ses conseils.
L’exaspération rend la punition peu rationnelle. En effet, elle n’est pas toujours en rapport direct avec le comportement problématique et la sanction est souvent disproportionnée. Par ailleurs, l’enfant, en pleine tempête neuronale sous l’effet de la punition, ne réfléchit ni à son acte ni à ses conséquences. Il ne cherchera pas à se discipliner, mais à profiter de l’absence de ses parents sur le lieu de la punition pour recommencer. Enfin, les punitions étant inefficaces, les parents peuvent être tentés d’augmenter l’intensité des punitions. Ils risquent alors de perdre toute autorité et crédibilité vis-à-vis de leur enfant, qui finit par afficher un certain détachement face aux sanctions.
L’une des principales idées défendues par Marie Costa est une éducation basée sur la compréhension et la communication. Aussi, elle encourage les parents à adopter une approche calme et empathique, favorisant ainsi une relation basée sur la confiance.
Plutôt que de punir un enfant qui, par exemple, aurait traversé sans regarder malgré les recommandations de ses parents, Marie Costa préconise le jeu du “et si ?”. Elle explique : “Et si tu traverses la rue et qu’il y a une voiture, et si tu pars courir avec ton ballon et que le ballon s’échappe sur la route, et si on te prend le goûter dans la cour de récréation… Ce jeu du “et si ?” permet à l’enfant de réfléchir. Tant que vous n’êtes pas d’accord avec ses réponses, continuez de lui poser des questions jusqu’à ce qu’il vous donne la réponse que vous attendez”. Ce jeu stimulant invite les enfants à explorer des scénarios hypothétiques, les incitant à réfléchir de manière critique et à élargir leur perspective.
Pour éviter les punitions, Marie Costa met également l’accent sur le renforcement positif. Plutôt que de se concentrer sur les erreurs, elle encourage à souligner les comportements positifs. L’experte en parentalité précise : “en général, on fait dix reproches pour un compliment. Les dix reproches vont être : Dépêche-toi ! Prends tes affaires ! Tu n’as pas encore déjeuné, on va être en retard à l’école ! Arrête de jouer ! Arrête de parler, arrête de courir ! Je vous invite à faire l’inverse. Une fois que vous avez fait un reproche, essayez de trouver dix choses qui vont bien et soulignez-les”. Les compliments, sincères, précis et factuels, renforcent le lien entre les actions positives et les conséquences agréables. Ils incitent ainsi les enfants à répéter ces comportements.

Marie Costa, experte en parentalité, auteure et conférencière, a accompagné de nombreuses familles durant 25 années d’enseignement et de coaching parental.
Diplômée d’un Master en Sciences de l’Éducation, d’un diplôme de Conseillère en Économie Sociale et Familiale, elle est fondatrice de M&C Parentalité et du programme de coaching « Développer ses talents de parents ».
Elle intervient aujourd’hui au sein des entreprises pour aider les parents à mieux concilier leur temps de vie et à développer leur leadership parental.
À partir de quatre ans, les enfants commencent à développer leur compréhension des bases de la gestion de l’argent. Arwa Chaouki est la fondatrice d’Edukafi, Institut d’intelligence financière et budgétaire. Elle offre des conseils précieux pour aider les parents à initier leurs enfants à des notions budgétaires et financières essentielles.
“L’éducation financière consiste à initier les enfants aux principes d’établissement d’un budget pour réaliser un projet qui leur tient à cœur. Il s’agit de leur transmettre des notions qui leur permettront de gérer leur argent en tenant compte du monde économique qui les entoure”, explique la spécialiste.
Arwa Chaouki souligne l’importance de l’éducation financière à la maison, en commençant par avoir des discussions ouvertes sur l’argent. Les parents doivent expliquer aux enfants que l’argent est un outil nécessaire pour acheter des biens et des services.
L’experte explique qu'”à partir de quatre ans, on peut commencer à leur montrer ce qu’est une pièce de monnaie : une pièce de 1€, une pièce de 0,50€ afin qu’ils visualisent ce qu’est l’argent et fassent la différence entre chaque pièce. C’est aussi un moyen de commencer à leur apprendre les chiffres et à compter.”
Les jeunes enfants peuvent commencer à comprendre cette idée en accompagnant leurs parents faire des courses. C’est l’occasion pour ces derniers de leur expliquer comment fonctionne l’échange d’argent contre des produits. Par exemple, à la boulangerie, il est intéressant de leur expliquer les différences de prix entre les produits proposés. Ainsi, explique Arwa Chaouki, le parent peut préciser à son enfant que “la baguette classique vaut 1€, la baguette tradition, elle, vaut 1,10€ parce qu’il y a un peu plus de travail et des graines dedans”.
Arwa Chaouki suggère de jouer avec son enfant, notamment “à la marchande” ou “au marchand”. Manipuler de la monnaie fictive, l’échanger contre de petits jouets est un excellent outil pour développer la compréhension enfantine de la gestion financière.
Avoir une tirelire pour économiser de l’argent de poche permet aussi aux enfants de voir concrètement comment leur argent peut s’accumuler avec le temps.
“Le montant de l’argent de poche dépend de la situation financière de chaque famille et du budget qui peut y être alloué”, explique Arwa Chaouki, qui indique qu’une étude diffusée sur BFM TV en septembre 2023 affirme que le montant de l’argent de poche moyen en France est de 40€ par mois. L’argent de poche coïncide généralement avec l’entrée en 6ᵉ.
L’experte suggère une approche progressive de l’argent de poche. Au départ, elle recommande de donner de l’argent chaque semaine à l’enfant. Cette fréquence régulière permet à celui-ci de se familiariser avec la gestion de petites sommes d’argent de manière continue. C’est une opportunité de comprendre que l’argent doit être géré sur une base régulière pour couvrir les dépenses et pour l’épargne. Une fois que l’enfant commence à maîtriser les bases de la gestion de l’argent de poche hebdomadaire, Arwa Chaouki suggère de passer à une allocation mensuelle.
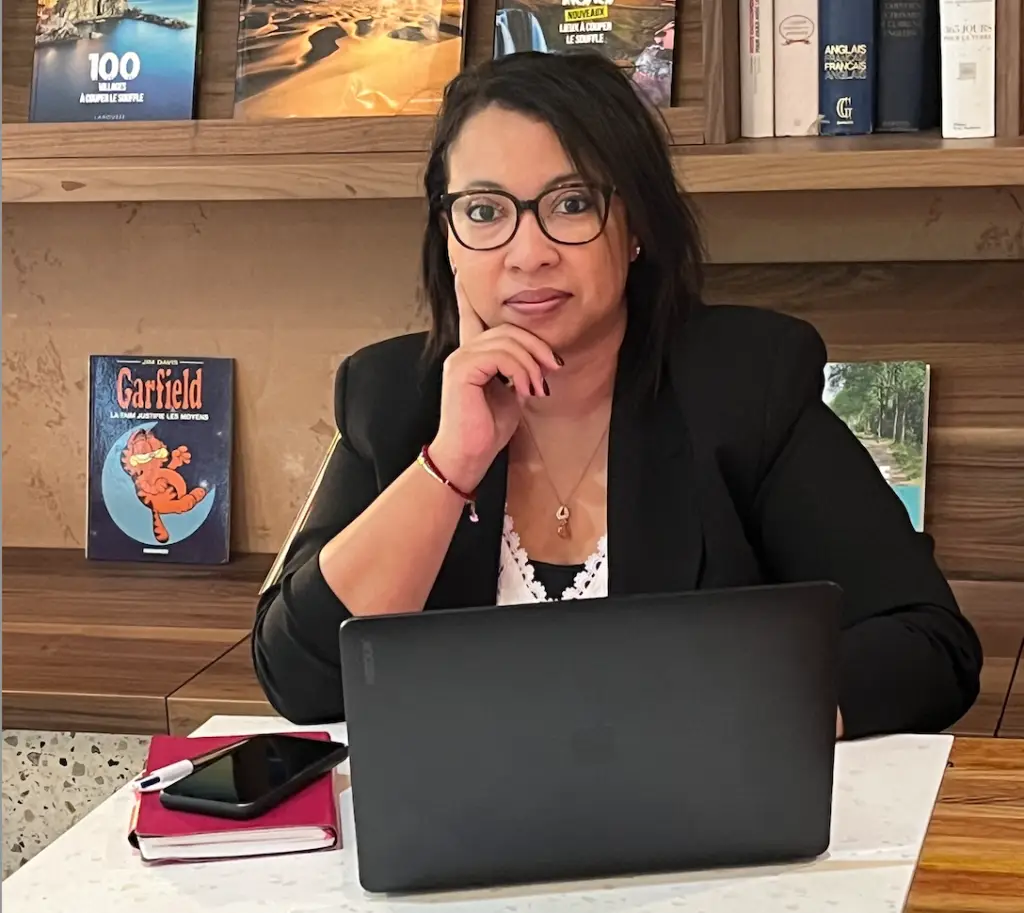
Passionnée par le monde de la finance, Arwa Chaouki a intégré la Société Générale en 2006. Grâce à son goût du challenge, sa persévérance et ses connaissances, elle a occupé des postes de management et d’expert en conseil et financement des professionnels. La naissance de sa première fille en 2018 et sa vie de “working mum” lui ont permis de renouer avec une envie qu’elle a toujours eue : partager son expérience et transmettre son savoir. Arwa souhaite « donner aux autres ce que la vie lui a permis d’obtenir » et encourager les gens à croire en eux et en leur potentiel. Entrepreneuse dans l’âme, Arwa décide de travailler sur un projet qui permettra aux jeunes générations de recevoir des clefs qui leur serviront toute leur vie. Elle fonde Edukafi, Institut d’intelligence financière et budgétaire.
Isabelle Pailleau est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages et l’auteure de nombreux ouvrages, dont “Parents joyeux, enfants heureux : cultiver la joie et le bonheur en famille”, paru aux éditions Vuibert en janvier 2023. Elle partage son expérience et ses conseils.
Oubliez l’idée d’une joie constante tous les jours, “car c’est irréaliste”, explique Isabelle Pailleau. “C’est vraiment un état de bien-être ensemble que l’on cultive… À travers lequel on arrive à dépasser, ensemble, des moments difficiles et dans lequel on célèbre les moments joyeux.”
Le bonheur en famille s’évalue à travers le temps. “On en prendra véritablement conscience à la fin du parcours, quand on fera le bilan de tout ce qu’on a réussi à construire et de tout ce qu’on a traversé, ensemble, grâce à nos ressources.”
“Quand on choisit de fonder une famille, on s’engage à, peut-être, se frotter à des personnalités qui ne sont pas toujours douces. Mais on va, ensemble, surmonter des moments difficiles, célébrer et construire des souvenirs qui nous font du bien. Certains moments seront peut-être particulièrement intenses et d’autres plus doux et plus calmes au quotidien… Mais ça sera du bonheur quand même.”
Isabelle Pailleau souligne l’importance de partager les responsabilités au sein de la famille. Cela inclut les tâches ménagères, l’éducation des enfants et la prise de décisions. Le partage des responsabilités crée un équilibre et évite que certaines personnes ne se sentent surchargées ou négligées. “Cela signifie qu’il ne peut pas y avoir une seule personne qui serait le gentil organisateur du bonheur familial, en règle générale, plutôt la maman.”
Le bonheur en famille repose en grande partie sur une communication honnête et bienveillante qui permet à chaque membre de la famille de se sentir entendu et compris. Ainsi, explique la psychologue, “on doit pouvoir dire les jours où l’on se sent un peu plus triste. Pour cultiver une atmosphère de bien-être en famille, il est possible de s’inspirer des voisins européens. En Italie, par exemple, la tradition centenaire qu’est la Passeggiata consiste à sortir de chez soi en fin de journée pour se promener avec sa famille, ses voisins et ses amis”.
Devenir parent implique des responsabilités importantes vis-à -vis de l’enfant. Parfois, cette responsabilité va se transformer en un surplus de sérieux. “Quand on devient sérieux, souvent, on devient rabat-joie”, explique lsabelle Pailleau. Elle précise : “on est très pénible, tout est très, très grave”. Certains parents perdent alors leur joie. Cependant, “on peut tout à fait être responsable de leur éducation et, pour autant, cultiver la joie qu’on a en nous, ne pas l’éteindre et être rigolo, léger, dédramatiser des situations”.
Manifester sa joie devant son enfant, être un parent joyeux n’affecte pas l’autorité. “Au contraire, un lien de complicité avec les enfants se crée.” Ainsi, ceux-ci comprennent qu’ils peuvent compter sur leurs parents en tant que parents responsables. Ils vont se sentir heureux de voir la joie en leurs parents, tout “comme y a de la joie en eux”.

Isabelle Pailleau est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, thérapeute familiale et directrice de La Fabrique à bonheurs.
Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, dont « Parents joyeux, enfants heureux : cultiver la joie et le bonheur en famille ”, paru chez Vuibert.
Guillaume Larroumets est ostéopathe spécialisé en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Il partage avec nous son expertise et ses conseils sur le problème de la tête plate.
La tête plate est une plagiocéphalie, c’est-à-dire une déformation du crâne qui se repère par un aplatissement de la tête. La vigilance est de mise car, comme le précise Guillaume Larroumets, « la plupart des déformations crâniennes ne sont pas visibles à la naissance. Souvent, elles apparaissent entre 2 et 4 mois ».
Il est courant que le crâne du bébé soit légèrement déformé lors des accouchements par voie basse, surtout lorsqu’ils sont longs et/ou nécessitent l’usage de spatules, forceps ou de ventouses. Heureusement, la tête du bébé est relativement souple et malléable, ce qui permet au crâne de retrouver une forme naturelle lors de la croissance. Si le crâne ne revient pas à la normale sous 3 semaines, le spécialiste conseille de consulter rapidement un ostéopathe spécialisé en pédiatrie.
Le pronostic vital n’est pas engagé. Il n’y a pas de conséquence neurologique à la tête plate. Pour autant, selon Guillaume Larroumets, « ce problème doit être pris au sérieux parce qu’il y a plusieurs conséquences à la déformation crânienne. Ce sont des enfants qui, potentiellement, vont avoir des problèmes au niveau de la mâchoire, comme, par exemple, une mâchoire décalée. Ils peuvent aussi présenter des problèmes de dentition, de mastication ou encore de prononciation ». Le professionnel précise également que les enfants à la tête plate sont davantage sujets à une scoliose ou au torticolis à répétition. Par ailleurs, certains montrent un retard dans l’acquisition motrice.
« Un enfant dont la tête plate n’a pas été traitée, gardera la tête plate toute sa vie. Le degré de sévérité va peut-être diminuer, mais la tête plate sera toujours là. On est dans une société où l’esthétique est assez importante malgré tout », partage le spécialiste. Il fait ainsi référence aux complexes que peuvent ressentir les hommes qui perdent leurs cheveux très jeunes et dont la tête plate est mise à jour.
Il est possible de prévenir la tête plate de bébé. Pour cela, Guillaume Larroumets conseille aux futures mamans d’avoir un suivi ostéopathique trimestriel, de faire de l’haptonomie (méthode permettant de rentrer en communication avec le bébé in utero dés le 3e ou le 4e mois de naissance) avec le coparent, du yoga prénatal, de l’acupuncture ou encore d’aller à la piscine pour détendre ses muscles.
«. »
L’ostéopathe attire l’attention sur le fait que les consultations chez les spécialistes ne suffisent pas. En effet, « 80% du travail se passe à la maison. Si on n’y applique pas les conseils donnés, ça ne sert à rien d’aller chez des thérapeutes parce qu’on ne peut pas faire de miracle en voyant un bébé toutes les 2 semaines », souligne-t-il.
Idéalement, la prise en charge doit avoir lieu avant les 5 mois de l’enfant. « On a jusqu’aux 8 mois du bébé pour agir. À partir de 8 mois, la tête va commencer à s’ossifier », précise Guillaume Larroumets. Il est possible que le port d’un casque soit proposé. « Il va laisser de la place là où on veut que la tête grandisse. » Selon l’ostéopathe, les casques sont d’une grande efficacité et indolores. « On n’a jamais vu un bébé qui a porté un casque sans résultats. »

L’invité.
Guillaume Larroumets est un des membres fondateurs de l’Association Bébés Plagio 74 et membre de la Société européenne de recherche en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Il est co-auteur, avec Emmanuel Piquemal de « Mon bébé a la tête plate, je fais quoi ? », paru chez Dangles.
Marie-Gabrielle Domizi est diététicienne nutritionniste, membre de l’Observatoire National des Alimentations Végétales (ONAV) et du Club européen des diététiciens de l’enfance. “Le végétarisme est un mode alimentaire, une façon de se nourrir. On supprime la viande et le poisson. Mais on maintient les œufs, les produits laitiers, donc yaourts, les fromages. On fait la part belle aux céréales, aux légumineuses, aux oléagineux et tout le panel du domaine végétal”, explique-t-elle.
Le végétarisme est de plus en plus populaire. De nombreuses familles choisissent cette voie pour leur alimentation, y compris pour celle de leurs enfants.
Le végétarisme peut offrir de nombreux avantages aux enfants lorsqu’il est bien équilibré et planifié. Voici quelques-uns des plus courants :
La vitamine B 12 est “une vitamine qui intervient dans le métabolisme énergétique. Elle intervient également dans la formation des globules rouges et au niveau du système immunitaire. Elle est donc vraiment importante”, précise la diététicienne.
Marie-Gabrielle Domizi recommande une complémentation en vitamine B12 pour les enfants végétariens. “C’est vraiment le point de sensibilité du végétarisme. La vitamine B12 est une vitamine que l’on trouve que dans les produits animaux. À partir du moment où vous allez commencer à réfléchir à réduire votre consommation de produits type viande ou poisson, il faut vous rapprocher de votre médecin ou de votre diététicien ou diététicienne pour voir avec lui la nécessité d’une complémentation”, explique-t-elle.
“En réalité, le risque potentiel de carence existe quel que soit son régime alimentaire. À partir du moment où on ne mange pas équilibré, le risque existe.” Ainsi, une alimentation végétarienne, quand elle est bien équilibrée, ne présente pas de risque. “Au contraire, elle va dans le sens d’encourager une alimentation plus saine et même plus diversifiée”, ajoute-t-elle.
Cependant, selon Marie-Gabrielle Domizi, il existe un risque : le risque social. “On est dans une société où il n’est pas encore évident de manger végétarien.”
Pour se lancer, Marie-Gabrielle Domizi préconnise “de se rapprocher d’un professionnel de santé (médecin, diététicien, NDLR) pour bénéficier des conseils généraux.” Elle invite à consulter le site de l’Observatoire national des alimentations végétales qui regorge d’informations. Le site “Végéclic est aussi là pour vous orienter sur ces besoins nutritionnels”.

La cuisine végétarienne n’est pas monotone. La diététicienne suggère des recettes telles que le risotto d’orge aux carottes, le pesto de brocolis ou encore des crêpes avec de la farine de pois chiches…
L’invitée.
Marie-Gabrielle Domizi est diététicienne-nutritionniste, diplômée depuis 1998. Après un parcours dans différents secteurs (agroalimentaire, médical, enseignement…), elle a ouvert son cabinet à Aix-en-Provence en 2015. Adepte de l’alimentation végétale, elle met en avant ses bienfaits. Elle prouve ainsi qu’il est possible de s’alimenter de manière équilibrée avec gourmandise et sans monotonie.
Comment parler de la mort à son enfant ? Comment répondre à ses questions en restant honnête et en évitant de le laisser seul avec son imagination et ses angoisses ? Nadège Pétrel est infirmière puéricultrice engagée et militante pour les droits de l’enfant. Elle est connue sur les réseaux sociaux sous le compte Un Amour au naturel. Elle est aussi autrice de « 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort » (éditions Eyrolles).
Annoncer la mort d’un être cher à un enfant est l’une des tâches les plus difficiles pour un parent ou un tuteur. Nadège Pétrel recommande d’aborder cette conversation avec douceur et honnêteté.
Tout d’abord, il est essentiel de choisir le bon moment et le bon endroit pour parler à l’enfant. Utiliser des mots simples, factuels et appropriés à son âge pour expliquer la situation est aussi recommandé. Lorsque vous annoncez la mort, soyez honnête. Évitez d’utiliser des euphémismes tels que “la personne est partie” ou “elle s’est endormie”. Les enfants ont besoin de comprendre que la personne est décédée, ce qui signifie qu’elle ne reviendra pas.
Nadège Pétrel recommande également d’exprimer ses émotions devant son enfant. Car “si on veut que notre enfant s’autorise à vivre ses émotions, il faut lui montrer que c’est possible”. “On peut s’asseoir sur le canapé, se faire un gros câlin et, pourquoi pas, pleurer un bon coup ensemble. Et ensuite se remémorer les bons souvenirs : qu’est-ce qu’on aimait faire avec mamie ? Qu’est-ce qui nous apportait du bonheur ? Pourquoi pas regarder des photos. Car la façon dont on présente les choses, ici un décès, va laisser une trace dans sa tête, ses émotions. Si on le présente avec de la douceur, du calme et un sourire, même si on pleure, l’enfant va comprendre que la mort fait partie de la vie. Que c’est triste, mais qu’on peut rebondir et continuer à vivre parce qu’il y a encore plein de choses à vivre…”
La question de savoir si un enfant peut assister à un enterrement dépend de plusieurs facteurs. Parmi eux, notamment, l’âge de l’enfant, sa relation avec la personne décédée et sa propre compréhension de la mort. Nadège Pétrel recommande d’aborder cette question avec précaution.
Tout d’abord, il est essentiel de considérer l’âge de l’enfant. Les enfants plus jeunes, en particulier ceux de moins de 5 ans, ont souvent du mal à comprendre la signification de la mort. Pour eux, la mort peut être perçue comme une absence temporaire. Nadège Pétrel explique que, selon une étude d’Hélène Romano, l’enfant de moins de 6 ans pense que la mort “est réversible. C’est-à dire qu’on peut être mort et ne plus être mort”. Assister à un enterrement peut alors être source de confusion et d’anxiété.
“Cela reste un lieu, où il faut avoir conscience qu’il y aura beaucoup de personnes. Souvent, beaucoup de personnes tristes, potentiellement en train de pleurer. Si l’enfant qui est très sensible, cela peut être assez difficile”, précise la spécialiste.
Nadège Pétrel conseille également de prendre en compte la sensibilité de l’enfant et de lui donner le choix de participer ou non. “Tant que l’enfant n’est pas ado, il n’y a pas forcément de nécessité, sauf si c’est une envie de la part de l’enfant”, ajoute-t-elle. Elle recommande ainsi d’accompagner l’enfant au cimetière après l’enterrement. “Tout simplement parce que c’est important pour l’enfant de participer à tous les rituels autour de la mort pour s’approprier celle-cio.”
L’intervenante.

Infirmière puéricultrice, maman de deux enfants, Nadège Pétrel est désireuse de révolutionner l’image de la parentalité afin qu’elle soit davantage inclusive et sans tabou. Engagée et militante pour les droits de l’enfant, elle souhaite permettre aux parents d’accéder facilement à des informations fiables afin qu’ils puissent faire leurs propres choix.
Sur les réseaux sociaux, elle aborde de nombreuses questions qui concernent le lien parent-enfant et la gestion des émotions des petits. Elle est autrice de nombreux ouvrages dont “50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort”, paru aux éditions Eyrolles.