
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Maeva Courtois a fait carrière en banque d’investissement. Elle a ensuite rejoint des fonds et monté un pôle de finance durable. Elle cocréé, en 2020, la banque Helios et en est la présidente engagée.
Helios a aujourd’hui créé le compte reconnu comme le plus vert de France. La banque a par ailleurs déjà investi 6 millions d’euros dans des projets dits à impact positif. 6 millions sur environ 31 millions d’euros d’encours en 2023.
Le secteur bancaire est le point de départ de la transformation écologique. Les banques ont un rôle déterminant et une responsabilité sociétale puisqu’elles influent directement le financement d’un projet plutôt qu’un autre. Par exemple, en décidant de participer encore ou non au financement de développement d’énergies ou d’activités fossiles polluantes.
Maeva Courtois questionne le manque de connaissances et d’intérêt que nous avons pour les usages qu’ont les banques de nos dépôts d’argent. Elle nous incite à nous renseigner beaucoup plus. Cela pour savoir si les prêts effectués par nos banques le sont auprès de projets en phase avec la transition écologique ou non.
Helios propose à ses clients les mêmes services, fonctionnalités et usages qu’une banque traditionnelle. Sa particularité réside dans le fait qu’elle s’engage à écarter tout financement de quelque projet qui représenterait un risque pour le climat et la biodiversité. Helios ne finance que des projets à impact positif et qui accélèrent la transition écologique.
Depuis deux ans, le cabinet Greenlee désigne les comptes d’Helios comme ceux qui ont la plus faible intensité carbone. Une belle récompense et démonstration de la mission que s’est donnée Helios. Elle devient une alternative de plus en plus complète aux banques traditionnelles en proposant des crédits et des produits d’épargne.
Le 18 mars 2024, les équipes du Guide Michelin remettaient, à côté de leurs célèbres étoiles rouges, un autre genre d’étoiles : les étoiles vertes. Depuis quatre ans, le célèbre guide centenaire met en avant, avec une nouvelle distinction, toutes les bonnes pratiques écoresponsables à la fois en cuisine et en salle.
Quand les inspectrices et inspecteurs sont présents dans tel ou tel restaurant, en plus de juger la cuisine, ils vont vérifier les bonnes démarches écoresponsables : saisonnalité, origine des produits, gestion des déchets, etc. Tout est scrupuleusement vérifié.
Parmi ceux qui remportent cette distinction cette année, le restaurant En Pleine nature, à Quint-Fonsegrives, en banlieue toulousaine. Le chef Sylvain Joffre et sa compagne, la sommelière Ana Christina, dont le restaurant est étoilé depuis déjà une dizaine d’années, sont presque la définition de cette étoile verte. Travaillant avec une grande majorité de produits ultra-locaux, le chef est à la fois jardinier, mais également cueilleur. Il n’hésite pas à partir régulièrement « en pleine nature » pour récolter lui-même des plantes étonnantes qui feront toute la différence dans sa cuisine.
Cette année, les autres récompensés par cette jolie étoile sont Les Jardiniers (Ligré), La Cour de Rémi (Bernicourt), Domaine du Châtelard (Dirac), L’Art de vivre (Narbonne), La Galinette (Perpignan), Le Saint Hilaire (Saint-Hilaire-de-Brethmas) et La Bastide de Moustiers (Moustiers-Sainte-Marie).
Le meilleur cresson est celui qui pousse au début du printemps. Ce légume crucifère est riche en antioxydants, en bêta-carotène et en vitamine C. En effet, 50g de cresson cru fournit près de 1500 µg de bêta-carotène et 30 mg de vitamine C. Il apporte aussi du calcium (200 mg/100g), du fer, du phosphore, du manganèse, du cuivre, du zinc, de l’iode (15 à 45 mg/100g), vitamine A, B, PP, E. Excellent pour la vitalité.
En salade, bien sûr, avec la vinaigrette de votre choix, mais aussi dans un sandwich ou dans une soupe. On peut aussi le mixer en sauce pour napper du poisson (le cabillaud se marie bien avec le cresson). Rehaussez-le avec une pointe acidulée d’orange ou de pamplemousse. Et pourquoi pas de l’huile d’olive et une pointe d’ail à la mode basque ? Le cresson se vend frais, en barquettes ou en bottes. Choisissez-le d’un beau vert foncé, non flétri ni jauni.
La France cultive du cresson depuis près de trois siècles.
Le jus de cresson (comme le persil) aurait des propriétés intéressantes pour traiter certaines alopécies (pertes de cheveux). À l’extracteur, recueillez son jus et frictionnez-vous le cuir chevelu avec. Le jus serait aussi bénéfique contre l’acné. Bien sûr, cela ne dispense pas d’une visite chez un professionnel de santé.
Rincez votre cresson en le trempant dans une eau vinaigrée.
S’il ne provient pas de cressonnières officielles, le cresson peut être contaminé par des parasites. On appelle fasciolase l’infestation par la douve du foie (fasciola hepatica). Pour éviter cela, ne consommez surtout pas de cresson sauvage.
Corinne Hucteau, diététicienne nutritionniste à La Roche-sur-Yon, est notre invitée.
Bénédicte Perrot a eu l’idée de créer la marque Vidiamo afin de satisfaire son besoin de maman. Le nom de son entreprise est le raccourci de Victoire, Diane et Amaury, le prénom de ses trois enfants.
Bénédicte a eu envie de créer une poussette innovante et unique au monde pour faciliter la vie des parents. Elle a d’abord réfléchi à toutes les options qu’elle aimerait trouver sur une poussette et s’est ensuite lancée dans la concrétisation de son projet. Il a fallu 9 ans pour réussir à le concrétiser. « J’ai inventé la seule poussette au monde qui passe de simple à double en un clic. J’ai eu des problèmes personnels, j’ai eu trois enfants et j’ai acheté cinq poussettes différentes. Mais je me suis retrouvée plein de fois en galère. L’idée m’est venue d’ajouter un petit strapontin caché sous l’assise principale qui peut être déployé à n’importe quel moment facilement », explique la créatrice de Vidiamo.
Bénédicte ne s’est pas arrêtée là. Sa poussette cumule des options toutes aussi ingénieuses les unes que les autres. Lit d’appoint, table à langer, accroche trottinette… L’objectif est toujours le même : faciliter la vie de la famille.
Depuis son passage en janvier dans l’émission de M6 « Qui veut être mon associé ? », Bénédicte reçoit de nombreux témoignages de parents. « J’ai eu beaucoup de messages. C’est vrai que beaucoup de parents m’ont dit qu’ils se sentaient concernés. J’ai réussi à convaincre l’un des associés, Eric Larchevêque. Il a vu l’intérêt du projet. Il m’aide régulièrement et continue à me soutenir depuis l’émission. »
Un local d’une centaine de mètres carrés. Au milieu, ce qui ressemble à des bureaux. Sur les côtés, d’immenses étagères qui montent jusqu’au plafond. Bienvenue à Ma Bibliothèque d’objets (MBO). Sur les étals, pas d’Agatha Christie, Proust ou autres Amélie Nothomb. Ici, il est possible d’emprunter non pas des livres, mais de nombreux objets : machine à popcorn, appareil à raclette, chaînes à neige, siège auto, tondeuse ou perceuse.
L’idée, derrière ce concept prônant une consommation raisonnable, est de louer des objets à usage occasionnel à des prix accessibles. Le principe est simple : le client paye une cotisation à l’année puis, à chaque emprunt d’une durée de six jours, il verse un complément. Par exemple, 10 euros pour l’appareil à raclette, 15 euros pour le rotofile, 30 euros pour le barnum. Le catalogue compte près de 300 objets.

“L’objectif est de susciter le réflexe de l’emprunt. J’emprunte et je n’achète pas. On voulait trouver une solution face aux enjeux de surconsommation”, explique Fabien Estivals. Avec Marie Boillot, ils ont développé ce concept à Toulouse pendant le confinement. Aujourd’hui, il est installé près des Halles de la Cartoucherie et compte neuf points de retrait dans la ville.
La MBO a su conquérir son public puisque l’association recense quelque 1000 adhérents. Néanmoins, avec ces prix très attractifs, la question du modèle économique qui se pose. La structure vit sur les adhésions, mais aussi sur les fonds publics. Elle tente par ailleurs de se diversifier. “Nous proposons régulièrement des ateliers de sensibilisation pour attirer de nouveaux publics : fresques du climat, voyage en 2030 Glorieuses, réparation d’objets et de vélos…”
La bibliothèque d’objets n’est pas un concept exclusivement toulousain. Il en existe ailleurs, notamment à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Là-bas, les bénéficiaires payent uniquement la cotisation annuelle à l’association. La BOM est par ailleurs adossée à un tiers-lieu qui propose diverses activités autour de la déconsommation.
À Lyon, Émilie, Ophélie, Mathieu et Valentin travaillent tous les quatre pour Elmy, un acteur français spécialisé dans les énergies renouvelables. Bien renseignés sur la question de l’énergie, ces quatre amis ont alors imaginé un jeu simple et pédagogique pour sensibiliser aux économies d’énergie. Avec KiloWhat, ils proposent aux petits et aux grands de s’amuser tout en découvrant les enjeux de la précarité énergétique.
Cette précarité énergétique est de plus en plus présente aujourd’hui. Elle se traduit par l’incapacité à subvenir à ses besoins énergétiques. Valentin Thiriet, l’un des cofondateurs, explique les avantages d’un jeu de cartes pour sensibiliser et pousser chacun à agir en faveur d’une consommation énergétique plus juste.
Porté par l’association Joule Jeu Éditions, également créée à l’occasion, le jeu KiloWhat est accessible à tous les âges. Chaque carte représente ainsi un équipement du quotidien avec sa consommation énergétique annuelle. Il faut placer ces cartes dans l’ordre et jauger la consommation de ces équipements.
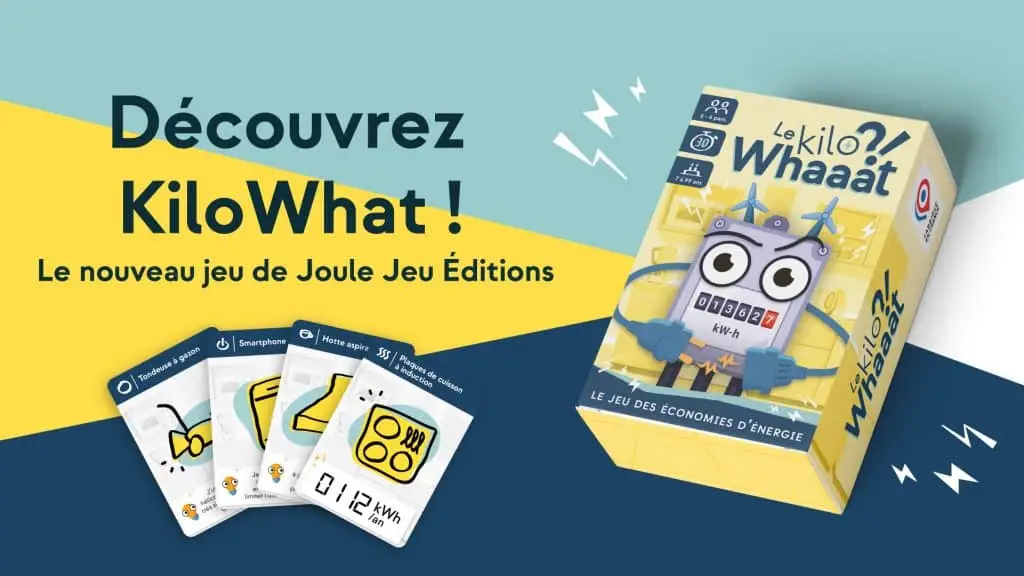
Une autre manière de jouer s’appuie par ailleurs sur le principe de la bataille en s’appuyant toujours sur les chiffres indiqués. Les cartes proposent également des conseils pour réduire sa consommation. Selon Valentin, c’est un moyen efficace et ludique pour initier les enfants grâce à un jeu facile à prendre en main. À terme, l’équipe aimerait soutenir les autres acteurs engagés dans l’énergie verte et solidaire. Avec la campagne de financement participatif Ulule, KiloWhat a par exemple pu soutenir l’association Stop à l’exclusion énergétique.
Les pénuries de médicament sont davantage fréquentes en France, d’après le bilan annuel de l’Agence nationale de sécurité du médicament. Plus de 4 900 signalements de ruptures ont été faits l’année dernière, soit 30 % de plus qu’en 2022. En cause : les besoins qui augmentent et la production qui ne suit pas.
« Au lieu d’appeler une par une les officines, vous pouvez vous géolocaliser et avoir le nom de pharmacies avec du stock », explique Nicolas Schweizer, fondateur de Pharmao. Cette solution de livraison vient en effet d’ouvrir cette offre complémentaire qui donne accès aux stocks des pharmacies. En moyenne, il est possible de trouver un produit dans un rayon de 12 km autour de chez soi.
Qui n’a pas un tiroir rempli de boites entamées de médicaments en tout genre ? Il ne faut pas hésiter à se servir des comprimés que l’on a déjà, à condition qu’ils ne soient pas périmés. Dans le doute, mieux vaut les ramener à son pharmacien. Ce dernier indiquera alors s’ils sont toujours bons. Si ce n’est pas le cas, il les gardera pour les recycler.
S’il y a parfois des pénuries, il y a aussi l’effet inverse : les surstocks en parapharmacie. « Sur notre site, vous pouvez également trouver des produits en promotion. Cette solution antigaspi met en avant les produits en surstock ou bientôt périmés (3-4 mois) pour qu’ils soient consommés en priorité », explique le fondateur de Pharmao. Selon lui, 4 tonnes de produits de parapharmacie ne sont pas mis à la vente, pas consommés et jetés.
Rencontrés à l’occasion d’un événement autour des vins de Blaye, l’un s’est converti au bio en 2009 avant de passer au vin nature en 2014, sans sulfite ajouté. La seconde a repris l’exploitation familiale, en 2000, avant d’entamer sa conversion en 2019. Ils nous racontent.
Céline Martineau, vigneronne sur 47 hectares en Blaye Côtes de Bordeaux : « Il y a longtemps que je réfléchissais à retravailler mes vignes comme mes grands-parents, mes arrières grands-parents. Puis j’ai eu des enfants, soucieux de la nature. J’ai repensé mon travail autrement et décidé de me lancer dans la bio. Cette conversion, je l’ai vécue difficilement. J’ai vécu le gel, la grêle. Mais j’ai gardé cet état d’esprit positif, en me disant “allez, on redémarre”. Aujourd’hui, mes vignes atteignent le rendement de l’appellation. Le bio n’est pas un problème. C’est du temps, de la main d’œuvre, de l’argent mais, au bout du compte, quand on voit les raisins, les cuvées, on est très fiers. J’ai l’impression d’avoir été au bout de quelque chose. »
Céline Martineau adhère la cave coopérative de Tutiac, qui réunit 500 viticulteurs.
Thomas Novoa, Château les Garelles, en Gironde : « Après des études en agronomie et en œnologie, j’ai décidé de reprendre les rênes du domaine familial, en 2009, avec une ambition : le retour à la nature. Dès mon arrivée, j’ai entamé la conversion du domaine à l’agriculture biologique. Je suis passé en bio, puis en biodynamie (Demeter) et vin nature en 2014, sans sulfite ajouté, en rouge, rosé et blanc. C’est une succession de contraintes supplémentaires, mais qui rentrent dans le fil conducteur de l’élaboration du vin que l’on souhaite faire pour le consommateur et pour nous. »
Thomas Novoa a rejoint le collectif Vignobles Gabriel, qui regroupe une trentaine de vignerons.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
“J’ai rencontré, en 2023, une chargée de mission du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, qui était engagée dans un projet européen pour revaloriser la filière laine dans le département des Alpes-Maritimes. On a échangé sur la possibilité de monter des expérimentations avec de la toison de mouton qui ne pouvait pas être valorisée en laine et de la tester en paillage et en maraichage”, explique Sylvie Soave, professeure d’agronomie au campus vert d’Azur d’Antibes.
C’est donc ce projet qu’elle souhaite porter pour cette année scolaire avec ses élèves de terminale.
Cette année, Sylvie et ses élèves ont eu la chance de présenter leur projet One health tous unis, au Salon de l’agriculture. C’était un moment important pour les élèves qui ont choisi l’unité facultative Engagement citoyen qui compte pour leur baccalauréat. Ils ont réfléchi à plusieurs objets composés de laine avant d’expliquer comment s’en servir dans une activité agricole. “Actuellement, la toison de mouton est stockée chez les éleveurs du département. Les éleveurs n’arrivent plus à valoriser le prix de la tonte. Ils ne savent pas quoi en faire.” Ils ont donc réfléchi à la possibilité d’en faire des disques de paillage pour protéger les plantes. Ces disques lutteraient efficacement et sans chimie contre l’invasion des mauvaises herbes. Ils isoleraient la terre des températures extérieures et des gels nocturnes qui durcissent et assèchent cette terre. Cette laine pourrait ainsi devenir une autre source de revenus pour les agriculteurs.
À partir du mois de mai, Sylvie et ses élèves partiront dans les Alpes-de-Haute-Provence à la rencontre d’éleveurs. Ils mèneront alors une enquête afin de déterminer les problématiques auxquelles ils sont confrontés et réfléchir sur comment relancer cette filière laine.
Voilà une idée qui risque rapidement de faire des petits. Né à Marseille, le projet Santafoo s’exporte déjà à Aix-en-Provence. Accessible sur smartphone, l’application propose déjà plus de 1 000 produits sélectionnés selon une charte très stricte à ses clients.

Parmi ceux-ci, un peu de tout, comme dans un magasin classique, mais à des prix abordables et, surtout, les produits sont locaux. Tous proviennent de producteurs et d’artisans de la région, engagés dans une démarche écoresponsable. Objectif ? Réduire l’empreinte carbone des aliments à l’assiette.
L’aventure a débuté à Marseille. Les livraisons de Santafoo ont ainsi lieu tous les jours de 9 à 21 heures uniquement à vélo et scooter électriques. Les Saints du Goût, comme ils se désignent, comptent à travers la ville déjà plus de 2 000 clients actifs qui peuvent se faire livrer en une heure ou sur des créneaux planifiés.
Après Marseille, Santafoo s’est depuis peu installé à Aix-en-Provence. Et l’entreprise ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, la jeune start-up ambitionne de devenir la « plateforme incontournable des courses en ligne responsables en France » en s’implantant dans plus de 200 villes françaises d’ici 2030.
Pour aller plus loin > A Marseille, Samedi Bien veut encourager l’engagement associatif
Bien que – au minimum – centenaire, le kéfir est, depuis une dizaine d’années, redevenu une boisson dont on parle et que l’on consomme au même titre qu’un soda. Il est vendu dans le commerce, principalement en magasin bio ou encore dans quelques supermarchés audacieux qui sentent le vent tourner.
Plusieurs marques de kéfir se créent chaque semaine et le consommateur a aujourd’hui le choix. L’avantage du kéfir, par rapport à un soda, est à la fois son côté pétillant naturel, grâce à la fermentation, mais également son aspect santé. Alors qu’il n’y a pas d’étude officielle qui affirme directement un lien entre « kéfir » et « bon pour la santé », les personnes qui, par exemple, ont le syndrome du côlon irritable ressentent un véritable « mieux être » après en avoir bu.
Le kéfir reste cependant un produit mystérieux. Alors que la boisson doit obligatoirement avoir des grains de kéfir pour en avoir la dénomination, difficile de savoir où et quand il est né. Pire que cela, on n’arrive pas à en créer. Il faut, d’abord, obligatoirement avoir des grains de kéfir pour en avoir… encore plus ! L’histoire de l’œuf et de la poule.
Aujourd’hui, le Muséum national d’Histoire naturelle se penche sur le kéfir avec une question : si on sépare en mille parties une souche de kéfir que l’on connaît bien et qu’on la confie à mille foyers à travers la France, va-t-il évoluer de mille façons différentes ?
Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et spécialiste de l’alimentation, est à la tête de cette étude et explique le pourquoi du comment de cette grande étude.
Dans la famille Barberon, on peut dire qu’on a la main verte. Surtout qu’on aime avoir les pieds dans l’eau et vivre au contact de la nature. En effet, trois générations de cressiculteurs se sont succédé. « Mon père Jacky est cressiculteur. Mon oncle Serge et ses fils le sont aussi », explique Vincent Barberon, lui-même cultivateur de cresson dans le sud de l’Essonne. Si le cresson est sa culture principale, depuis quelques années, il se diversifie et s’est lancé dans la production de wasabi. Une denrée rare en France.
Vincent est un des rares à s’être lancé dans la production de wasabi. Il a déjà une petite production locale, bien connue des initiés. En effet, les Japonais considèrent son wasabi comme un des leurs, c’est dire le niveau de qualité.
Vincent est tombé dans le wasabi quand il était enfant. C’est lors d’une réunion, à laquelle il accompagnait son père, qu’il en a entendu parler pour la première fois. Un Japonais cherchait alors des volontaires en France pour en cultiver localement. Personne à l’époque ne s’était montré intéressé, se rappelle Vincent. Mais l’idée est restée dans un coin de sa tête.
Devenu agriculteur, il tente alors de se lancer. Au début, rien ne prend. Puis, plusieurs années après ses premiers échecs, il rencontre Maiko, spécialiste japonaise de la culture du wasabi. De cette rencontre est né un partenariat. La patience, les nombreux échanges avec les producteurs japonais et un peu de magie auront permis à Vincent de réussir. Au point d’être désormais reconnu par ses pairs nippons.
Pour aller plus loin > Dans les Yvelines, une ferme écoresponsable souterraine
Chaque année, 670 millions de tonnes de CO2 sont émises en France. Pour autant, il est difficile de savoir quelles habitudes changer si on ne connait pas leur impact. Pour tout comprendre de notre empreinte carbone, le chercheur et écrivain anglais Mike Berners-Lee publie « Peut-on encore manger des bananes ? » aux éditions l’Arbre qui marche.
Dans son livre, Mike Berners-Lee regroupe de nombreux actes du quotidien, classés du moins polluants aux plus polluants. Parmi eux : envoyer un mail, manger des bananes, utiliser le lave-vaisselle, prendre un bain, avoir un enfant, stocker massivement des données data, déforester…

Sorti en 2010, le premier exemplaire de ce livre était en anglais. “How Bad are Bananas ?” est rapidement devenu rapidement un bestseller. Pour cette réédition française, 14 ans plus tard, tout à changer. « J’ai dû faire une énorme mise à jour. L’agenda climatique s’est accéléré. L’approche de ce livre a donc évolué. J’ai également tout adapté à votre culture et votre pays. Votre consommation d’électricité est différente, par exemple. C’est un projet très important », explique l’auteur.
S’il conseille de manger local et de saison, il n’est pas catégorique pour autant. Oui, on peut continuer à manger des bananes car si le fruit vient du bout du monde, il pousse au soleil, sans serres, voyage en bateau et n’a pas besoin d’emballage ou une conservation exigeante.
Dans « Peut-on encore manger des bananes » Mike Berners-Lee renseigne par exemple sur l’empreinte carbone d’une planche apéro. Alors, peut-on encore manger du fromage, du vin,du pain et de la charcuterie sans culpabiliser ? Oui et non. Aucun problème pour le pain et le vin si l’on en croit l’auteur (avec modération). En revanche, pour le fromage et la charcuterie, cela sollicite l’élevage. « On utilise trop de culture pour nourrir les animaux et ensuite nous nourrir, c’est très peu efficace d’un point de vue carbone. Il faudrait réduire notre consommation de produits laitiers et carnés, en mangeant de la meilleure qualité », précie Mike Berners-Lee. Alimentation, transport, consommation, logement, banques… L’important est de choisir les bons acteurs.
« Peut-on encore manger des bananes ? » est disponible depuis le 14 mars dans toutes les librairies. Mike Berners-Lee est également l’auteur de “Il n’y a pas de planète B”, qualifié par le “Financial Times” de “manuel pour transformer l’humanité”.
Muelle Hélias est l’autrice du livre « Végétal et complet : l’alimentation brute et naturelle pour toute la famille » (éditions Solar). Photographe engagée et créatrice de recettes, elle est aussi la maman de deux petites filles.

« J’étais journaliste dans la presse écrite pendant quelques années et, ensuite, je suis devenue maman en 2013 d’une petite fille extraordinaire, porteuse d’une maladie rare. Ça a un peu chamboulé notre vie. Elle a un syndrome de croissance excessive, qui implique qu’elle est plus à risque de contracter des cancers ou des maladies cardiovasculaires, etc. Mais je dis extraordinaire, car c’est une petite fille qui nous apporte beaucoup de bonheur. Nous avons beaucoup de chance d’être devenus parents de Mila. J’ai continué à bloguer pour ne pas perdre la main lorsque je suis devenue maman. »
Au bout de quelques années, Muelle décide de s’intéresser à l’alimentation pour protéger et préserver sa santé. « Nous avons appris que notre fille était allergique aux œufs et aux protéines de lait du jour au lendemain. Elle avait déjà 4 ans. Nous avons donc dû cuisiner sans ces produits-là. Je me suis renseignée sur l’alimentation. Je suis tombée sur des résultats de recherches scientifiques qui montrent qu’un régime existe », explique Muelle.
Elle découvre alors le « Whole Food Plant Based », qu’elle traduit par alimentation végétale et complète. Il s’agit de cuisiner le plus naturellement possible, avec des ingrédients bruts, simples, non raffinés et issus de la nature. « On élimine donc tous les produits d’origine animale et on réduit au maximum les produits transformés. En éliminant ce qui nous rend malade et en fournissant à notre corps ce qu’il y a de meilleur pour lui. On lui offre les nutriments purs. »
“Végétal et complet”, de Muelle Hélias, éditions Solar.
Si la part de marché du vélo classique est en net recul, c’est tout l’inverse pour celle de l’électrique qui ne cesse de grimper. Et pour cause, avec un vélo musculaire, on estime qu’une personne va se déplacer dans un périmètre de 5 à 6 km en moyenne autour de son domicile pour se rendre au travail. Avec un vélo électrique, les distances s’étendent à 10, voire 15 km, soit quelque 30 à 40 minutes de transport, sans efforts.
L’électrique, petite révolution dans le monde de l’écomobilité, permet aux sportifs, mais surtout à ceux qui ne le sont pas, qui ont peur d’une côte un peu raide sur leur trajet ou qui n’ont pas de douche ou de vestiaire à l’arrivée, de prendre plus facilement le vélo pour se rendre au travail.
Bee.Cycle l’a bien compris et a été l’une des premières sociétés à s’engouffrer dans l’aventure du leasing de vélos en entreprise en France. C’était en 2019. “C’était quelque chose qui me parlait, qui existait et était déjà assez développé chez nos voisins, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre”, raconte Jean-Christophe Melaye, président de la société Bee.Cycle. Sans compter sur l’arrivée du plan vélo 2019 et, avec lui, des mesures d’incitations gouvernementales, lesquelles ont changé la donne pour les récalcitrants.
Avec le leasing, chaque entreprise va chercher à résoudre des problématiques qui lui sont personnelles. Certaines équipent leurs collaborateurs de vélo lorsque le stationnement manque à proximité, parce que le secteur est mal desservi par les transports en commun ou encore parce que le parking est trop petit et qu’il faut limiter le nombre de véhicules. D’autres souhaitent avant tout inciter leurs collaborateurs à bouger plus ou les alléger du stress des embouteillages avant même la journée commencée. D’autres encore s’engagent pour un meilleur bilan carbone ou cherchent à attirer de jeunes talents très sensibles aux questions environnementales.
Notre philosophie est de dire qu’on ne va pas révolutionner le monde, mais que l’on va y aller petit à petit, même en commençant avec un seul vélo, explique Jean-Christophe Melaye. Un seul collaborateur peut avoir négocié une contribution vélo dans son contrat de travail. Cela nous permet d’entrer dans l’entreprise, de montrer que ça marche et que ça ne coûte pas très cher. Et ensuite, peut-être que l’on aura l’opportunité d’en signer d’autres.”

Pour Bee.Cycle, les entreprises sont la clé. Leur engagement change tout en matière de prix d’acquisition d’équipement. “Les collaborateurs n’ont pas forcément les moyens. Et on ne raisonne pas de la même manière si l’on doit débourser 2000 euros d’un coup ou sortir 20 euros par mois.”
Outre le vélo en lui-même, Bee.Cycle propose un catalogue quasiment illimité de services, car la société s’appuie sur des prestataires. Ainsi, l’entreprise qui souhaite sauter le pas peut demander une formation, de tester des vélos, des stages de remise en selle, des entraînements sur simulateurs, des installations de parkings à vélo, d’arceaux, de locaux spécifiques liés à l’utilisation des bicyclettes. “On peut faire du sur mesure, ce n’est qu’une question de volonté.”
Une volonté gouvernementale, métropolitaine, municipale également. “Si on veut inciter un collaborateur à prendre son vélo, il faut qu’il y ait des infrastructures. C’est là où on a aussi besoin du gouvernement et des villes pour qu’elles continuent à équiper les communes, que ce soit d’infrastructures de sécurité aussi bien que d’infrastructures routières.” La sécurité des déplacements et la présence d’équipements cyclables dignes de ce nom restent les leviers principaux pour se lancer.
Le meilleur exemple en la matière reste encore les Pays-Bas, qui ont réalisé un net virage dans les années 1980, soutenus par une puissante volonté politique pour sortir du “tout voiture”, au moment de la crise pétrolière. Pari qui, on ne peut plus en douter aujourd’hui, a porté ses fruits.

“Une fois qu’on a goûté au vélo en ville, on ne fait pas marche arrière, s’enthousiasme Jean-Christophe Melaye. On maîtrise son temps, on sait où se garer. Aujourd’hui, 50% des distances de 1 km se font en voiture. En 2022, ce sont 800 000 vélos en leasing qui circulaient en Allemagne, contre 12 000 en France à la même période. Donc on est encore au début. On a été biberonné à la voiture, c’est culturel. Ça va être long, mais on va y arriver !”
Autre avantage avec le vélo de fonction, c’est que, contrairement à la voiture du même nom, il n’y a pas de calculs d’avantages en nature. On peut donc l’utiliser pour emmener nos enfants à l’école, faire nos courses ou partir en week-end et en vacances, en avoir une utilisation personnelle donc. On peut s’équiper d’un VTT ou d’un long tail, d’un cargo ou d’un long john, tout dépend si l’entreprise laisse le choix ou non aux collaborateurs du type de vélo qu’il pourra acquérir. Un bon plan. En passant par l’entreprise, laquelle est incitée par le gouvernement via une récupération fiscale, la répartition entre ce que paye l’employeur, l’État et le collaborateur permet de s’équiper dans la limite de 30 euros par mois maximum, réparations et entretien compris. Plus aucune raison de ne pas se rendre au travail à vélo !
Des œufs, des poules, des cloches, des lapins, des poissons au chocolat noir ou au lait enrubannés. La vitrine de la Maison Saunion est bien garnie pour Pâques. Située 53 Cours Georges Clemenceau, à Bordeaux, cette chocolaterie fondée en 1893 est aujourd’hui gérée par Thierry Lalet. Il est la quatrième génération de maître chocolatier-confiseur.

« Pour nous, Pâques est la deuxième forte période de l’année. Noël représente à peu près 50% de notre chiffre d’affaires. Pâques va représenter 15% à 20% de l’activité sur une année. C’est donc un événement important, explique l’artisan. Mais à la différence de Noël, là, tout est autour du chocolat avec les moulages, les bonbons de chocolat… » Au total, l’artisan utilise entre 1t et 1,5 t de chocolat pour cette fête.
C’est dans l’immeuble voisin à la boutique que se trouve le laboratoire, réparti sur deux étages. L’équipe, composée de sept personnes, est divisée entre les différents postes de production. Si, l’an dernier, elle a travaillé sur le thème du mouton, cette année, et Pâques tombant le 1ᵉʳ avril, le jour des farces, « on s’est dit qu’on allait jouer sur le côté marin, dit en souriant Thierry Lalet. On a créé le piranha, qui est plus rigolo qu’effrayant. Il est bien garni parce que le but, ce n’est pas d’avoir que le moulage, c’est que quand le client va le découvrir, il va vouloir le casser ou croquer dedans. Pâques a un côté un peu féérique et enfantin. On est tous contents, peu importe l’âge, d’avoir une poule, un œuf ou un poisson à partager ».


D’ailleurs, la chocolaterie Saunion a obtenu le label d’État Entreprise du patrimoine vivant, « mis en place pour distinguer des entreprises françaises, artisanales et industrielles au savoir-faire rare et d’exception ». En effet, concevoir certains produits va nécessiter une certaine technicité, notamment la spécialité de la maison, le Gallien de Bordeaux, ou encore les petits œufs. « On a une technique un peu ancienne, voire ancestrale, qui consiste à prendre des demi-coques qu’on garnit avec un couteau, qui ressemble à un couteau à beurre, soit de pâte d’amandes, de praliné ou de ganache. On les colle l’une contre l’autre. Puis, ça part en pliage manuel. C’est l’équipe du magasin qui va les plier. » 20 000 œufs sont ainsi conçus et garnis rien que pour Pâques.
Mais le produit star de l’établissement Saunion est un œuf vidé, nettoyé, rempli de praliné. Au-dessus, se trouve une tête de cochon en amandes. « Ça marche aussi bien chez les grands que les petits. C’est rigolo ! » s’en amuse Thierry.
Selon le syndicat du chocolat, chaque foyer français consomme en moyenne 13 kg de chocolat par an.
C’est au cœur des Aygalades, dans les quartiers nord de Marseille, que les locaux de la Savonnerie du Midi sont installés. Le savon traditionnel de Marseille y est fabriqué depuis 1894. Guillaume Fievet, président de la Savonnerie du Midi, aime partager l’histoire de son entreprise mais aussi son savoir-faire.

Mais qu’est-ce qu’un véritable savon Marseille ? « Le premier critère, c’est que le savon doit être saponifié à Marseille ou dans sa région. C’est-à-dire fabriqué sur place. Ça semble évident, mais ça ne l’est pas. Saponifier à Marseille, ça veut dire mélanger dans des grands chaudrons, des huiles végétales et de la soude pour que la transformation chimique se fasse. Il y a très peu d’ingrédients. Deuxième critère, c’est le procédé. Un procédé artisanal, une cuisson au chaudron qui dure 7 à 10 jours avec des étapes de lavage bien précises. On appelle ça le procédé marseillais. Enfin, dernier critère, c’est un critère d’ingrédients. De l’huile végétale uniquement. Nous n’utilisons pas de graisse animale. Nos savons ne contiennent que des ingrédients naturels. Pour résumer, pour le savon de Marseille, il y a trois critères essentiels : géographique, de procédé et un critère d’ingrédients », explique Guillaume Fievet
La Savonnerie du Midi a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label récompense un savoir-faire d’excellence. Depuis quelques années, il est également possible de visiter l’usine et le Musée du Savon de Marseille. Un moyen de continuer à faire découvrir l’histoire de l’entreprise, mais aussi de tisser du lien entre les clients et les artisans de cette savonnerie authentique.
Elle donne de l’espoir aux viticulteurs qui ont testé sa solution. L’entreprise Immunrise Biocontrol, créée en 2016 près de Bordeaux, identifie et développe des solutions puisées dans la nature pour assurer la protection des cultures. « D’où l’intérêt de protéger notre environnement qui recèle de beaucoup de solutions pour demain », souligne Laurent de Crasto, directeur général d’Immunrise Biocontrol.
À ce stade, la société a mis au point un produit de biocontrôle à partir d’une microalgue pour prévenir les maladies telles que le mildiou. Il a été testé sur des vignes en Gironde, dans le vignoble de Cognac et en Champagne.
« Ce produit peut être une bonne alternative aux produits chimiques, mais aussi au cuivre, sachant que les quantités utilisables par hectare se réduisent chaque année. Il va donc falloir un produit qui prenne le relais et vienne en renfort pour réduire les quantités d’intrants chimiques. Notre produit est aussi naturel, biodégradable. Il ne laisse pas de résidu. Enfin, il y a un effet ciseau du produit qui a un effet contre la maladie sans impacter l’environnement et la santé des consommateurs. Ces produits de biocontrôle doivent être développés », explique Laurent de Crasto.
Reste toutefois à faire homologuer le produit pour le commercialiser. L’entreprise vise désormais 2028/2029. Trop long ? Des voix se sont élevées, notamment celle d’Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine et du député Frédéric Zgainski.
Une autre option consisterait à ce que la France donne des autorisations de mise sur le marché provisoires sous réserve que le dossier soit construit et validé. « Ce système préexistait il y a une vingtaine d’années », explique Laurent de Crasto qui a récemment écrit en ce sens à Emmanuel Macron. « Cela permettrait de gagner trois ou quatre ans qu’il faudrait, de toute façon, à l’Europe pour homologuer le produit. » Immunise Biocontrol réfléchit parallèlement à lancer d’autres homologations pour d’autres parties du monde.
Alors qu’il débarque à Lyon, Nathan nourrit la volonté de bien s’habiller, mais perd beaucoup de temps à choisir ses vêtements. En parallèle, il découvre l’impact considérable de la mode sur la planète. L’empreinte carbone de ce secteur est en effet estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2 dans le monde. Avec Malo, il décide alors de créer l’application Daymode pour réinventer nos dressings.
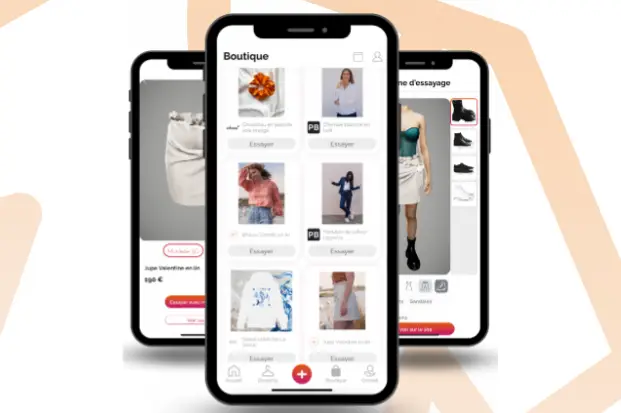
L’utilisateur peut ainsi enregistrer ses vêtements sur l’application qui viendra lui apporter des conseils et des suggestions de tenues. Pensées selon la météo, ces tenues s’adaptent aussi au style de l’utilisateur. La styliste de l’équipe, aidée de l’intelligence artificielle, s’occupe de mettre à jour les textures et les coupes.
Selon Nathan, Daymode remplit deux objectifs. Avec ce dressing virtuel, chacun a facilement accès aux vêtements qu’il peut porter au quotidien. En ayant accès simplement à ses affaires, l’utilisateur aura ainsi moins l’envie d’acheter des vêtements et commencera par redécouvrir les siens. Daymode met par ailleurs en évidence les habits qui ne sont plus portés et qui pourront alors être mis en vente ou donnés.

L’autre objectif de Daymode est de proposer des alternatives responsables. L’application rassemble ainsi des marques écoresponsables françaises qu’il est possible d’essayer virtuellement. Nathan revient d’ailleurs sur la nécessité de mettre en lumière ces marques qui prônent une mode responsable et durable. À terme, il espère co-construire cette application et les fonctionnalités avec la communauté pour répondre aux attentes de chacun.
Récupérer les fruits et légumes invendus des supermarchés pour les transformer en fruits secs ou les cuisiner. C’est justement ce que propose l’association Havre de Vers. Depuis quelques années déjà, la structure récupère les fruits et légumes invendus des supermarchés aux alentours du Havre. Elle les transforme ensuite et les revend dans des épiceries locales. Un bon moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire et de sensibiliser le grand public.
Spécialisée dans le compostage et la permaculture, l’association Havre de Vers a d’abord eu l’idée de récupérer les invendus pour en faire du compost. En constatant que beaucoup de produits étaient encore comestibles, Léo Massé et Marian Toxé ont eu la brillante idée de les cuisiner, puis de déshydrater les fruits pour en faire des fruits secs. Et, enfin, de les mettre en vente pour les adhérents de l’association, mais aussi dans une boutique de vrac havraise.
En moyenne, entre 80 et 100 kilos d’invendus sont récupérés à chaque collecte. En moyenne, 15 kilos de fruits secs sont produits par mois.
Pour aller plus loin > Environnement : comment se mettre au compost ?