
EN DIRECT
AirZen Radio
1ère radio 100% positive
Selon l’INSEE, le nombre de seniors en perte d’autonomie en France passera de 2.5 millions en 2015 à 4 millions en 2050. Aujourd’hui, penser le bien-vieillir, c’est s’orienter en première instance sur le maintien à domicile.
Cela passe en priorité par l’adaptation des logements pour prévenir le risque de chute, responsable de milliers d’hospitalisations de seniors chaque année. Ces chutes se produisent majoritairement dans un escalier, le salon, la chambre ou la salle de bain, selon une récente étude de l’IFOP.
Pour répondre à ces problématiques, l’État a mis en place le dispositif MaPrimeAdapt’. Accessible depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, cette aide permet de financer des travaux d’adaptation des logements, comme un monte-escalier ou une salle de bain de plain-pied avec barre d’appui.
Celle-ci peut s’obtenir à partir de l’âge de 70 ans ou plus tôt si une perte d’autonomie est prouvée. Elle est soumise à des conditions de ressources. Certaines structures, comme l’association Soliha ou le réseau d’agences Dom&Vie peuvent accompagner les particuliers pour son obtention.
Pour tout savoir de MaPrimeAdapt’ et y voir plus clair sur les conditions requises, nous vous invitons à écouter, dans l’ordre, les 3 capsules sonores disponibles.
Le MuMo est un véritable musée sur roues, aménagé dans un camion. Ce camion-musée transporte des œuvres d’art, de grands formats aux sculptures, en passant par des installations immersives. « L’idée est de rendre l’art accessible à tous, de franchir les frontières géographiques et sociales pour amener l’art directement aux enfants », explique Ingrid Brochard, sa fondatrice.
Le MuMo parcourt ainsi les écoles, les places de village et les quartiers pour proposer aux enfants une expérience artistique. «.

Chaque exposition est pensée pour être immersive et ludique, adaptée au jeune public. Les enfants peuvent ainsi toucher certaines œuvres, se plonger dans des installations interactives et découvrir des artistes contemporains qui leur parlent de thèmes actuels. « Notre but est de permettre aux enfants de vivre un moment d’évasion, de s’émerveiller et d’oser poser des questions », précise Ingrid Brichard.
Depuis sa création, le MuMo a accueilli des milliers d’enfants. « On voit souvent des enfants transformés par cette expérience, même ceux qui n’avaient jamais mis les pieds dans un musée auparavant. C’est ce qui nous pousse à continuer et à aller toujours plus loin. »
À Villeurbanne, près de Lyon, les quatre résidences autonomie du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) acceptent depuis quelque temps les animaux de compagnie. Que ce soient des chats, des petits chiens ou encore des canaris, les seniors peuvent ainsi aujourd’hui vivre avec leurs animaux. Tout en respectant plusieurs conditions, ils ont la possibilité d’aménager leur logement pour assurer le bien-être de ces nouveaux pensionnaires.
Pour Marie Caballero, la directrice de la résidence Marx Dormoy à Villeurbanne, la présence de ces animaux a de nombreux bienfaits sur les résidents. Ils favorisent notamment la mobilité des personnes âgées, qui doivent ainsi les promener régulièrement, jouer avec eux ou encore assurer leur propreté.
Par exemple, pour Colette Lopez, résidente au sein de la résidence Marx Dormoy, sa chatte Tina lui procure beaucoup de bien-être et de sérénité. Grâce à son animal, elle se sent en effet moins seule le soir, après le repas. Elle espère que cette initiative se développera au sein des logements adaptés aux seniors pour ainsi faciliter le bien-vieillir.
Découvrez quels sont les bienfaits des animaux de compagnie acceptés au sein des logements adaptés aux seniors.
Selon l’INSEE, la population des 75-84 ans va croître de 25% d’ici à 2030. C’est pourquoi, il est aujourd’hui nécessaire d’imaginer des solutions favorisant le bien vieillir. Agnès Dupuy travaille avec des seniors depuis de nombreuses années. Avec l’aide de ses trois associés, elle a imaginé Senioryta, un nouveau concept d’habitat partagé pour les seniors en perte d’autonomie.
À taille humaine, cette initiative espère ainsi lutter contre l’isolement et répondre aux besoins grandissants des familles.


Ces maisons partagées s’apparentent à des colocations, où chaque locataire est libre de faire ce qu’il souhaite. Les résidents disposent alors d’un espace privatif et partagent les pièces de vie. Pour Agnès, Senioryta se positionne comme une solution alternative à l’EHPAD. Non-médicalises, ces maisons sont moins chères et s’appuient sur la présence d’auxiliaires de vie. Ces derniers accompagnent en continu les habitants et se relaient pour assurer une présence 7j/7 et 24h/24. Ils ont ainsi pour mission de rythmer la vie des habitants et d’encourager les interactions.
Découvrez comment Senioryta s’engage pour le bien vieillir avec ses habitats partagés urbains et périurbain.
La question du mieux vieillir va devenir de plus en plus prégnante. Actuellement, en France, il y a 18 millions de seniors de plus de 60 ans. Selon les projections, ils seront 22,6 millions en 2045 et 23,8 millions en 2070, passant de 33 % de la part de la population en 2045, puis à 35 % en 2070. C’est ce que révèle l’une des études de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui dépend du ministère de la Santé et de la Prévention.
Au sud de la Charente, dans la petite commune de Lachaise, Laurence Frouin a décidé de s’emparer de cette question de société en créant un concept hybride : Valfontaine Village, un village intergénérationnel. Il prendra place sur son domaine familial, une exploitation agricole composée d’un grand corps de bâtiments.
Afin de concrétiser ce projet, 4 millions d’euros sont nécessaires pour pouvoir ouvrir en 2026. Le capital est ouvert aux citoyens. Pour le moment, 32 sociétaires ont investi 80 000 euros. À quoi vont servir ces fonds ? Comment est articulé ce village ? Sur quelle valeur repose le Village Valfontaine. Laurence Frouin, nous raconte.
Dans les EHPAD et les maisons de retraite, il n’est pas rare de voir disparaître certains linges des résidents. C’était le cas pour la grand-mère d’Henri et Thierry Hollier-Larousse.

Pour retrouver ces vêtements perdus, les deux frères ont alors imaginé une solution simple permettant de tracer le linge : Ubiquid. En apposant des étiquettes connectées, les équipes soignantes gagnent du temps et le linge retrouve facilement son propriétaire.
En 2022, cette solution de suivi du linge a décidé d’occuper une nouvelle mission : assurer la sécurité des résidents et rassurer les familles. Ubiquid a alors lancé Alerte Errance au sein des EHPAD et des maisons de retraite.
Tout en respectant l’intégrité des résidents, Alerte Errance s’appuie sur le système des étiquettes connectées. L’application identifie alors les passages des résidents et donne l’alerte lorsque l’un d’entre eux se dirige vers une zone potentiellement dangereuse. Aujourd’hui, plus de 500 établissements en France sont équipés de ces technologies.
“Dans le nom Baraque à Frat’, “frat” signifie fraternité. Dans le Nord, on pense toujours aux baraques à frites, alors c’est un petit trait d’humour. On a inventé un dispositif itinérant où les bénévoles se déplacent auprès des personnes âgées pour créer des lieux de convivialité”, explique Hélène Ducatillon, coordinatrice du développement social pour les Petits frères des pauvres à Cambrai.
Selon les territoires, les bénévoles se déplacent en camion ou en voiture jusqu’aux lieux d’habitation des personnes. Ils proposent notamment un temps de rencontre avec des jeux, des escape games et d’autres activités pour les personnes âgées.
À Cambrai, une équipe de huit personnes se déplace dans sept villages de la région. “En milieu rural, il existe des problématiques de transport et de mobilité pour les personnes âgées. Les services disparaissent, les clubs des ainés aussi. Ces personnes restent seules, sans possibilité de se déplacer au-delà de leur village. Leur famille peut habiter loin d’eux également. Elles ont peu de temps à consacrer à leurs parents ou leurs grands-parents, d’où notre initiative.”
Plus d’informations sur la Baraque à Frat’ ici.
En France, 2,5 millions de seniors sont en perte d’autonomie, selon des études de l’Insee. Ce chiffre va d’ailleurs croître d’après les projections de l’Institut national des statistiques qui met en exergue un vieillissement de la population.
Alors, afin de faire de la prévention sur ce phénomène, Stéphan Marrocq a souhaité apporter une solution. Il a ainsi créé l’application Gabby, qui est un dispositif agréé service. Elle a pour objectif d’être une aide à la prévention de la perte d’autonomie. Six communes françaises, dont Mâcon (Saône-et-Loire) et Saint-Saulve (Nord) se sont dotées de cette application. Elle fonctionne avec un abonnement de 4,25 euros par mois.
Comment fonctionne ce dispositif concrètement ? En suoi joue-t-il son rôle d’acteur de la prévention ?
Deux millions de personnes âgées sont isolées en France. Afin de lutter contre la solitude des seniors en été, l’association Petits Frères des Pauvres organise, depuis plus de 75 ans, des séjours à travers la France destinés à ses bénéficiaires. Une centaine est organisée de juin à septembre. Environ, mille personnes suivies par la structure sont concernées.
Cette année, les vacances des ainées prennent une tournure sportive. À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l’association organise ses propres olympiades, et plus précisément ses « Old’ympiades », qui peuvent se traduire par les olympiades des seniors. Comment sont-elles organisées ? Quels sont les bénéfices pour les seniors ? Fabrice Talandier, directeur des Territoires, du Développement et de l’Innovation chez les Petits Frères des Pauvres nous partage ses attentes avec cette démarche.
Lucie Reyx est partie avec Georges le 4 avril dernier depuis Bordeaux pour réaliser un tour de France des Ehpad. Georges n’est autre que son fidèle vélo jaune, baptisé du prénom de son grand-père. Jusque début août, cette étudiante en gérontologie de 21 ans va sillonner la France en pédalant. Elle se rend ainsi dans différentes maisons de retraite pour rencontrer les résidents et leur remettre des lettres rédigées par des inconnus. Pour ce faire, elle s’est rapprochée de l’association « 1 lettre 1 sourire » qui lutte contre l’isolement des personnes grâce à la distribution de lettres.
Elle réalise cette aventure de plus de 4000 km à la force des mollets, qui s’achèvera le 3 août à Rochefort, en Charente-Maritime, sa ville natale. Lucie a également réalisé un petit crochet en Belgique. À travers ce périple, elle souhaite contribuer à son échelle à changer le regard sur le troisième âge. Mais aussi donner le sourire aux résidents et créer du lien.
C’est lors d’un stage qu’elle a réalisé qu’elle appréciait le contact des personnes âgées. Ce tour de France qui sonne aussi comme un défi sportif et humain intense pour la jeune femme. Elle sort grandie de ce périple. Elle retient de nombreuses rencontres qui la marqueront à vie. Des aventures qu’elle fait vivre sur ces réseaux sociaux “A Bicyclette“.
Le cancer du sein touche actuellement une femme sur huit et se développe, dans les trois quarts des cas, chez des personnes de plus de 50 ans. Pour prévenir ces cancers, l’Organisation mondiale de la Santé recommande la pratique d’une activité physique régulière. C’est également le slogan de l’association Courir pour Elles : “Tout au long de l’année, je bouge pour ma santé !”
Cette association, créée en 2010 par Sophie Moreau, a deux missions principales : sensibiliser au sport santé et soutenir les femmes en soin. Ces actions de prévention et de soutien ont pour but de lutter contre les cancers féminins. De nombreux rendez-vous sportifs et des temps de sensibilisation rythment ainsi l’année et permettent de faire connaître tous les bienfaits du sport.


L’un des temps forts de l’association reste la course Courir pour Elles, qui rassemble chaque année des milliers de femmes habillées en rose. Chacune vient alors se dépasser et apporter son soutien aux femmes en parcours de soin. Cette course exclusivement féminine permet également aux femmes de courir dans un environnement sécurisé et bienveillant.
Le succès de cet événement met en lumière la solidarité et l’engagement de ces femmes autour de cette cause commune. Les participantes peuvent aussi y découvrir des stands de sensibilisation ainsi que des solutions pour les femmes en soin. De nombreux partenaires sont également présents lors de ces événements et n’hésitent pas à apporter leur soutien financier. Ces financements ont permis à Courir pour Elles de soutenir plus de 10 000 femmes en soin depuis 2010.
AirZen Radio se mobilise pour vous donner les clés d’un vote crucial : celui des élections européennes du 9 juin. Dimanche prochain, 450 millions d’électeurs et d’électrices des 27 États membres choisiront leurs représentants au Parlement de Strasbourg pour les cinq prochaines années. Ce scrutin a lieu pour la neuvième fois depuis 1979, année des premières élections.
En quinze pastilles audios de deux minutes chacune, nos journalistes – Marie-Belle Parseghian, Jérôme Pasanau et Olivier Montégut – explorent différents aspects de l’Union européenne. Ils abordent des sujets tels que la mobilité, la santé, l’éducation, la justice, l’économie, le handicap, la diplomatie, l’emploi, la jeunesse, l’alimentation et l’agriculture. Ainsi, ils expliquent l’influence de l’Union européenne sur notre quotidien.
L’occasion également de faire le point sur des thèmes fondamentaux tels que la paix, la justice, le rôle des eurodéputés, la mobilité, l’inclusion dans les quartiers populaires. Mais également de parler de l’identité européenne et de l’histoire de l’Europe. Sans oublier de se tourner vers l’avenir, en examinant la transition écologique, les politiques environnementales de l’UE et le regard que porte la jeunesse sur l’Europe.
Enfin, ils expliquent pourquoi il est important de voter aux élections européennes. Du fonctionnement de l’Europe, aux raisons et enjeux de ce scrutin, vous aurez toutes les cartes en main pour exercer votre droit de vote ce dimanche 9 juin.
C’était le dernier département de Bourgogne-Franche-Comté à ne pas posséder une antenne locale de l’association Les petits frères des pauvres. Pourtant, dans le Jura, zone rurale de l’Est de la France, les défis pour lutter contre l’isolement des personnes âgées sont bien présents. “En zone rurale, les commerces de proximité disparaissent et l’accès aux premiers services est difficile. On doit créer des équipes de bénévoles mobiles afin qu’ils couvrent plusieurs communes différentes, contrairement aux grandes villes comme Strasbourg ou Paris où nous sommes présents”, explique Emmanuelle Meyer, coordinatrice de l’asso jurassienne.
Les bénévoles des Petits frères des pauvres ont pour mission d’apporter du lien social aux personnes âgées isolées, mais aussi de les réinsérer dans la société, en les faisant participer à des activités collectives. “Dans la région, il y avait une petite dame qui était très isolée, et qui n’avait aucun lien avec les autres habitants de son village. L’association a réussi à l’inscrire au club du troisième âge de la commune. Nous sommes des médiateurs qui poussons ces personnes à vivre des choses en dehors de chez elles, et qui sont nécessaires à l’épanouissement de tout un chacun”.
Les petits frères des pauvres dans le Jura. Contact : 0756300912 emmanuelle.meyer@petitsfreresdespauvres.fr
Tous les troisièmes vendredis du mois, à la Tour de Gassies, un centre de rééducation situé à Bruges (Gironde), entre 15 et 20 personnes se rassemblent pour participer au Café AVC. Il s’agit de groupes de paroles développés par l’association AVC tous concernés, à destination de personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral. Chaque année, environ 140 000 personnes sont victimes d’accident vasculaire cérébral, selon l’Agence régionale de santé (ARS). En 2014, Philippe Meynard a fait partie de ces personnes. C’est pourquoi l’ancien maire de Barsac et actuel conseil municipal de la commune a fondé cette structure régionale qui fait de la prévention.
Laurent, lui, a fait un AVC en 2018. Il est le référent des Cafés AVC, disséminés en Nouvelle-Aquitaine -Bordeaux, Cénac, Bruges, Langon ou encore Salies-de-Béarn. Chaque antenne en organise une fois par mois. « Nous avons des conventions avec des centres de rééducation. Ce sont des moments d’échange de deux-trois heures avec des patients. Ici, ils viennent d’une manière libre échanger avec les membres de l’association. Et le dialogue est facile, parce que l’on parle d’égal à égal. Il n’y a ni filtre, ni jugement. On n’est pas des thérapeutes ou des médecins, on ne se substitue pas à eux. Ça peut permettre de sortir de cet environnement dans lequel on se sent seul, et c’est important. »
C’est justement pour cette raison que Nadine a souhaité assister à l’un de ces Cafés AVC, sur recommandation de son sophrologue. “Je suis en situation de solitude et j’ai besoin, non seulement qu’on m’aide, d’avoir des renseignements, mais aussi d’aider et de voir du monde.”
Marie, elle, a rejoint l’association en tant que bénévole pour apporter une aide, un soutien, une écoute. « J’ai souhaité donner du sens à ce que j’avais traversé. Offrir une parole positive, de l’espoir et, pourquoi pas, de la force à ceux que j’allais rencontrer. Car quand on fait un AVC, c’est un tsunami. Et pas seulement un tsunami pour la victime, mais aussi pour ses aidants. Ça reste un accident qui laisse les victimes dans beaucoup de détresse, de solitude et de désarroi. Moi, j’ai eu la chance de ne pas rencontrer cette détresse. J’avais deux atouts : beaucoup d’amour et beaucoup d’humour ».
Handigmatic. C’est le nom de l’escape game proposé par l’antenne strasbourgeoise de l’association APF France handicap. En 45 minutes d’énigmes, l’objectif est de sensibiliser au quotidien des personnes en situation de handicap et aux questions y sont liées. Créé en 2018, ce jeu s’adresse au plus grand nombre, particulièrement aux établissements scolaires et aux entreprises.
Le dispositif peut se jouer en équipe de quatre, six et jusqu’à 15 joueurs. Il amène les joueurs au cœur d’une affaire policière. Différents challenges permettent alors de traiter les thématiques liées au handicap. Les énigmes permettent aussi de découvrir la lecture labiale ou le braille. L’objectif est aussi de mettre en situation les participants avec un fauteuil roulant, par exemple, ou des lunettes spécifiques simulant un glaucome. L’escape game permet, entre autres, d’aborder les enjeux de l’accès à l’emploi et de briser les peurs qui entourent l’embauche de personnes en situation de handicap. Les questions d’adaptation des conditions de travail sont aussi abordées.
Cette expérience unique dans la région est suivie d’une heure d’échange avec des personnes en situation de handicap et des spécialistes. Le dispositif peut par ailleurs se déployer sous tente, se jouer sur table ou en ligne. Le but est ici de représenter les personnes en situation de handicap et leur garantir une meilleure insertion dans la société. Une philosophie que porte l’association partout en France depuis plus de 90 ans.
En 1969, la première Porte Ouverte de France ouvre à Lyon dans le 2ᵉ arrondissement. La Porte Ouverte est un lieu chaleureux qui accueille des personnes venues parler de leurs problèmes de façon anonyme. Ce lieu met en avant l’écoute, la rencontre et l’échange. Chacun est libre de parler de ce qu’il souhaite et reste à l’abri de tout jugement. Plusieurs Portes Ouvertes ont ensuite ouvert à travers la France pour contrer la solitude grandissante dans la société. Quelques années plus tard, en 1990, la Porte Ouverte de Lyon s’installe dans le métro, à la station Bellecour. Rebaptisée Écoute Lyon Bellecour en 2023, l’association accueille chaque jour des anonymes de tout horizon, sans distinction d’âge, de sexe ou de religion.

Philippe Delorme est bénévole à Écoute Lyon Bellecour et participe au conseil d’administration de l’association. Il offre une oreille attentive depuis plusieurs années et s’adapte à chaque écouté. Les bénévoles de l’association sont ainsi formés à l’écoute rogérienne, pensée par le psychologue américain Carl Rogers. L’écoute attentive et active reste anonyme et laïque. Aucun jugement ou diagnostic ne sont émis lors de ces rendez-vous. Philippe rappelle d’ailleurs qu’ils ne sont ni des psychologues, ni des médecins. En libérant la parole, les bénévoles incitent les écoutés à prendre conscience de leurs affects. Ainsi, chacun peut trouver les ressources en lui grâce à la parole et mettre en place des solutions concrètes. Pour Philippe, ce lieu reste indispensable à Lyon en permettant à tous de prendre une pause dans un quotidien effréné.
La Fédération Trisomie 21 France a récemment été contactée par Alexa, l’enceinte connectée d’Amazon, afin de développer une application inclusive. C’est comme cela qu’est née Ma Vie Facile, imaginée par et pour les personnes porteuses de Trisomie 21 et autres troubles du développement intellectuel.
Cela se traduit par un certain nombre d’outils vocaux permettant d’instaurer une routine, des rappels, une aide pour faire les courses, la cuisine ou des achats.
« On a d’abord confié une enceinte Alexa à une personne porteuse de trisomie et on a observé ce qu’elle en faisait », explique Bernadette Céleste, membre du comité scientifique de la Fédération. Elle ajoute : « cette enceinte sert par exemple à se distraire, écouter de la musique, discuter avec les autres… ».
Si Alexa est déjà utile pour ce genre de tâches, Ma Vie Facile rend son accessibilité plus simple et intuitive. « Nous avons pensé l’application avec une jeune femme trisomique, Justine. Elle, par exemple, avait besoin de rappels pour nettoyer ses lunettes ou se lever le matin », explique Bernadette Céleste.
L’outil a donc été utile pour elle, mais aussi pour ses aidants. « Justine accepte plus facilement quand Alexa lui demande quelque chose plutôt que sa maman. Et pour sa maman, c’est une charge mentale en moins ».
Il existe néanmoins un bémol pour les aidants de jeunes porteurs de Trisomie 21. Leur intervention est indispensable pour paramétrer l’application avant son utilisation.
Aujourd’hui, Ma Vie Facile est disponible et téléchargeable gratuitement sur l’enceinte Alexa. « Mais l’appli est toujours en rodage », précise Bernadette. Elle est actuellement testée par plusieurs personnes porteuses de troubles du développement intellectuel. « Le but est de constamment l’améliorer », conclut-elle.
C’est au 21 cours de Verdun, tout près du Jardin public, dans le centre-ville de Bordeaux, qu’a élu domicile depuis deux ans la Ressourcerie. Ce lieu, géré par une association éponyme, est tourné vers l’accompagnement des aidants familiaux et proches aidants. On estime qu’ils sont entre 8 et 11 millions sur le territoire français. Ils jouent un rôle important dans la société. Ils apportent un soutien moral, financier et/ou pour les tâches quotidiennes auprès de personnes en situation de handicap, de vieillissement ou de perte d’autonomie. Et ce, de façon ponctuelle ou régulière. Ce rôle peut avoir des répercussions lourdes dans leur quotidien. D’où la création de lieux afin de leur permettre de se ressourcer.
« La volonté d’accompagner autrement “l’aidance” a motivé l’ouverture de la Ressourcerie, soutenue par Malakoff Humanis, une caisse de retraite complémentaire. Catherine Roux, salariée de ce grand groupe, en est à l’initiative. Elle constatait la difficulté qu’avaient ses équipes sur le territoire à accompagner les aidants », explique Laura Briday, animatrice et coordinatrice du lieu. Les adhérents, principalement des femmes, sont accueillis dans une ambiance cosy avec des couleurs bois clair et bleu. Dans un seul et même espace, il y a l’accueil, un salon, une bibliothèque, une cuisine et un espace avec des tables et des chaises. C’est là que se déroule la majorité des ateliers créatifs (peinture à l’aquarelle, macramé, broderie, etc), de bien-être (yoga, Pilate, sophrologie) et culturels. Ces activités varient en fonction des semaines.
« Le lieu est ouvert à tout le monde. C’était un souhait des aidants, évoqué lors des ateliers de coconstruction. Ils ont demandé qu’il y ait un public mixte pour permettre des discussions qui sortent du champ du rôle d’aidant, pour s’évader. Nous, à l’association, y voyons un double avantage, dit-elle. On peut faire passer des messages de prévention auprès des personnes non-aidantes parce qu’on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Nous souhaitons qu’avant d’avoir ce rôle, elles sachent qu’il y a un lieu où trouver des informations avant qu’il ne soit trop tard, c’est-à-dire que l’aidant s’épuise, s’oublie au profit de son proche », souligne Laura.
La Ressourcerie a une équipe psychosociale présente pour renseigner et orienter les aidants. Parmi elle, Magali Dupouy est en charge de la partie accompagnement social. « Ma mission, c’est de faire un diagnostic de la situation. D’où ma première question, qui est de savoir ce dont ils ont besoin. Une question qui est plutôt posée à l’aidé qu’à l’aidant. Notre travail consiste justement à remettre l’aidant dans le circuit, car celui-ci sous-estime souvent son rôle, et en oublie de s’occuper de sa santé. On peut alors arriver à des cas où l’aidant, s’il est âgé ou lui aussi malade, meure avant l’aidé », explique-t-elle.
Par ailleurs, Magali a aussi pour tâche de les « soulager des tumultes de l’administration » en les informant sur les ressources existantes. En effet, les dispositifs d’aides et les droits des aidants ne sont pas forcément lisibles ni connus de tous. Cela peut s’expliquer par différentes raisons, dont le fait que le statut d’aidant n’a été reconnu qu’en 2015 par la loi. S’ajoute la difficulté, pour beaucoup d’aidants, à se considérer comme tel. Car il parait évident de s’occuper d’un parent, d’un enfant, d’une tante malade. Certaines personnes ignorent d’ailleurs l’existence de ce statut.
Ça a été le cas pour Lætitia, aidante auprès de son père atteint des maladies de Parkinson et d’Alzheimer, et de sa mère. Ce sont ses praticiens qui ont donné l’alerte. Ils lui ont conseillé de venir à la Ressourcerie, car sa santé s’était dégradée. Cette démarche a été difficile à entreprendre, mais lui est aujourd’hui bénéfique. « Quand j’ai passé le pas de la porte, j’ai été prise en charge comme dans un petit cocon. On a discuté et on m’a expliqué les activités. J’ai sauté le pas, je me suis inscrite, et j’ai fait un premier atelier. Ma première activité a été un bracelet sur lequel j’ai marqué “vivre” dessus. Ça a été le déclic. Quand on est aidant, on ne sait plus qui on est. Je suis dans les soins, j’accompagne au rendez-vous, etc. Ici, les activités, les échanges nous permettent de nous retrouver », raconte-t-elle.
Depuis sa création en 2019, La Ressourcerie a 200 adhérents.
Certaines écoles organisent des week-ends d’intégration festifs. D’autres proposent de construire des chaises en bois pour les résidents d’un EHPAD. C’est l’idée de l’ESSCA, qui participe aux Splash Projects. Cette initiative a pour objectif d’aider les étudiants à mieux se connaître et à créer du lien tout en réalisant un projet solidaire.
À l’ESSCA, Grande École de management présente à Boulogne, près de Paris, les 366 étudiants post bac de première année ont expérimenté, début septembre 2023, une semaine d’intégration autour d’un projet collectif et solidaire. Objectif : les mobiliser dès les premiers jours de la rentrée sur des actions porteuses de sens.
Afin de les encourager à devenir acteurs de la transition, les étudiants de première année sont intervenus auprès d’un EHPAD à Montesson (Yvelines). Ils avaient pour mission de créer des espaces sécurisés et ombragés pour des personnes âgées. « On ne se connaissait pas du tout avant », confie l’un d’eux. « Réaliser un projet ensemble, manager une équipe, ça renforce les liens », poursuit une autre.

Une façon également de mieux encadrer l’intégration sauvage ou le bizutage ? « Quand on est étudiant, on fait la fête, on le sait. Nous, on axe la rentrée sur la prévention des risques festifs. On mise sur une intégration intelligente, autour d’un vrai projet porteur de sens et d’impact », explique Marie, directrice de l’expérience étudiante.
De leur côté, les retraités ne sont pas en reste. Certains déambulent dans le jardin, à proximité du chantier, et discutent avec les jeunes qui s’activent. Au programme : construction d’espaces de détente et de discussion ombragés, plateformes d’observation dans les jardins, parcours naturels…

Et l’initiative est loin d’être isolée. Les étudiants du campus de Boulogne ont travaillé en simultané avec les étudiants des cinq autres campus de l’école : Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence et Angers. Au total, 1000 étudiants se sont mobilisés au sein d’IME et d’EHPAD.
À Lyon, l’association Anciela aide chacun à s’engager pour la solidarité ou la préservation de l’environnement. Elle accompagne les personnes à créer des entreprises éthiques ou des associations écologiques et solidaires. Anciela veut prouver à tous qu’il est possible d’agir et que chacun peut s’engager pour changer la société. En suivant ses valeurs, l’association a créé le Festival Agir à Lyon.
Cette quatrième édition a eu lieu le 1ᵉʳ octobre 2023 à La Maison Pour Tous des Rancy, dans le 3ᵉ arrondissement lyonnais. Justine Swordy-Borie est l’une des coordinatrices de ce festival pour Anciela. Elle explique que cet évènement donne à voir tout ce qui existe en matière de transition écologique et solidaire à Lyon.
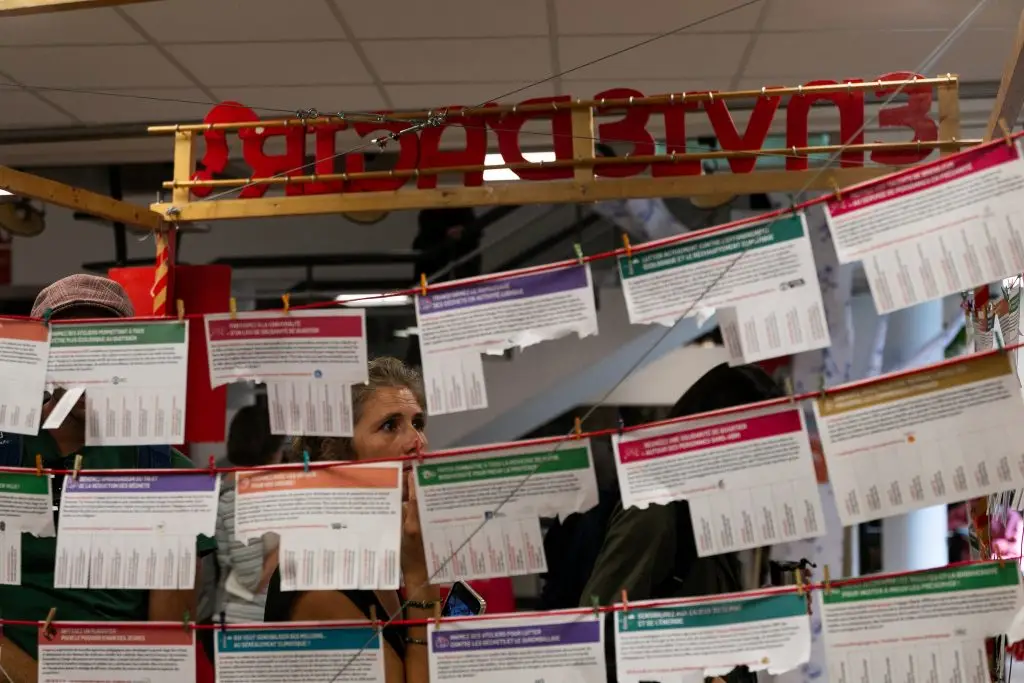

Au sein du festival Agir à Lyon, plusieurs moments ont été pensés pour mettre en avant ces initiatives inspirantes. Un mur des petites annonces regroupait par exemple les associations de la région lyonnaise. Les participants pouvaient également assister à un speed dating pour rencontrer plus facilement ces acteurs.
De nombreuses conférences ont également rythmé la journée. L’une d’elle mettait en avant les différents moyens de voyager sans prendre l’avion. Selon Justine, ces réflexions visaient à mettre du sens dans nos voyages. Des ambassadeurs du changement n’hésitaient pas, par ailleurs, à partager leurs expériences durables qu’ils ont eux-mêmes développées. Enfin, des balades découvertes d’initiatives étaient proposées aux festivaliers. Pour Justine, cet événement est nécessaire pour relancer la motivation de chacun. Grâce à toutes ces actions bénévoles, il est possible de faire mouvement et, ensemble, de changer le monde de demain.